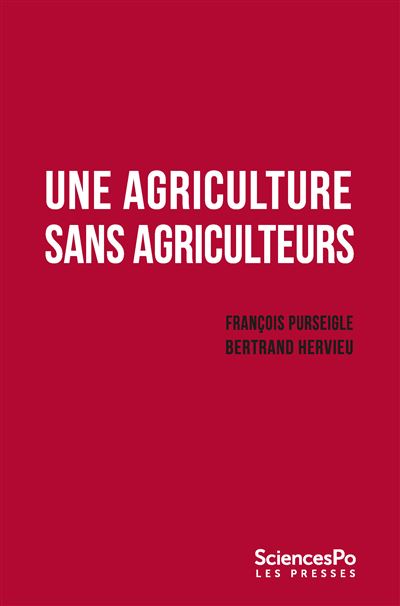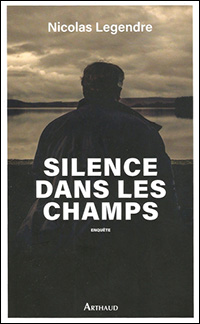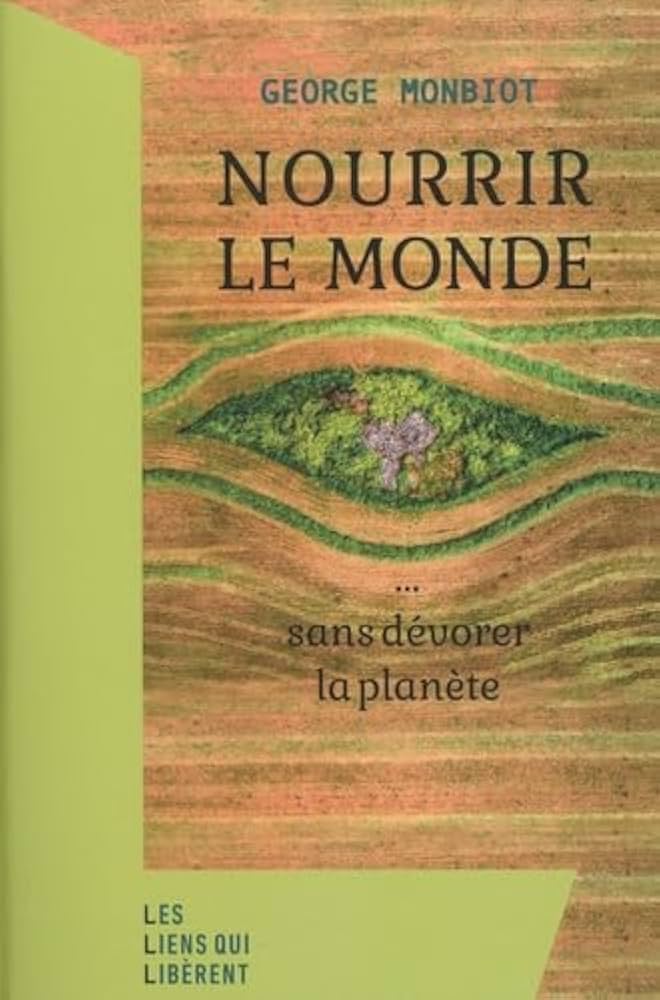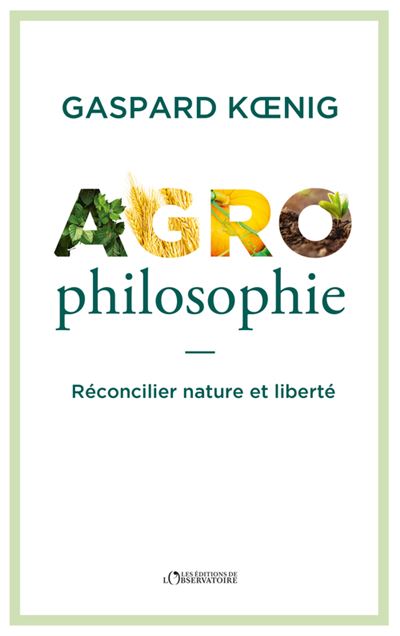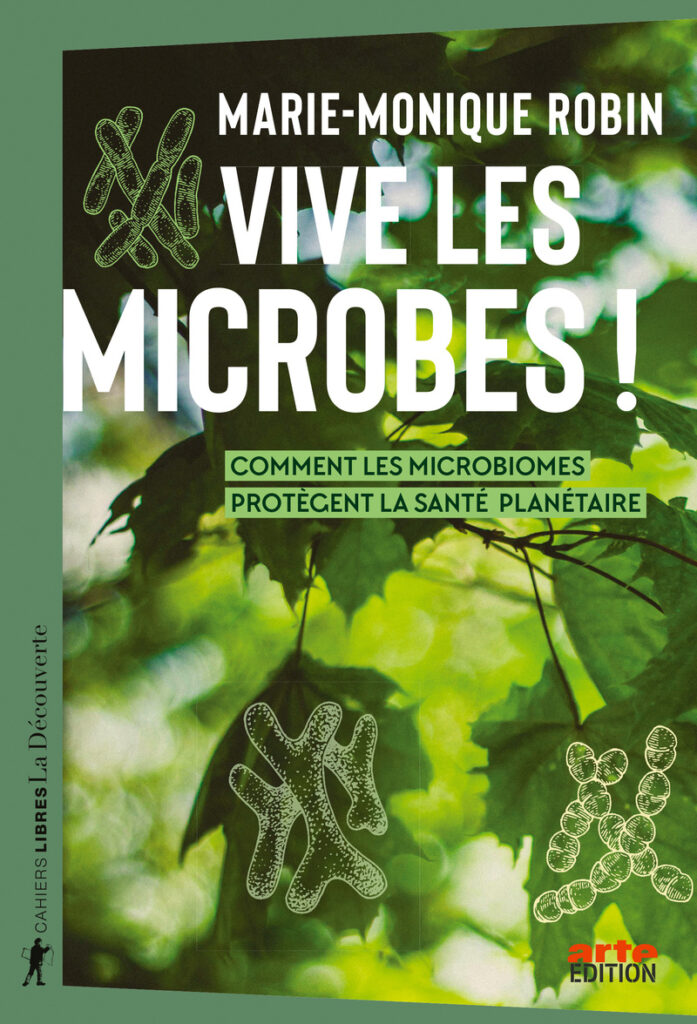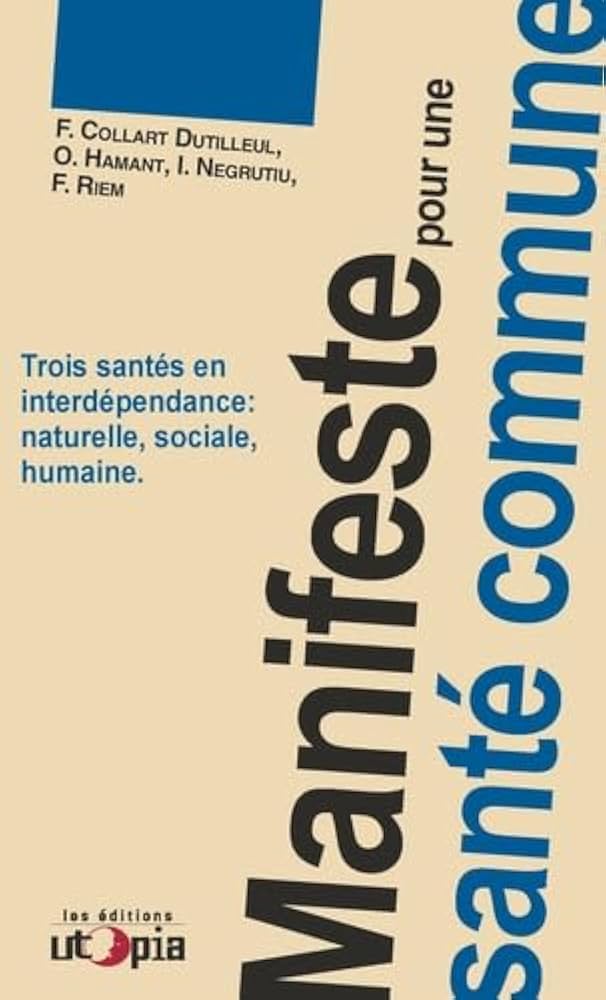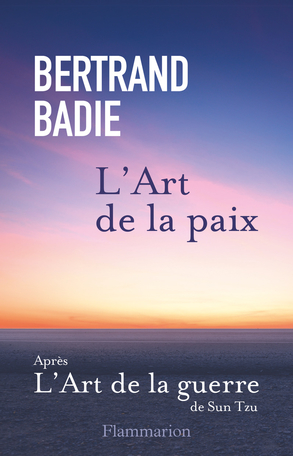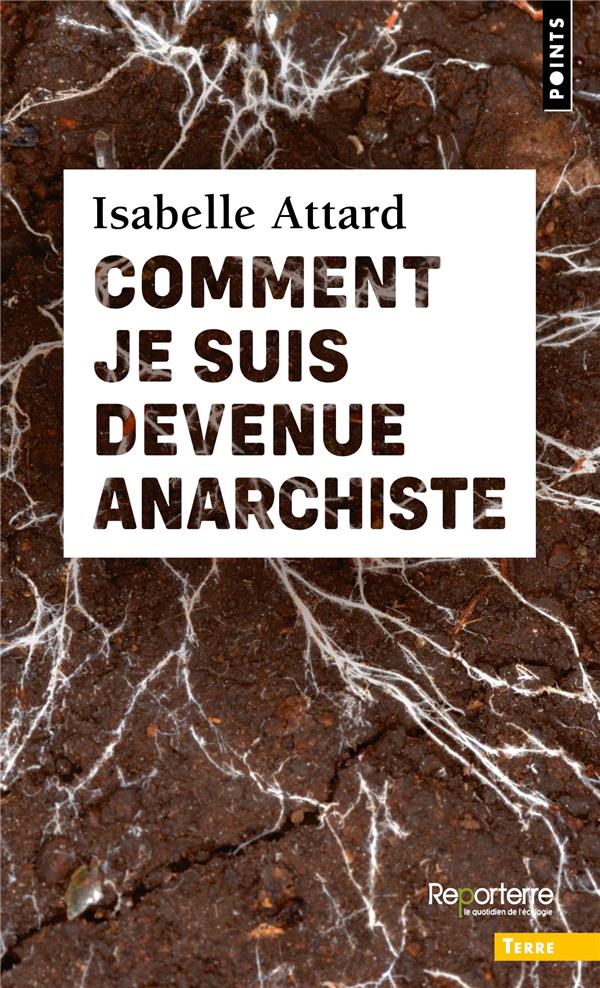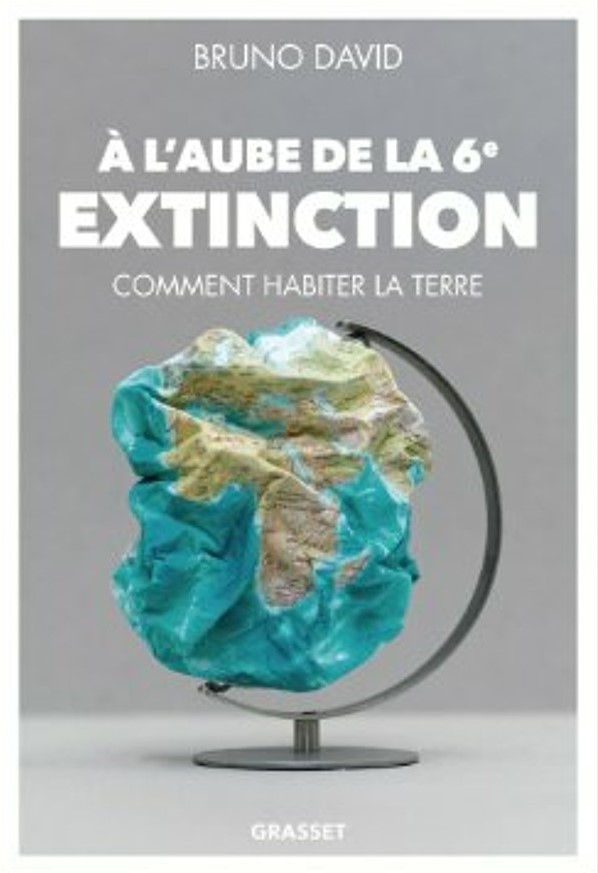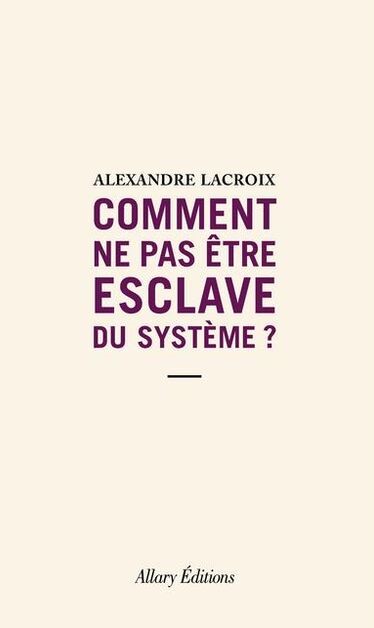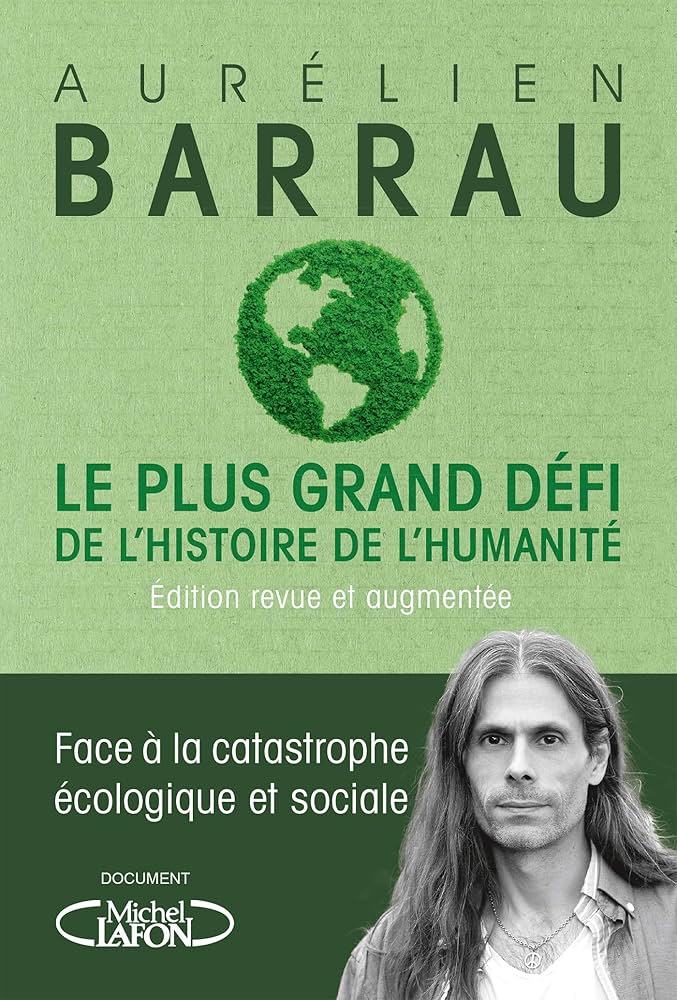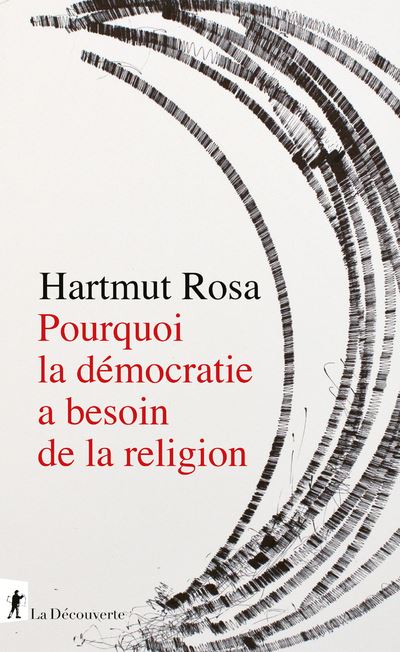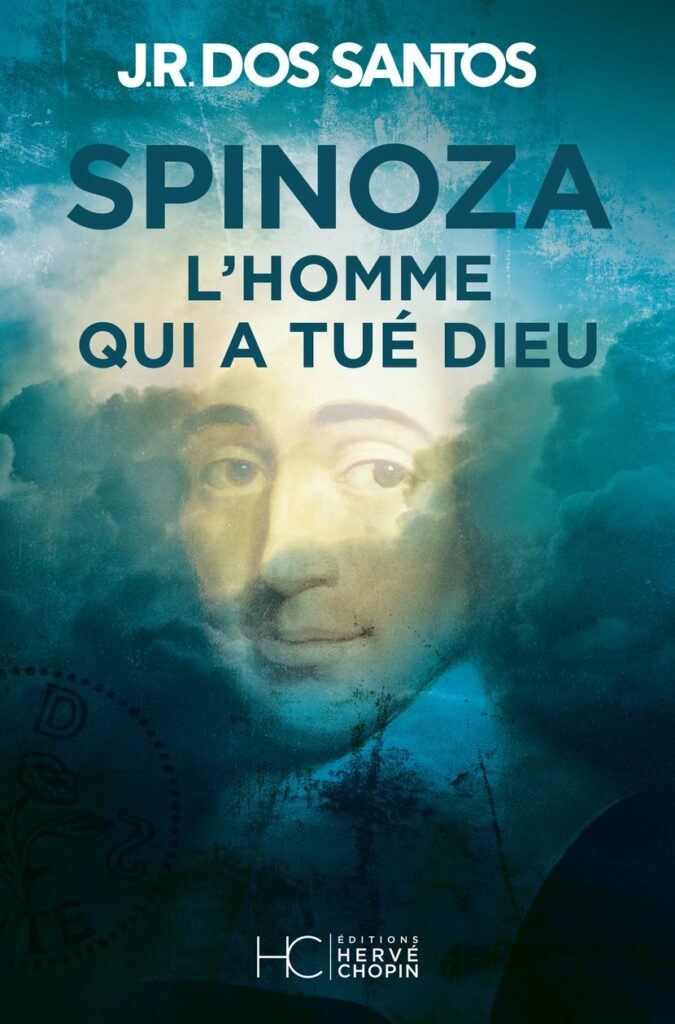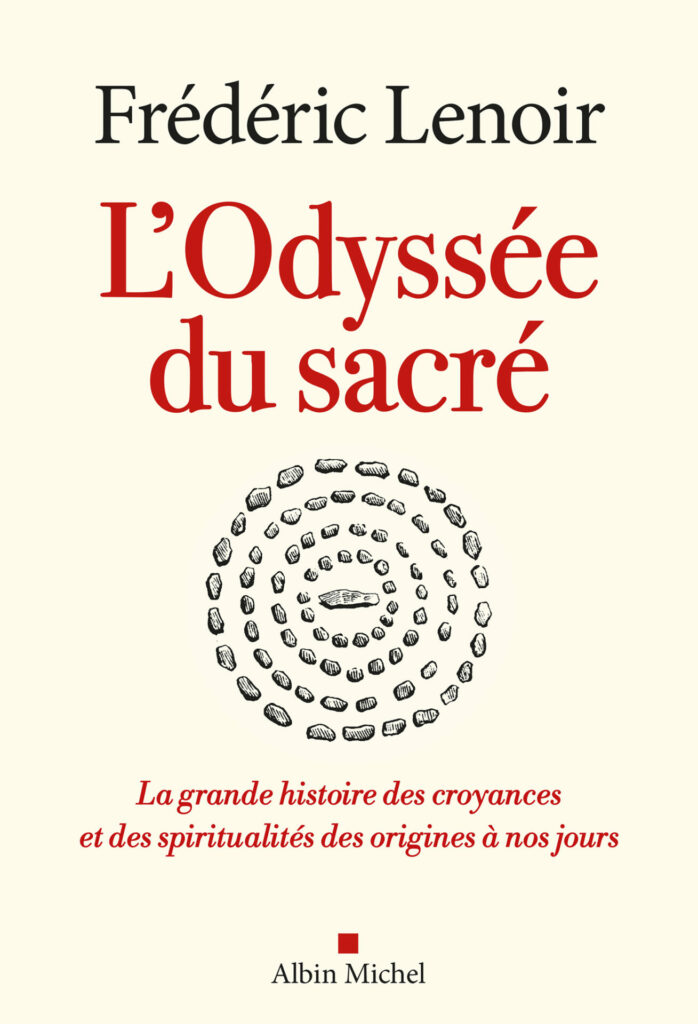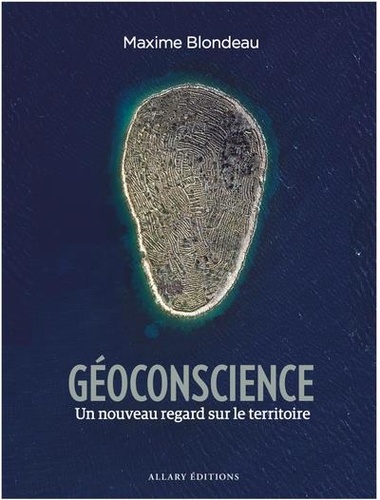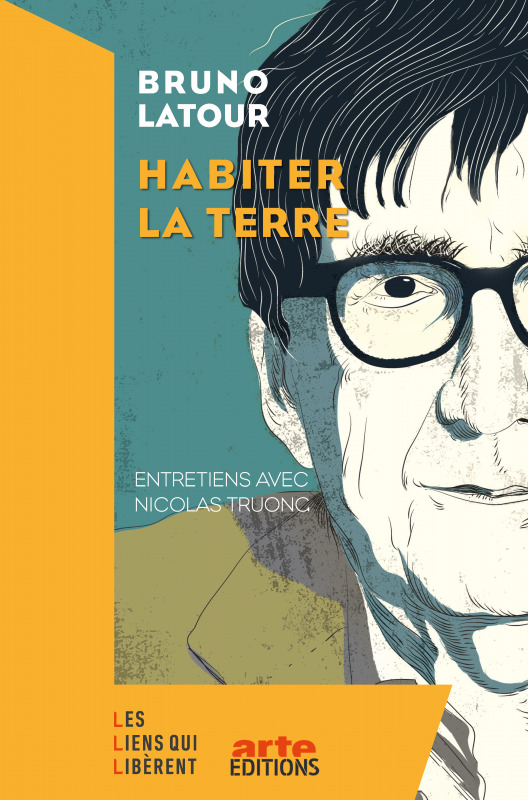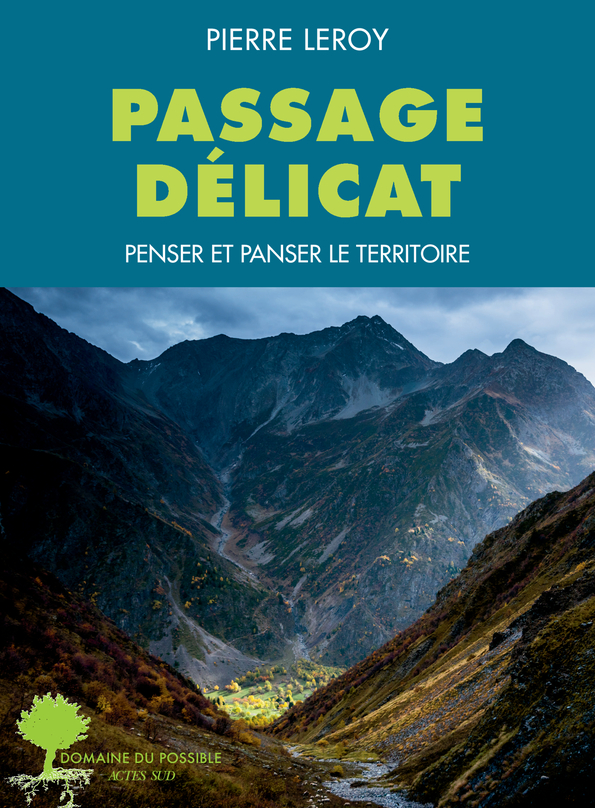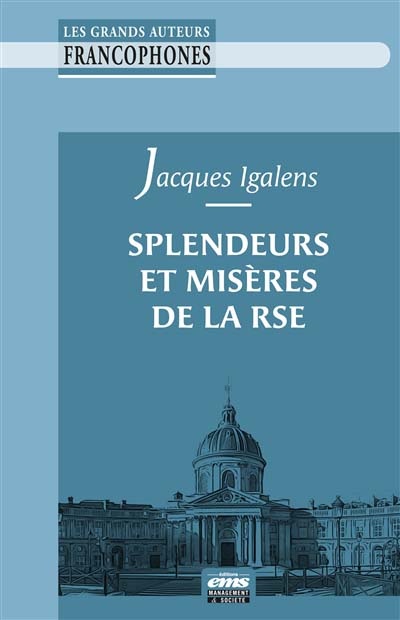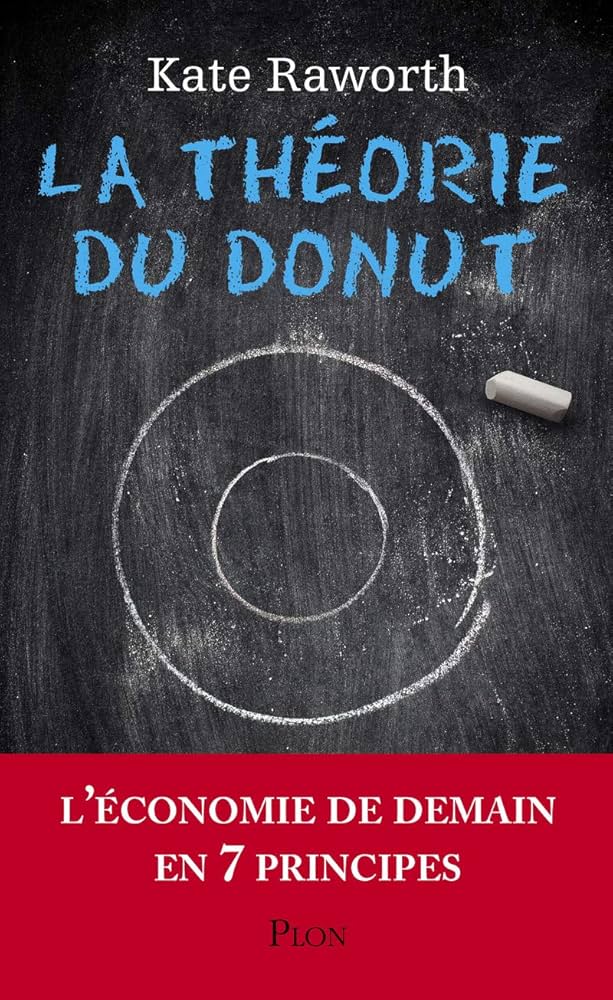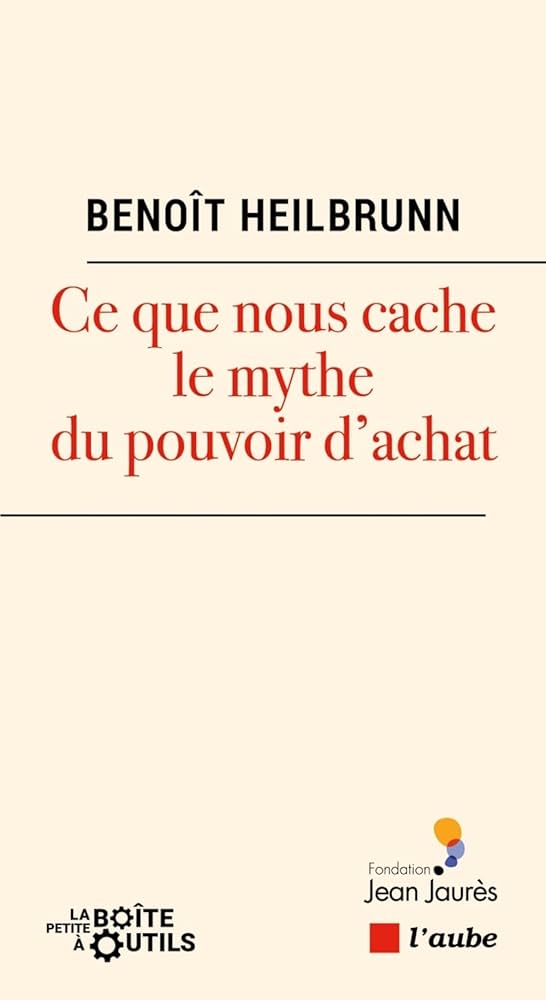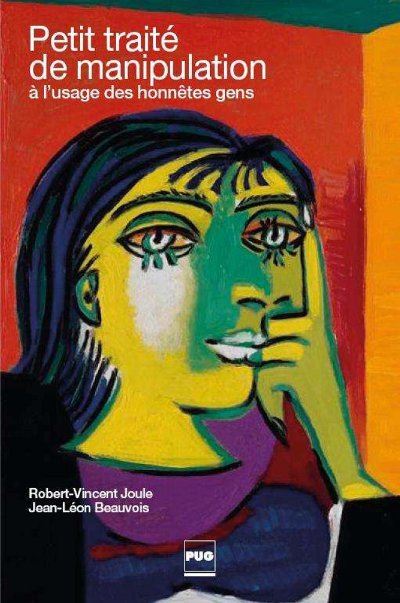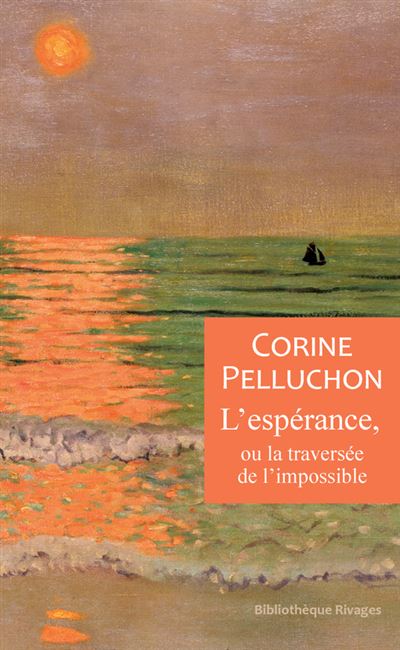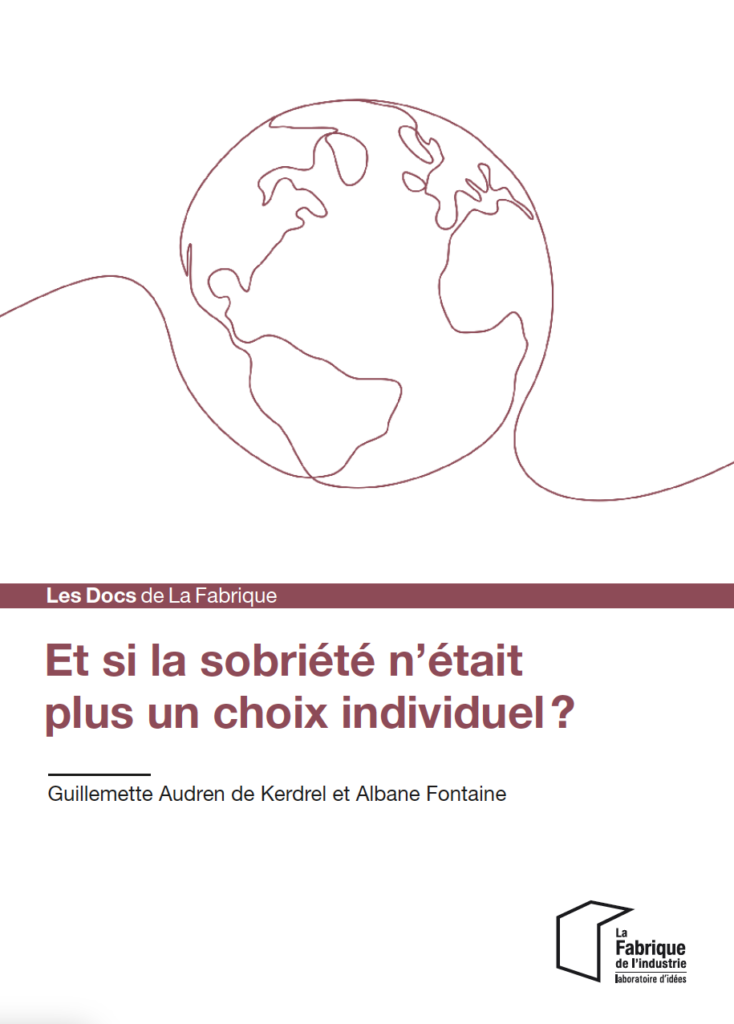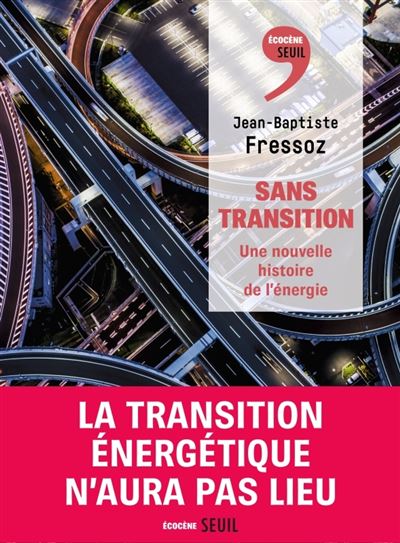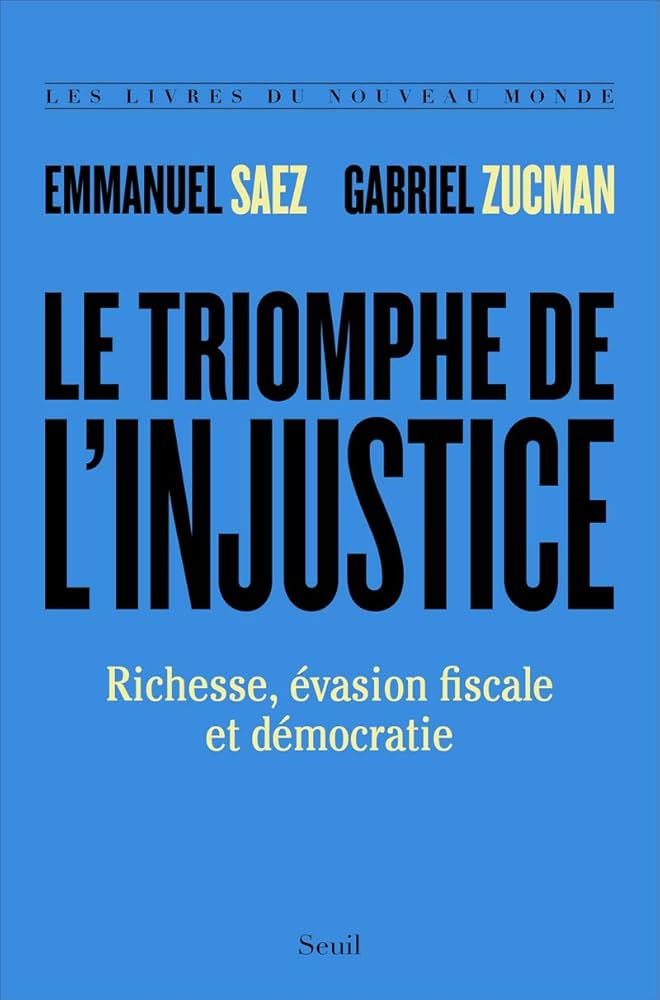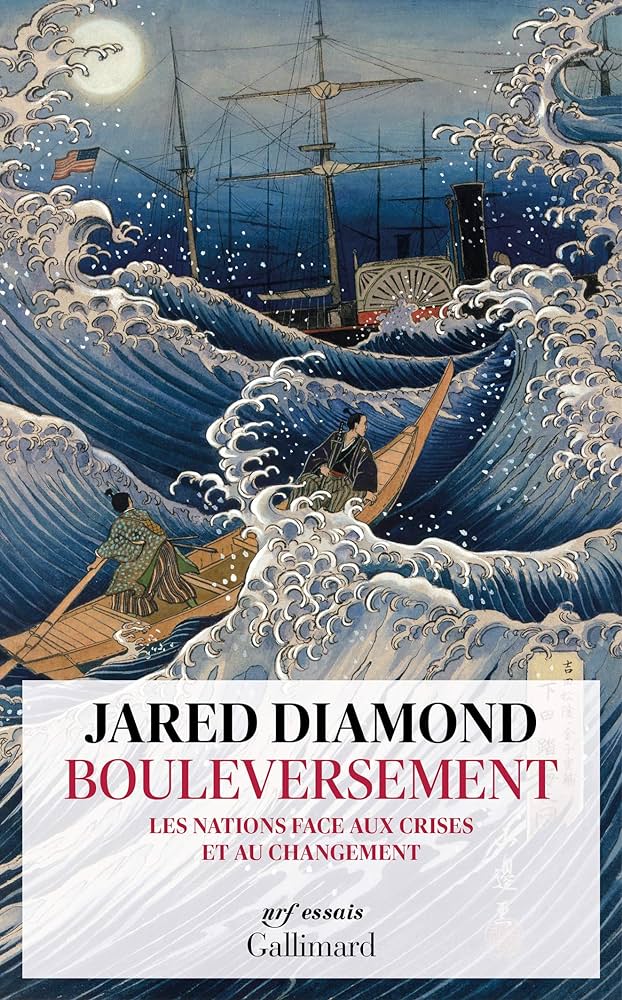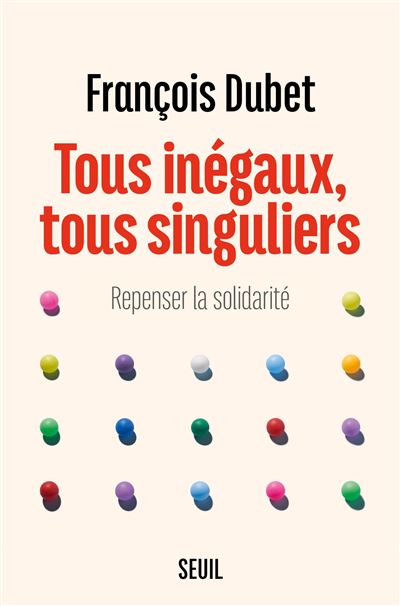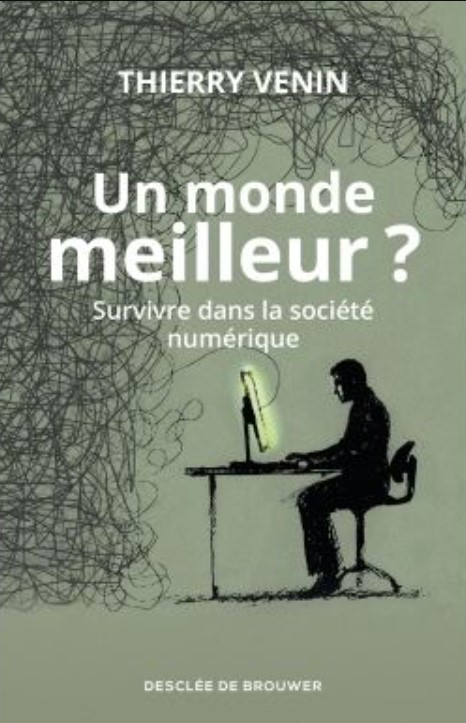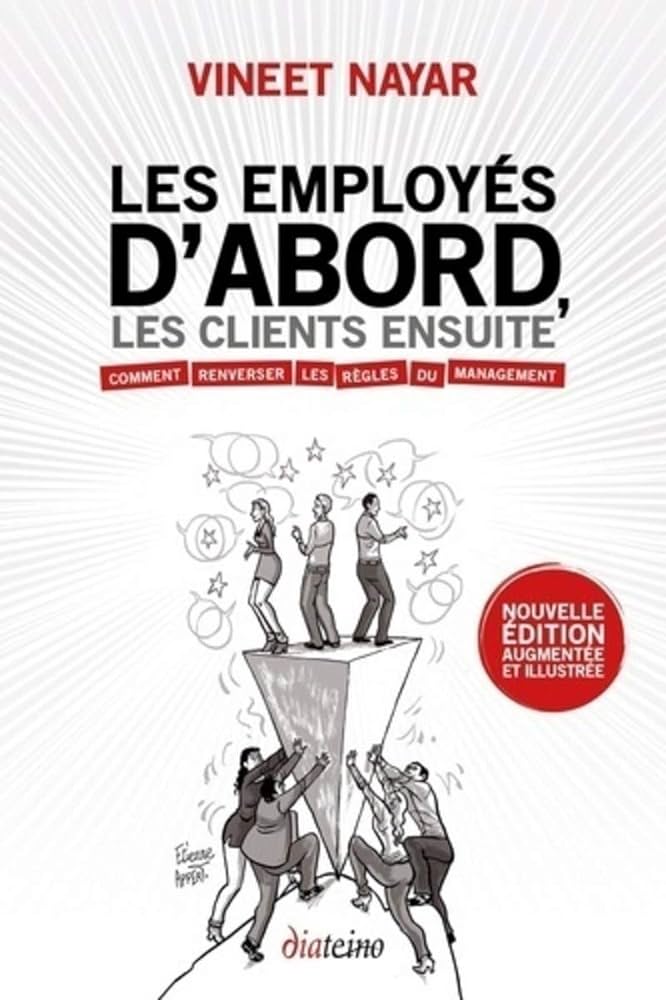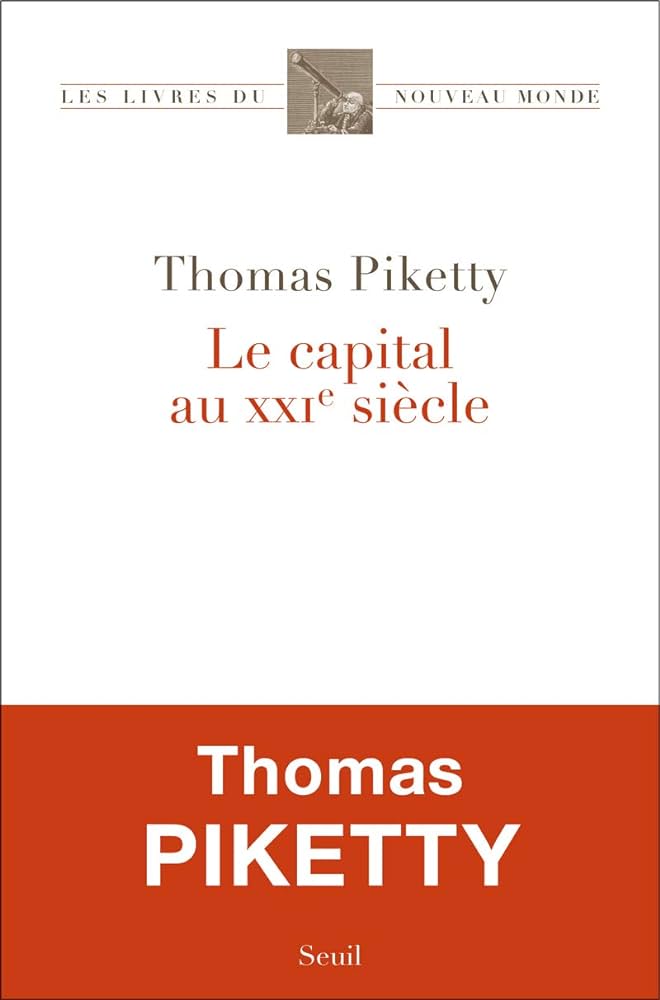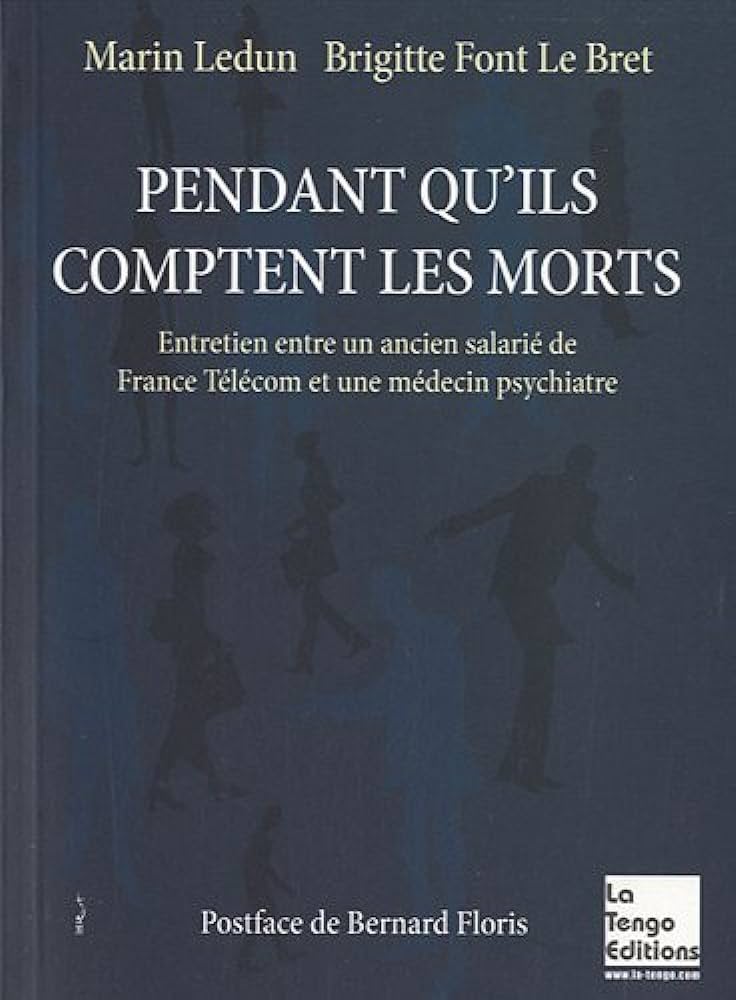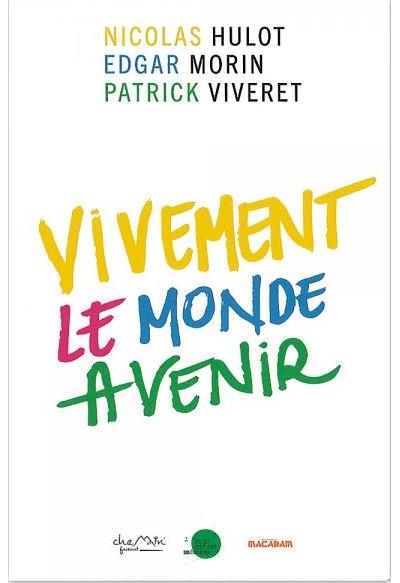Jacques Igalens, EMS éditions, 2023
Professeur émérite de gestion de l’Université de Toulouse, Jacques Igalens a plus de 40 ans d’expérience de travail académique sur la RSE. Comme l’indique son titre emprunté pour partie à Balzac, son ouvrage a deux faces. La face positive, c’est la manière dont le concept de RSE s’est développé en France plus vite que dans beaucoup de pays. Le revers de la médaille, c’est que comme le dit le préambule « l’échec de la RSE est patent ». La RSE « n’a pas été capable d’éviter que les entreprises ne produisent des dégâts environnementaux considérables et ne s’accommodent de la persistance d’un haut niveau de misère sociale et sociétale ». Jacques Igalens en analyse les causes, et en particulier la faiblesse des théories économiques dominantes. Il propose des pistes de solutions utilisant un droit beaucoup plus contraignant qu’aujourd’hui.
La première partie est une remarquable présentation de l’évolution de la notion de RSE et son application concrète depuis l’ouvrage « Social responsibilities of businessman » de Howard Bowen en 1953, jusqu’à la directive européenne sur la CSRD de 2022.
Après 30 ans d’incubation et quelques tentatives de structuration – une tentative de réforme de l’entreprise lors du septennat de Valery Giscard d’Estaing -, ce n’est que dans les années 1980 qu’apparait l’idée d’une convergence entre performance économique et performance RSE. C’est ce que l’on a appelé le « business case de la RSE ».
Dans les années 1990, après le sommet de RIO (1992), la RSE devient « la version entreprises du développement durable ». Les années 2000 voient l’institutionnalisation de la RSE à travers le Livre vert de la Commission Européenne, la norme Iso 26000 et les Objectifs du millénaire.
En parallèle se développent des formes de plus en plus abouties de « reddition des comptes en matière de RSE », c’est-à-dire de publication par les entreprises d’informations concernant le volet social, sociétal et environnemental de leurs activités. La Global Reporting Initiative (GRI) apparait en 1997. En France la loi Nouvelles Régulations Economiques (NRE) de 2001 instaure une obligation de reporting. 10 ans après, le Grenelle de l’Environnement renforce ce reporting en définissant les parties prenantes et en instaurant une vérification par un tiers indépendant.
En 2017, c’est la transposition d’une directive européenne qui conduit à la Déclaration de Performance Extra Financière (DPEF) et en 2022, la commission européenne publie la Corporate Sustainability Reporting Directive avec le principe de double matérialité « qui permet d’étudier les impacts de l’environnement sur l’entreprise et de l’entreprise sur l’environnement ».
L’auteur consacre aussi un chapitre au devoir de vigilance, « vigilance par rapport à des tiers humains ou non humains, des employés, des partenaires commerciaux, des minorités discriminées, des territoires ou des ressources saccagées ». Il regrette toutefois que « la logique du « dire » l’emporte sur celle du « faire », ou que le rapportage prenne le pas sur la vigilance ».
« Si l’on peut apparaitre être très engagé dans la RSE tout en étant soi-même une partie essentielle des problèmes que la RSE est censé combattre, n’est-ce pas la preuve que la RSE n’est pas le bon moyen de combattre le problème ? ». Ce constat d’échec est l’objet de la deuxième partie de l’ouvrage. Les causes de cet échec sont à rechercher dans 4 domaines :
- « Une utilisation abusive du vocabulaire et parfois même des valeurs de la RSE pour que rien ne change «, dont fait partie ce que l’on appelle le « greenwashing ».
- Le fait qu’à côté d’actions responsables, les entreprises peuvent avoir des actions irresponsables qui sont mal prises en compte dans les notations RSE. On peut penser au scandale ORPEA : « Bien qu’ORPEA ait été plusieurs fois dénoncée pour des pratiques sociales, organisationnelles, professionnelles douteuses, elle avait obtenu de (très) bonnes notations de la part des agences de notation ».
- Le point peut être le plus essentiel, c’est la faiblesse des théories économiques qui empêche « la RSE de produire des effets et d’obtenir les impacts sociaux et environnementaux positifs espérés ». Les théories économiques dominantes qui ne savent pas penser l’espace ni le temps long. « Lorsque les défis sont vitaux, l’utilisation de la théorie économique s’avère incapable d’obtenir les comportements vertueux car elle repose sur des hypothèses irréalistes » en particulier l’homo economicus qui est « une caricature ».
- Le dernier point concerne le droit. Il faudrait un droit plus fort qui ne se contente pas de définir et de réguler, mais « qui prescrit et qui proscrit ».
Comme le souligne les auteurs du préambule de l’ouvrage, « avec des mots choisis et pesés, en termes élégants et feutrés, une forme de colère s’exprime ». Car si la première partie de l’ouvrage montre la montée en puissance de la RSE, on réalise, comme l’analyse Jacques Igalens dans la deuxième partie, la distance énorme entre l’idéal affiché par la RSE et la réalité du terrain.