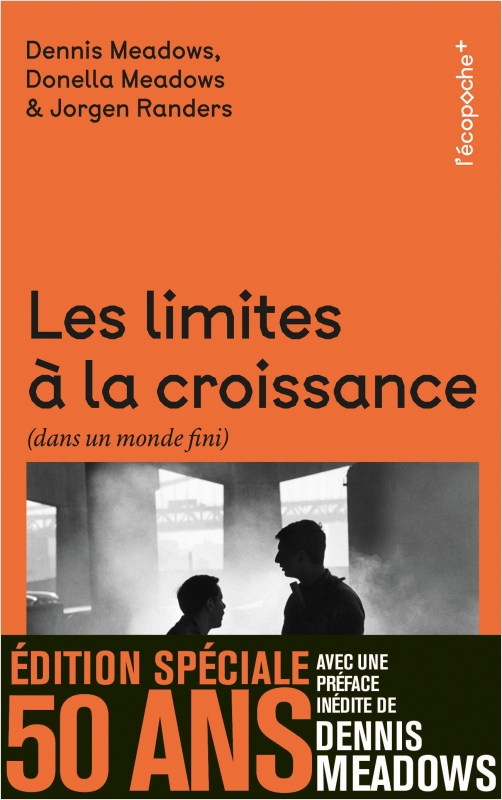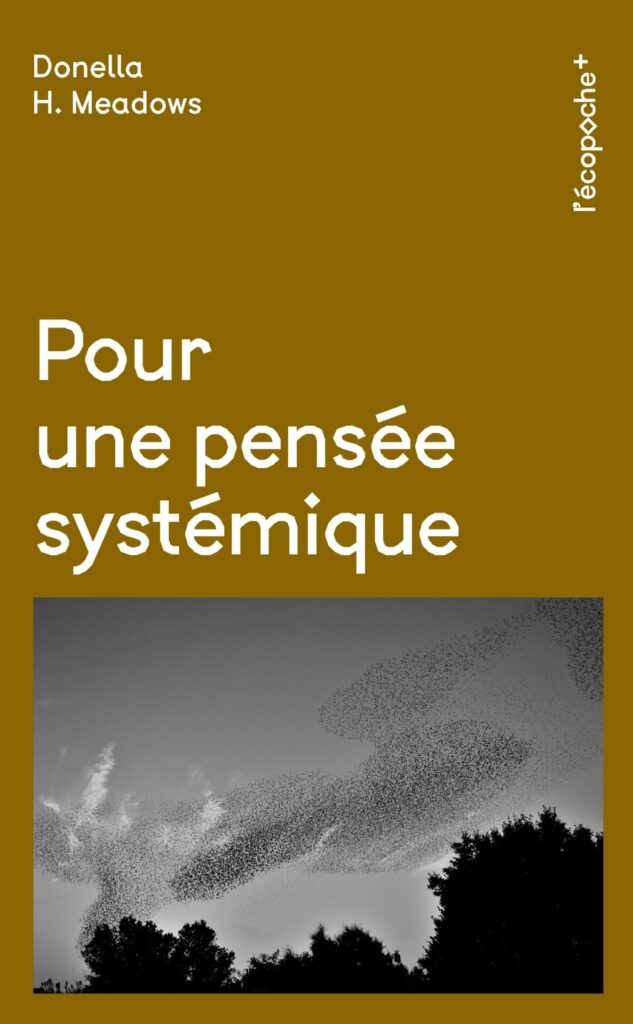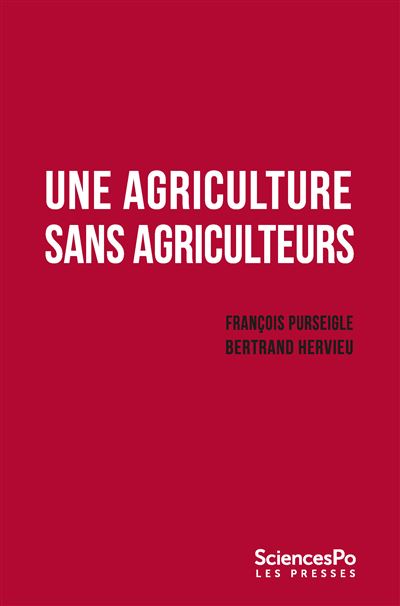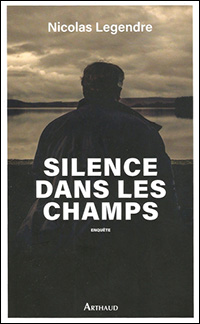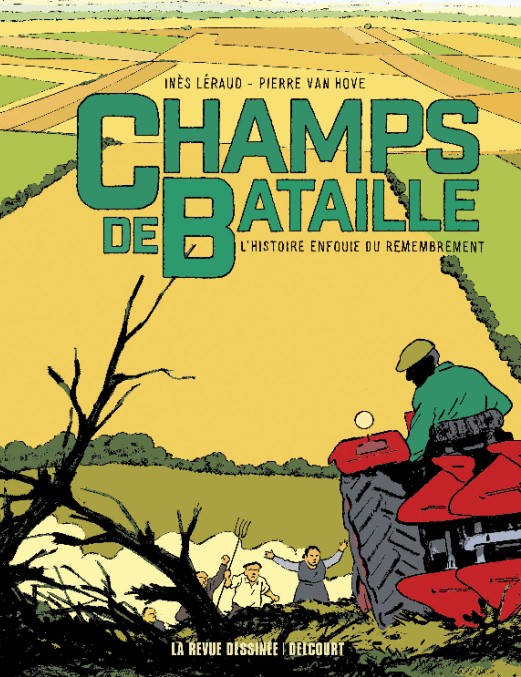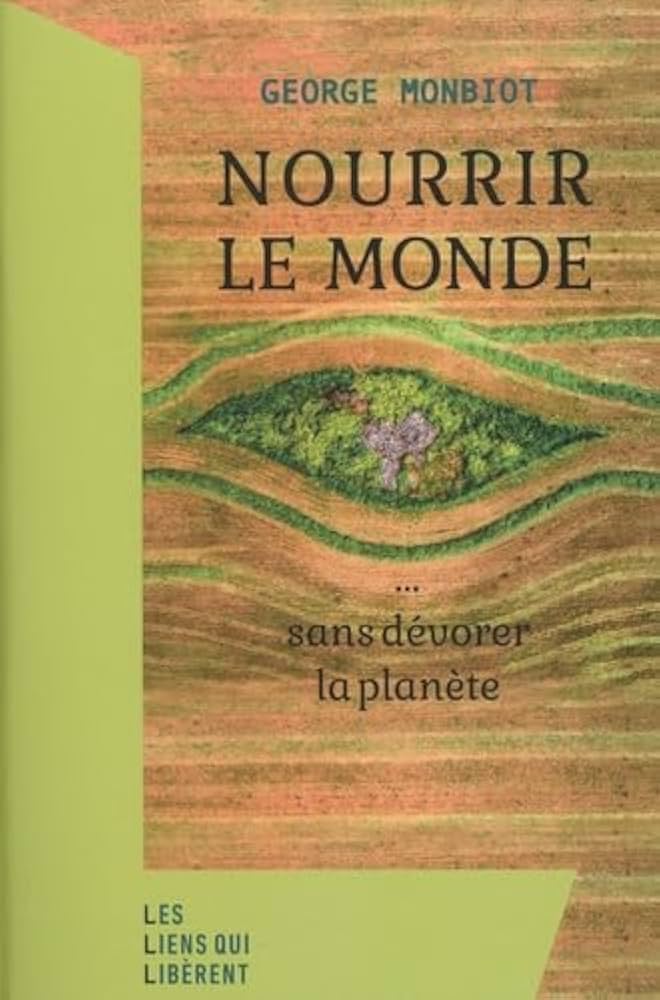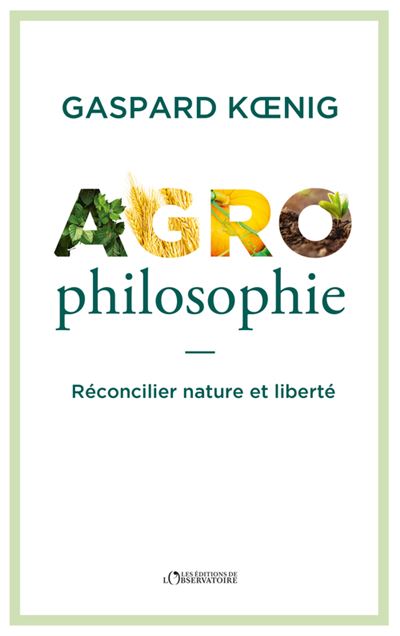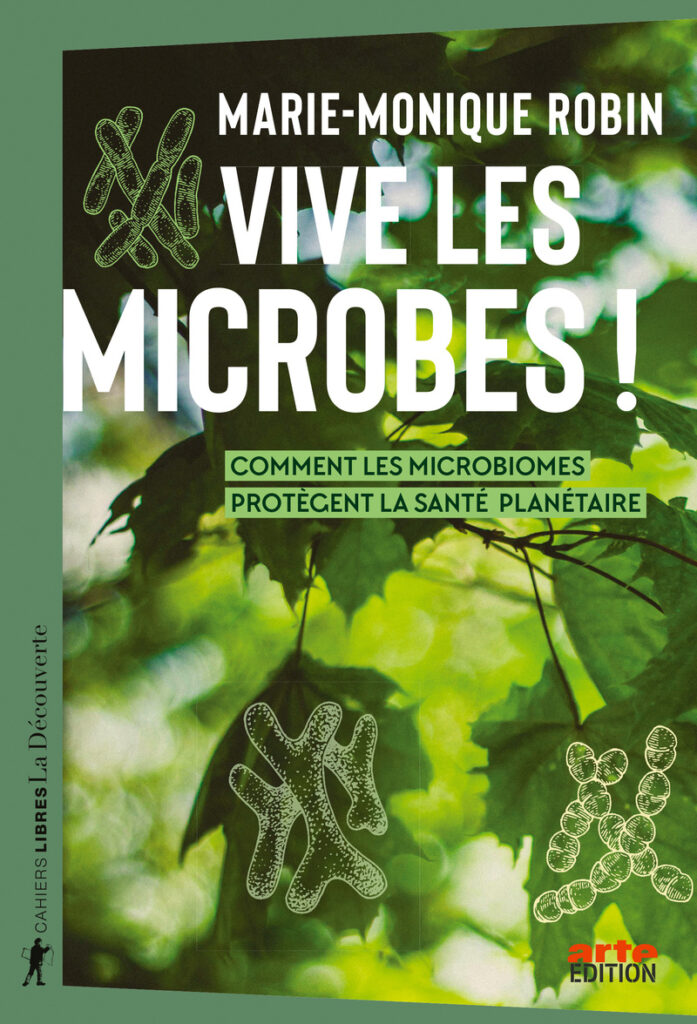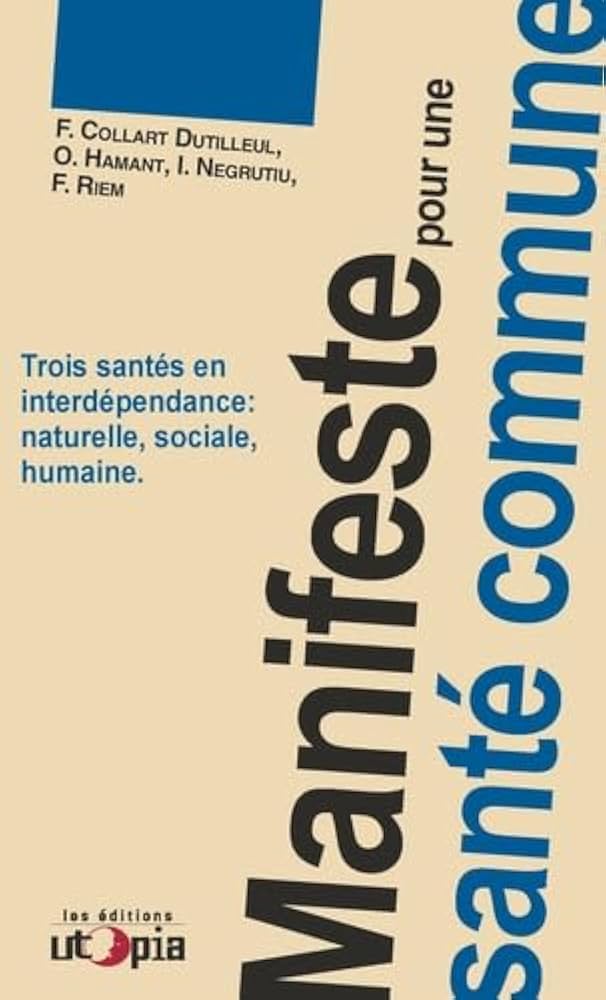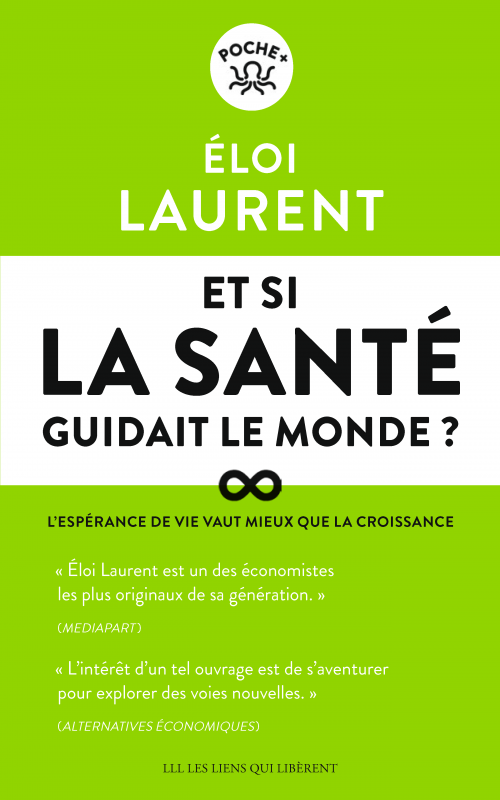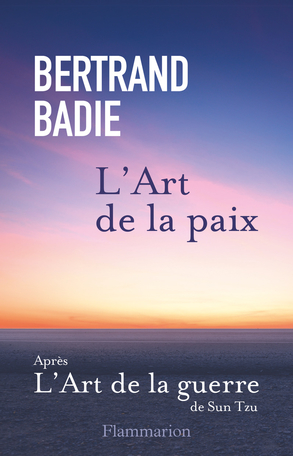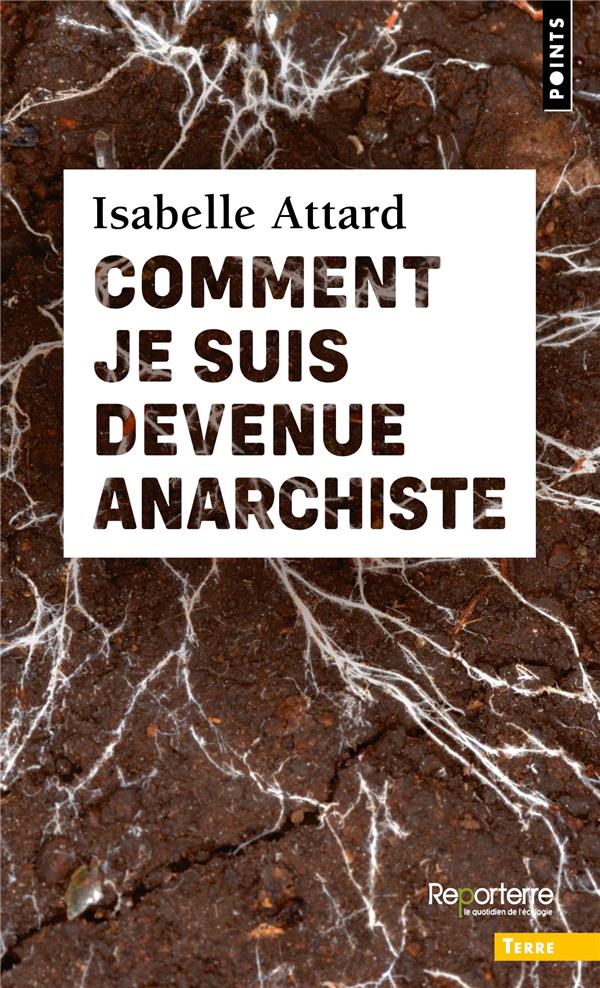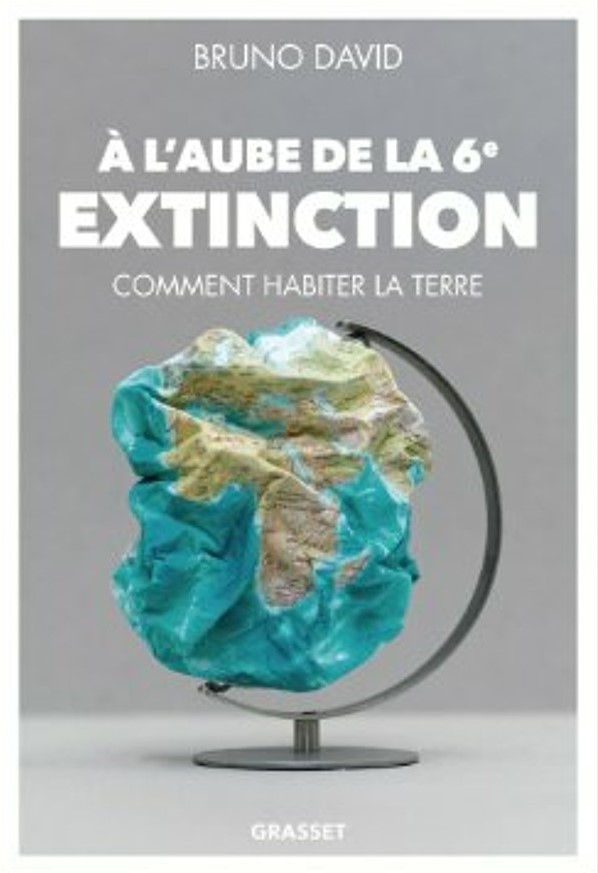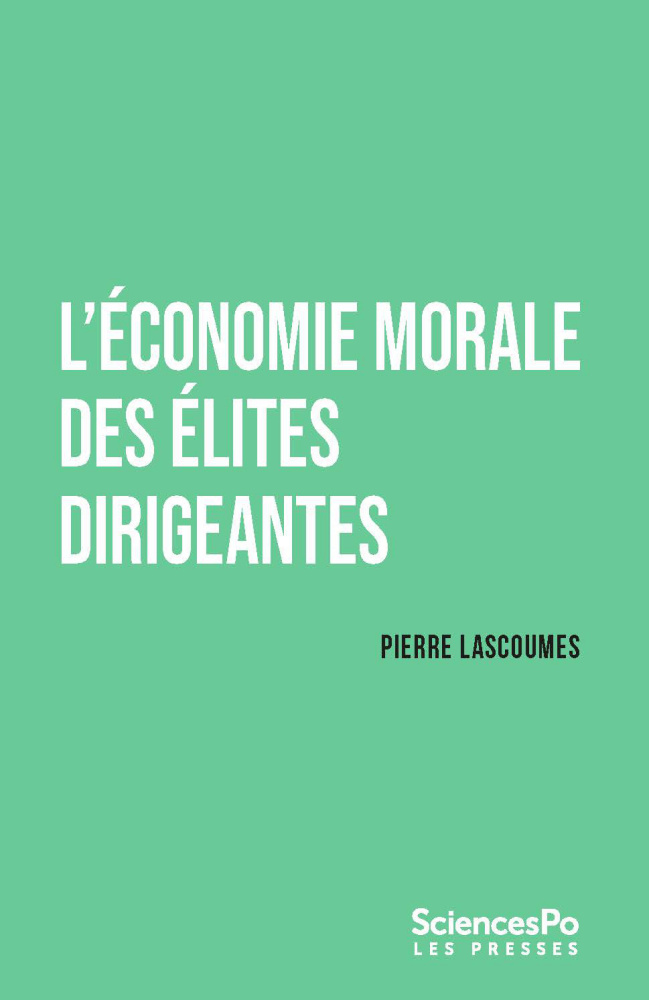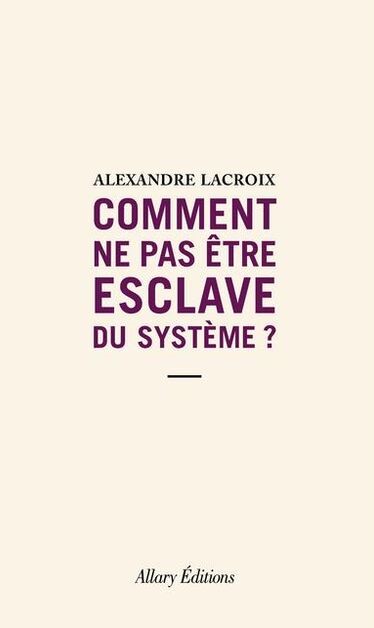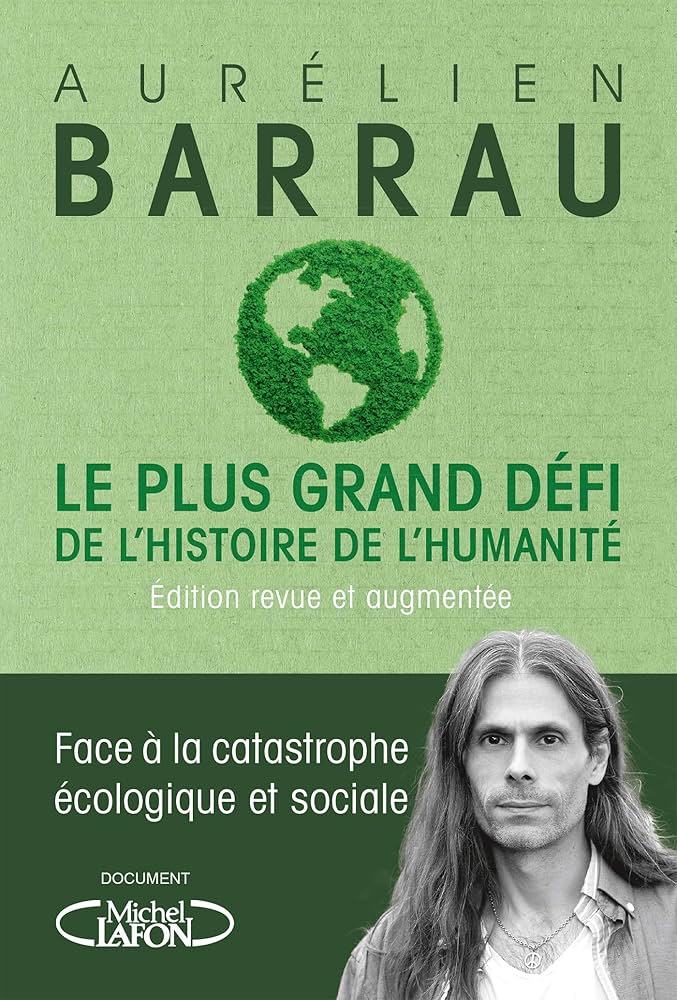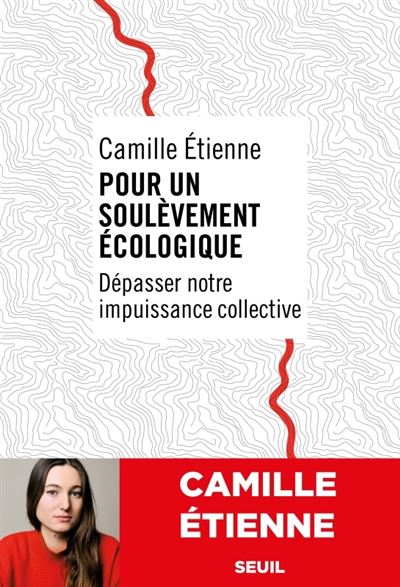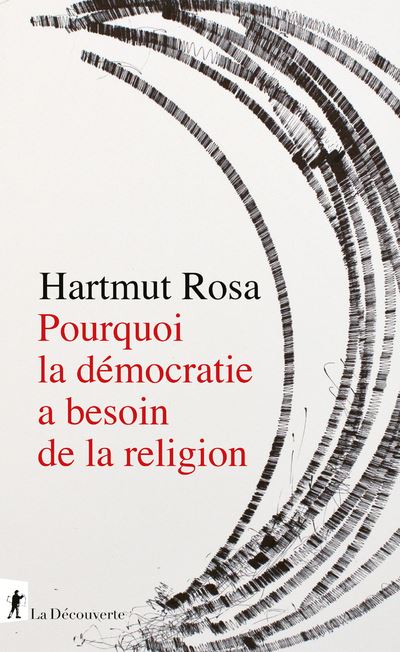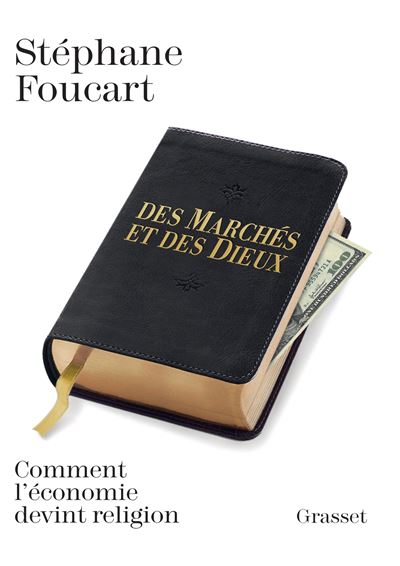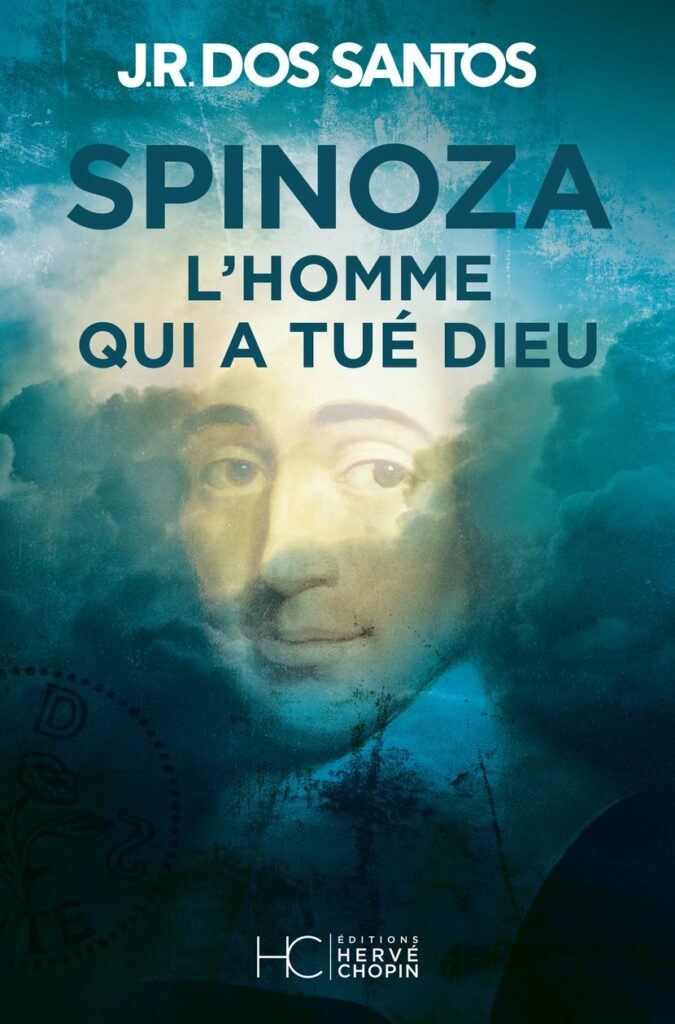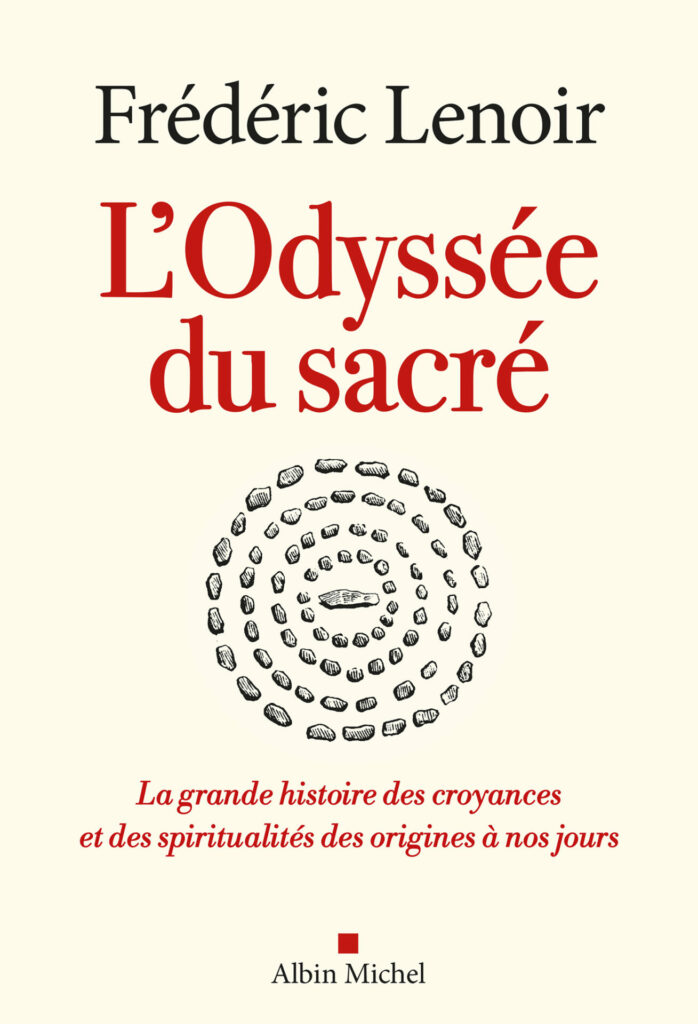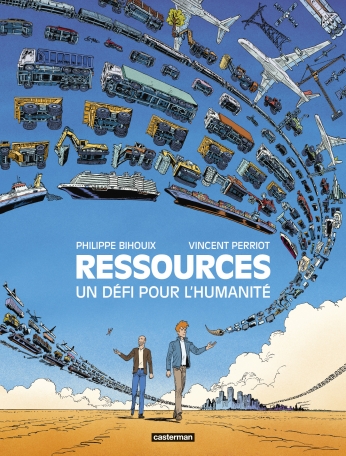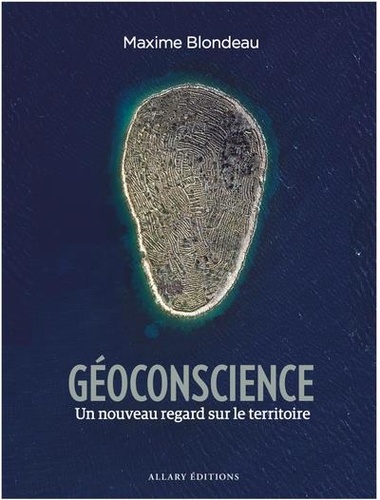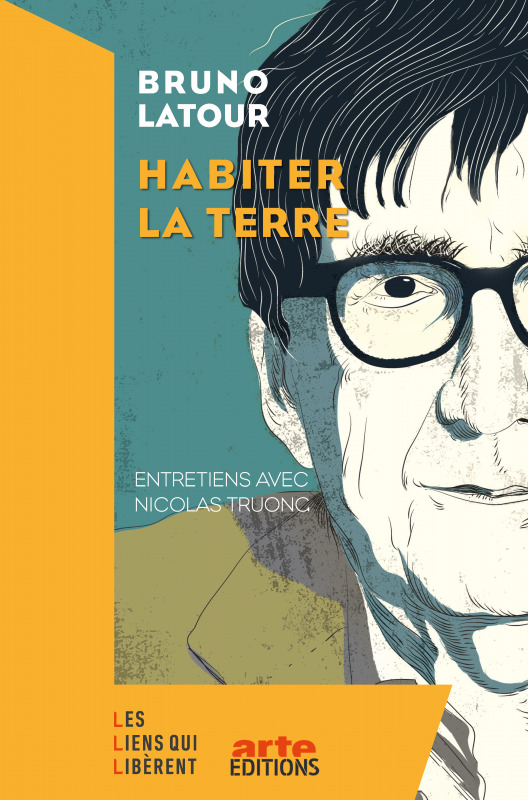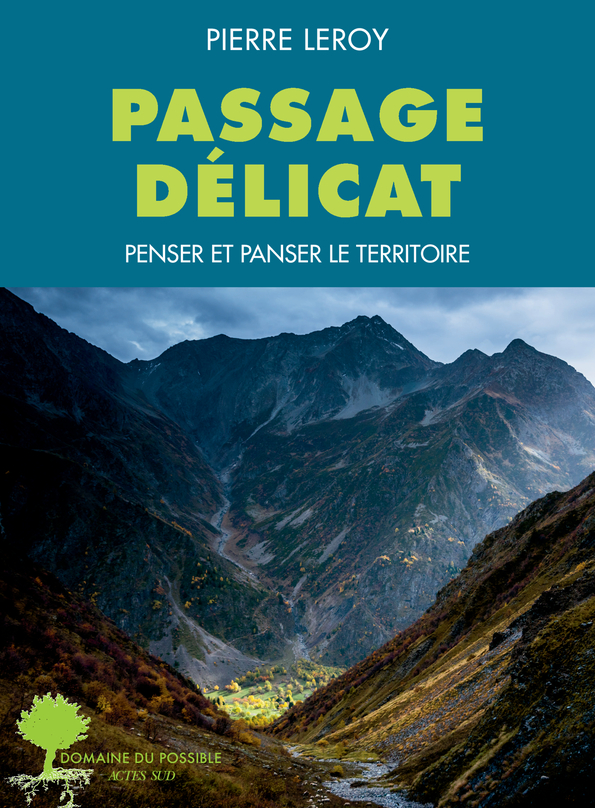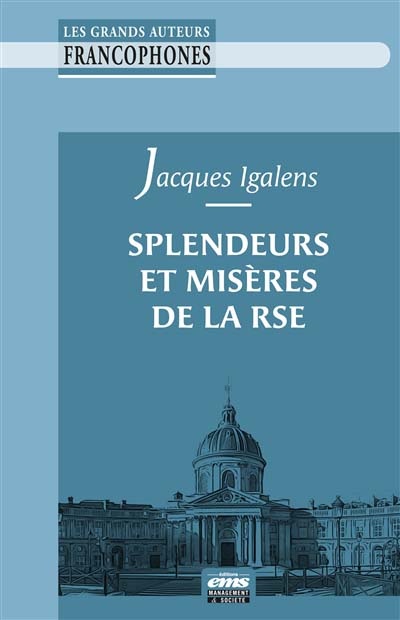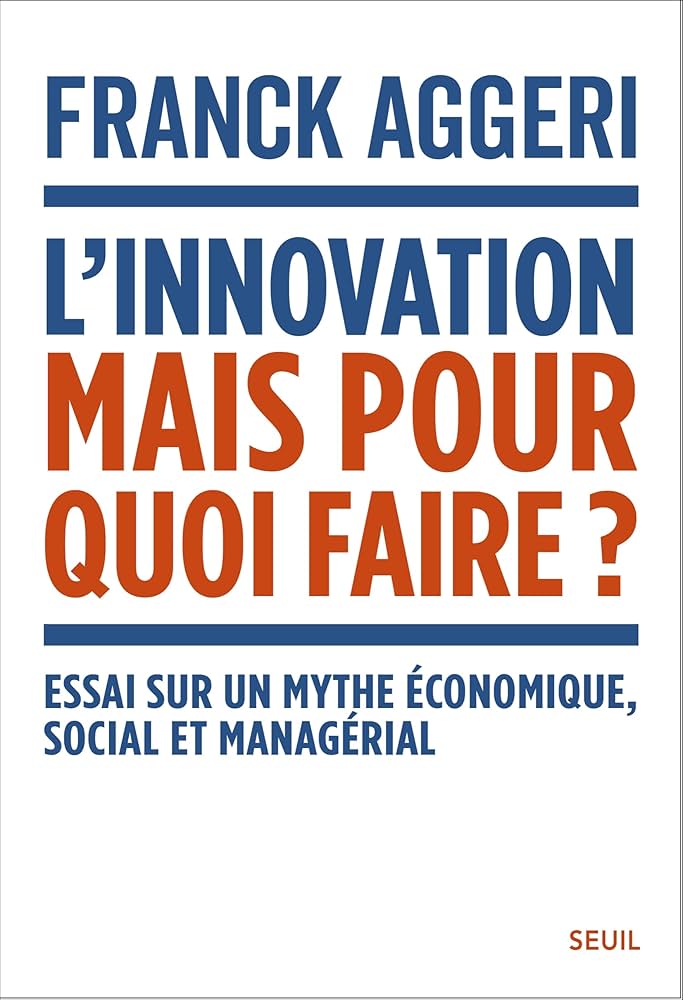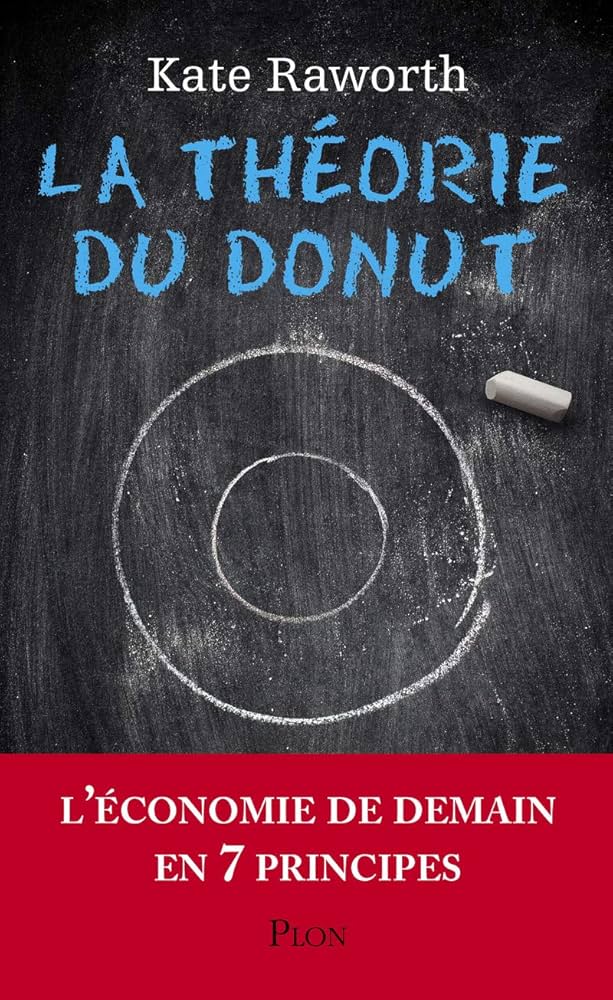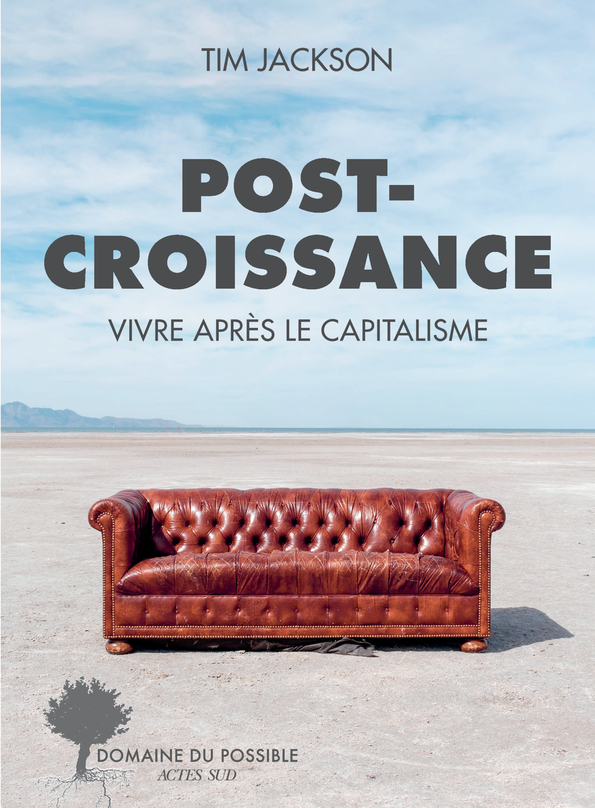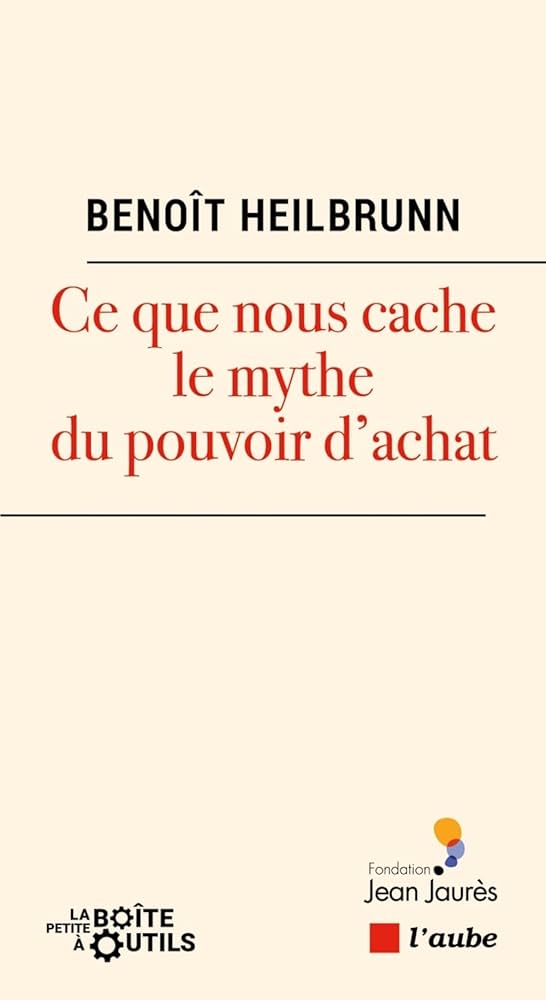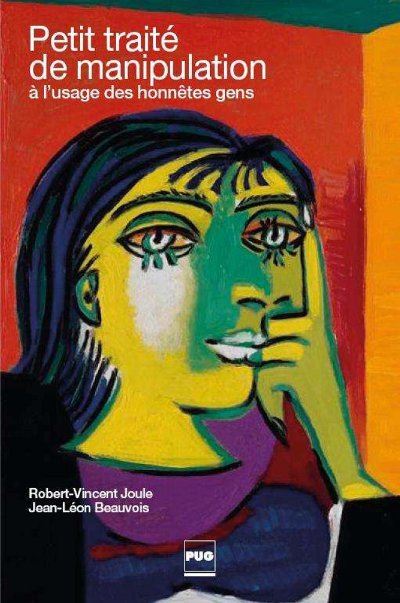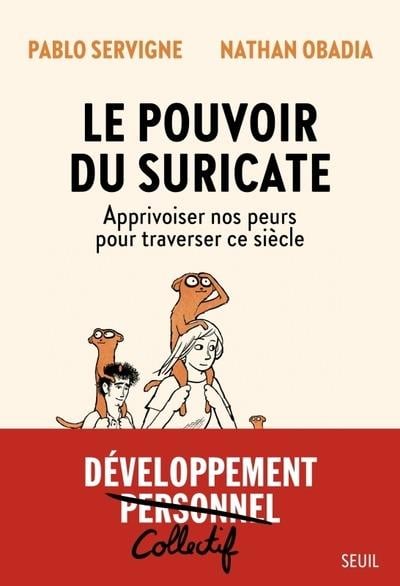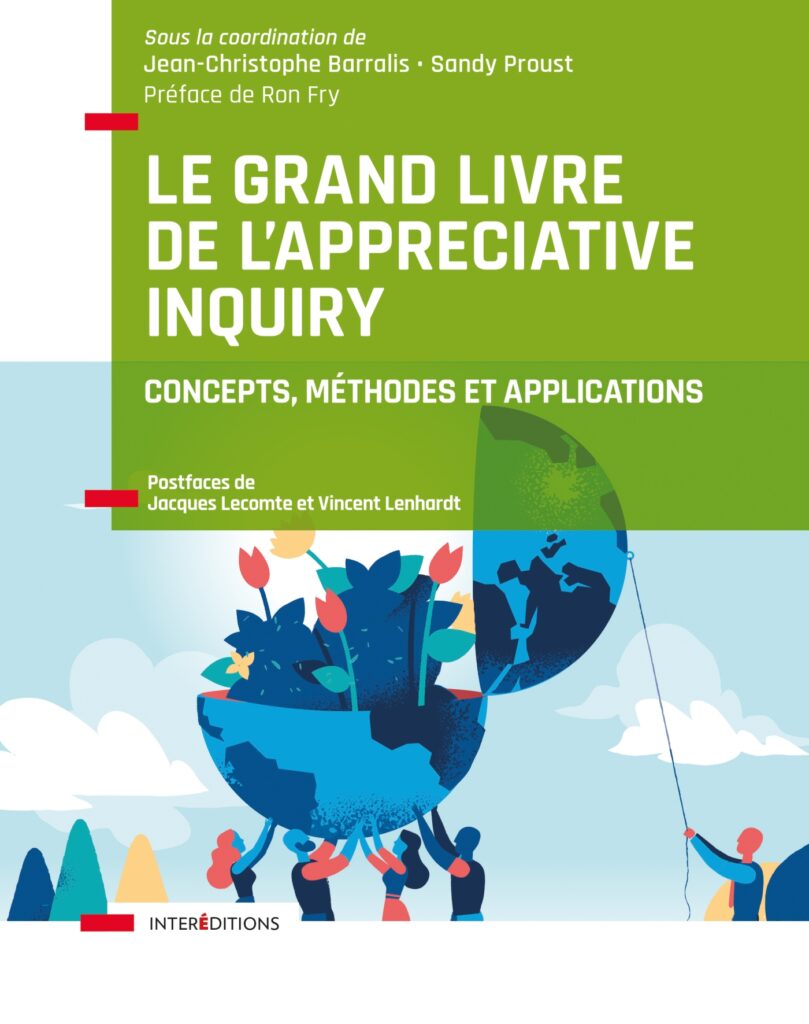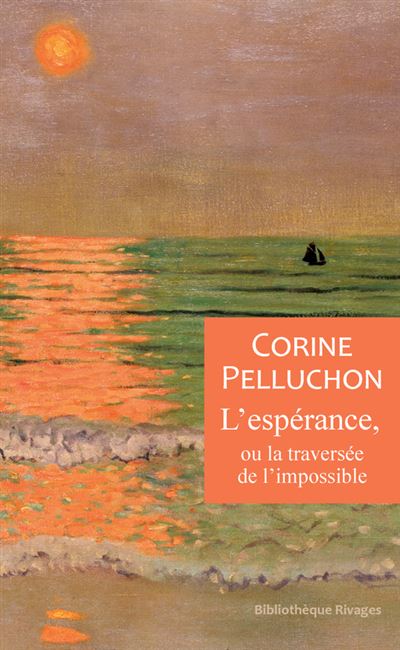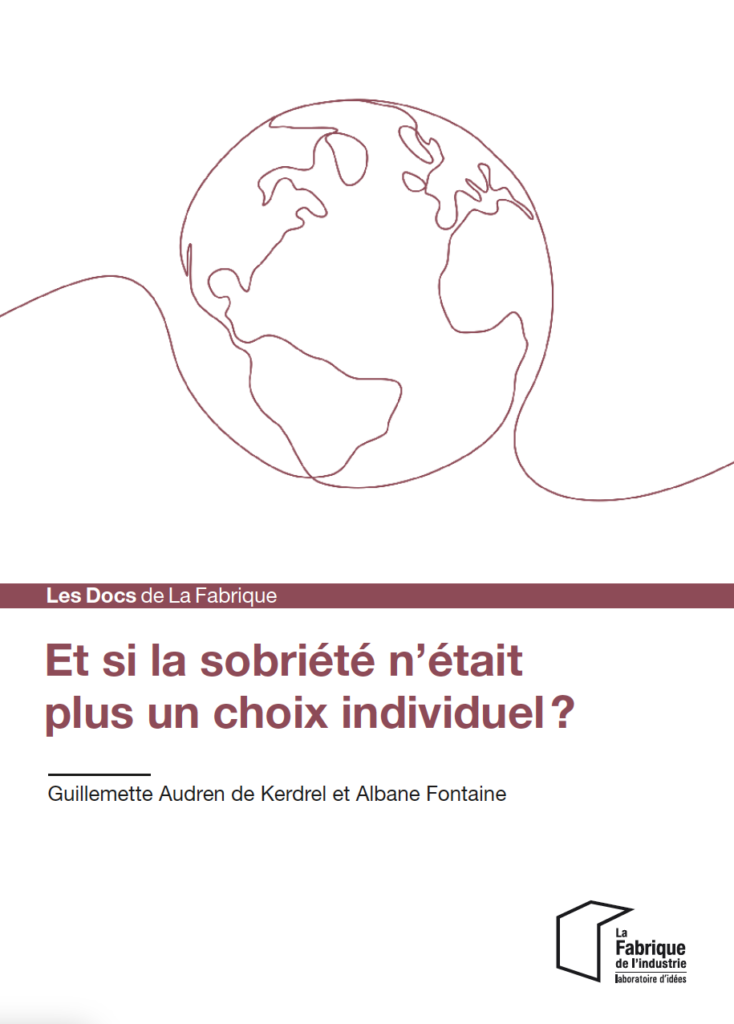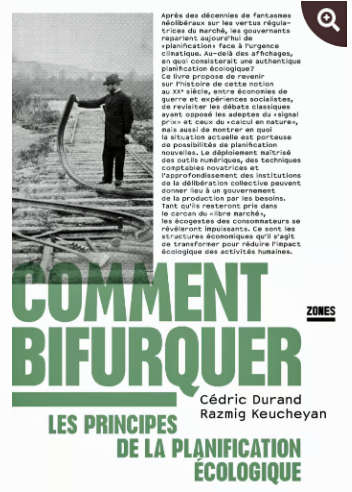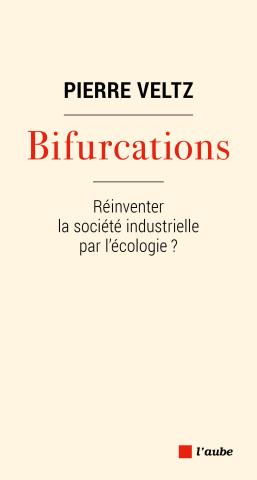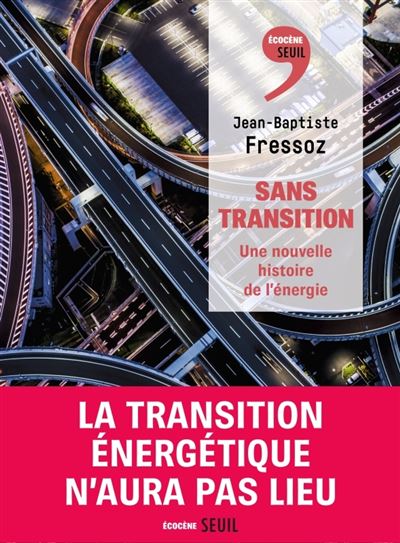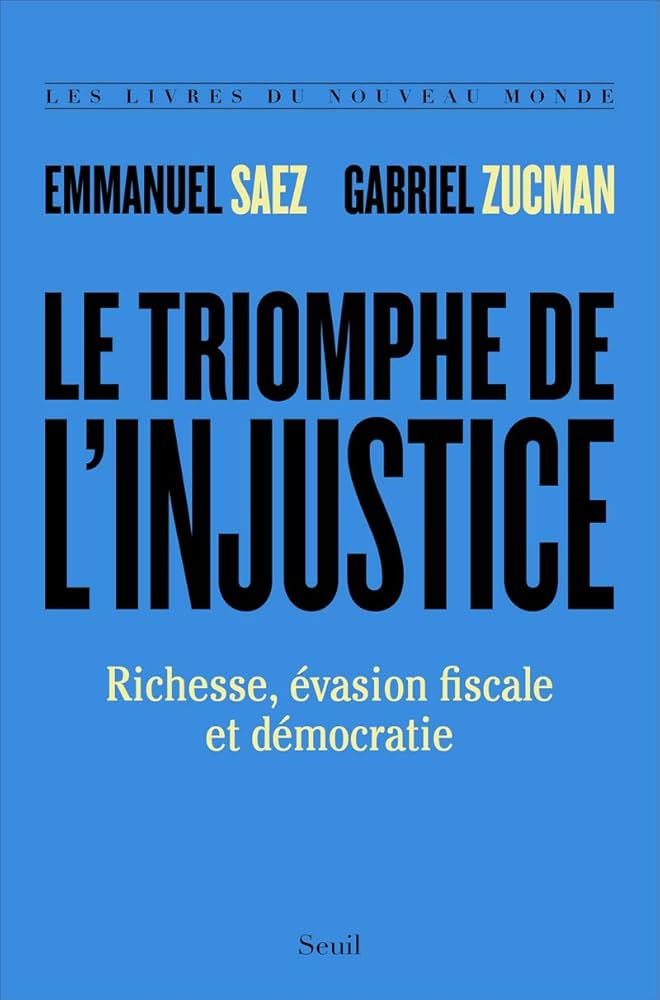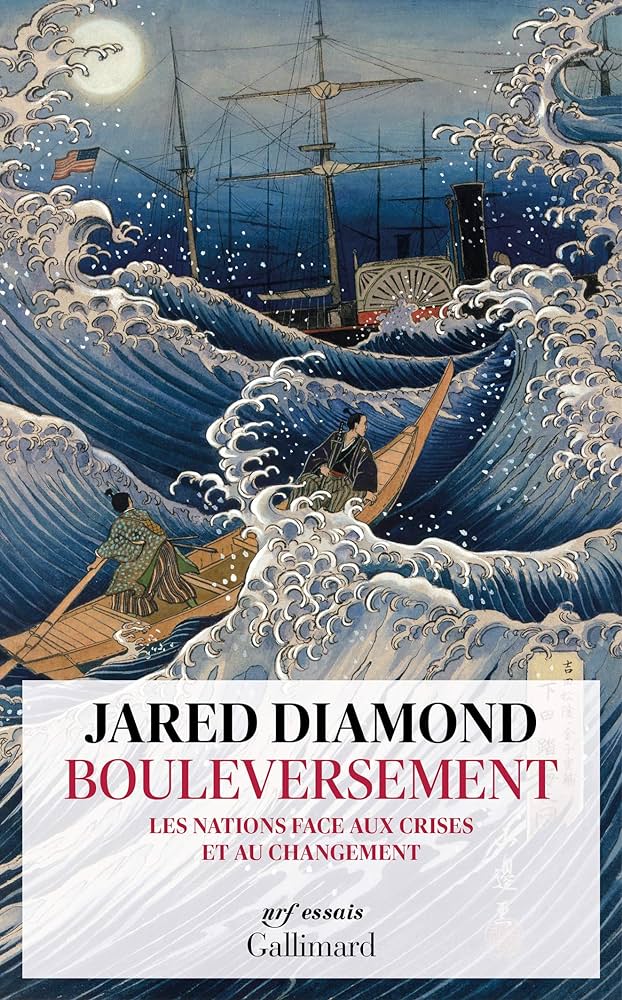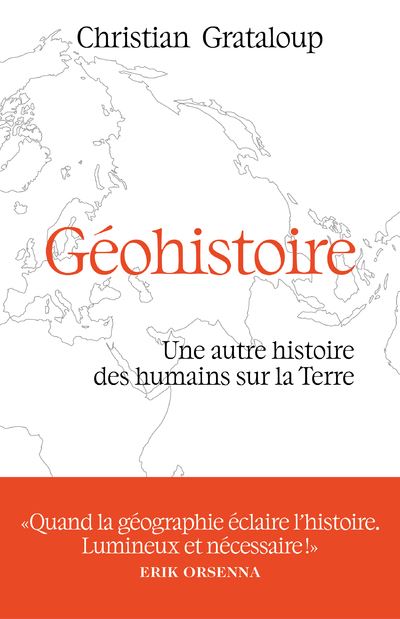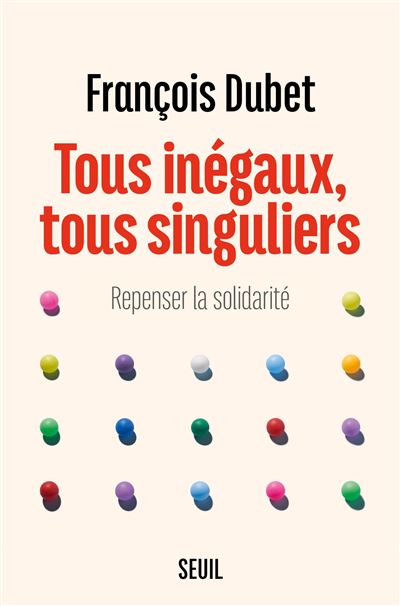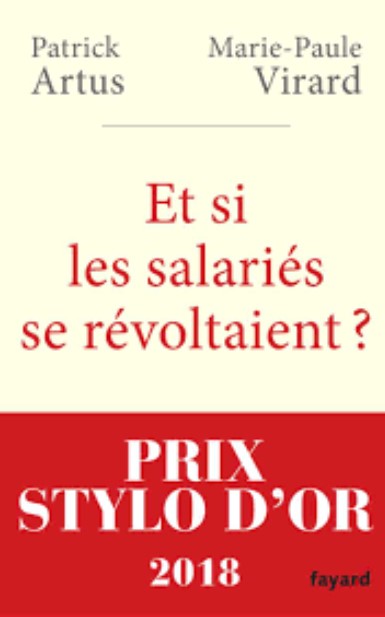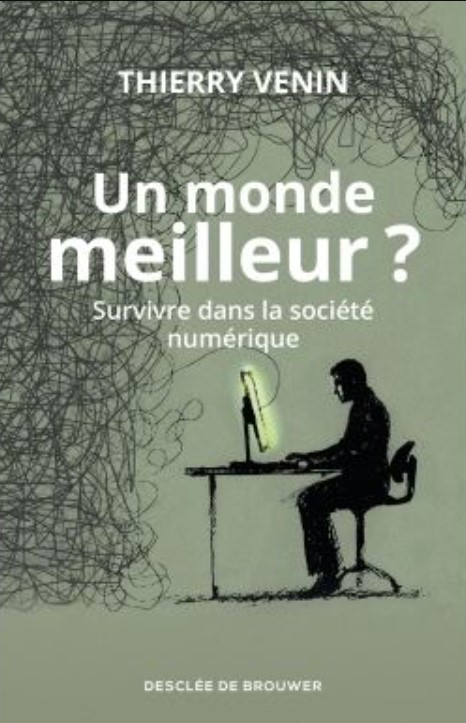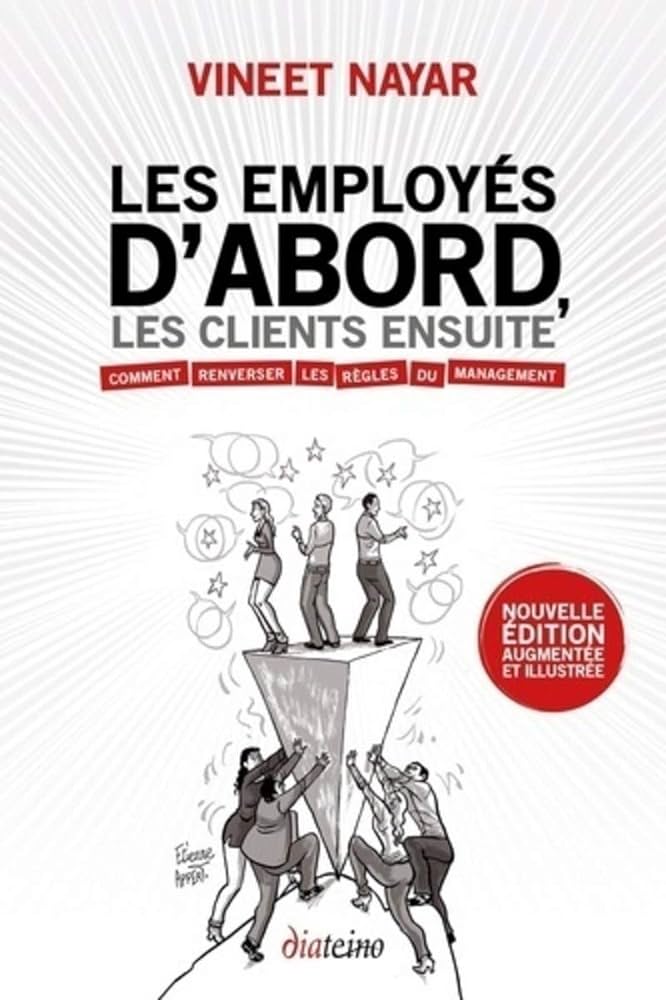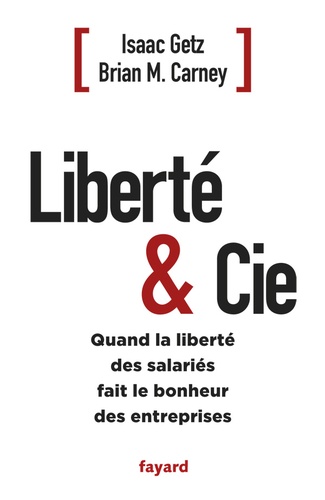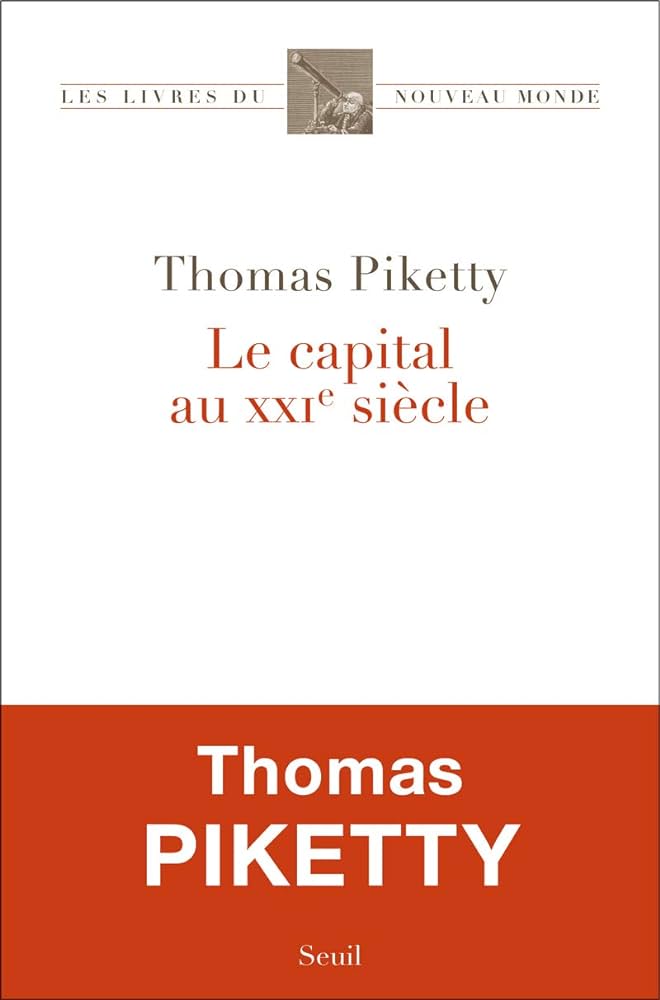L’espérance de vie vaut mieux que la croissance
Eloi Laurent, Editions Les Liens qui Libèrent, 2021
Le 7 avril 2020, la moitié de l’humanité était confinée et l’économie mondiale quasi arrêtée dans le but de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19. Pour l’économiste Eloi Laurent, cette date est importante car ce jour-là, « l’économie – à la fois comme organisation sociale et comme système de pensée – était donc enfin remise à sa juste place ». Et il tire de l’épidémie de COVID une leçon implacable : « détruire le monde vivant est un suicide social et accessoirement une folie économique dont nous n’avons pas les moyens ». Partant de ces constats, Eloi Laurent nous propose dans son essai de nouvelles boussoles pour nous orienter : l’espérance de vie et la pleine santé.
L’introduction nous propose une analyse de l’espérance de vie, indicateur qui permet de tenir compte à la fois des inégalités sociales et des crises environnementales : « On comprend difficilement pourquoi ce n’est pas l’espérance de vie qui guide les politiques publiques au 21ième siècle en lieu et place du défaillant produit intérieur brut et de son aveuglante croissance. Les deux impensés majeurs du PIB et de la croissance que sont les inégalités sociales et les crises écologiques, l’espérance de vie permet de les percevoir au moins en partie »
La première partie « de l’économie à la santé de l’économie », l’auteur se livre à une critique de la démarche de l’économie qui est « une science par procuration qui se cherche depuis un siècle des modèles qu’elle imite dans l’espoir de paraitre leur ressembler et de pouvoir endosser leurs habits de respectabilité ». Le modèle le plus récent pour les économistes, c’est la médecine : ils prétendent « ausculter, diagnostiquer et soigner le corps social ». Ce qui a conduit les économistes à mettre la santé « en coupe réglée par les outils de gestion économique » et, en appliquant la logique cout – bénéfice, à générer des « dégâts éthiques considérables ». On voit donc apparaitre des actions d’économie de la santé qui reviennent à faire des économies sur la santé au nom d’indicateurs qui réalisent « la conversion de la qualité de vie en rentabilité monétaire ». La santé est aussi souvent vue comme un capital humain, « un stock d’actifs, se dépréciant avec le vieillissement, dans lequel les individus peuvent choisir d’investir des soins pour obtenir un rendement qu’ils désirent » … pour mieux alimenter la machine économique.
Et le paradoxe quand on parle de santé, c’est que ce qui préoccupe le plus les gouvernants, c’est la santé… de l’économie : « L’impérialisme de la discipline économique prend une tournure tragi-comique quand, finalement, la santé de l’économie devient le sujet de préoccupation des pouvoirs publics et de la presse en lieu et place de la santé des personnes ».
Après cette analyse critique, l’auteur se veut constructif en précisant à la fois « son cadre d’analyse et les politiques publiques concrètes auxquelles il pourrait conduire ».
Le cadre d’analyse, c’est « la pleine santé ou la boucle sociale écologique ». Il faut passer de l’« ancienne alliance entre l’économie et le social qui a dangereusement ignoré l’écologie vers une nouvelle alliance entre l’écologie et le social qui remette l’économie à sa place ». Et « il y a du travail », nous dit l’auteur, car les économistes s’intéressent très peu à l’écologie. « L’enjeu est bien de saisir l’interrelation, l’articulation, l’imbrication et non la simple juxtaposition ou mise en parallèle entre systèmes sociaux et systèmes naturels ». Pour cela l’auteur nous propose une boucle sociale-écologique qu’il détaille dans la suite du chapitre.
Pour rentrer dans le concret Eloi Laurent propose dans la troisième partie les éléments pour bâtir « un Etat Social-écologique libéré de la croissance visant la bonne santé », un état financé par des économies de dépenses sociales générées par la protection de l’environnement. L’auteur prend pour exemple les nombreuses maladies infectieuses qui ont été éradiquées par des politiques environnementales ambitieuses (systèmes d’eau potable et d’égout par exemple), ou la réduction de la pollution de l’air grâce à la règlementation, mesures qui ont diminué le cout social du maintien en bonne santé. « L’État social-écologique libéré de la croissance n’est donc pas un luxe post-matérialiste : c’est une nécessité économique ».
Pour rentrer dans le détail de la mise en œuvre de cette transition sociale – écologique, l’auteur zoome sur le cas des villes qu’il analyse selon 4 axes mobilité-environnement-santé, justice sociale et environnementale, qualité de vie, empreinte et vulnérabilité. Il applique sa grille d’analyse au cas particulier de Paris.
Mais « transitions écologiques et sociales ne peuvent devenir compatibles sans décélération de la transition numérique » nous dit l’auteur en prenant l’exemple de la Californie « qui peut devenir le centre inhabitable de l’économie mondiale ».
« Aux antipodes d’indicateurs économiques qui ne disent plus rien à personne, la pleine santé a le pouvoir d’apaiser, de guérir, de réparer », nous dit l’auteur en conclusion de son essai.
Un essai un peu brouillon dont je suis ressorti à la fois enthousiasmé par les idées proposées, séduit par le sens de la formule de l’auteur, mais un peu perdu par toutes les pistes ouvertes mais pas approfondies.