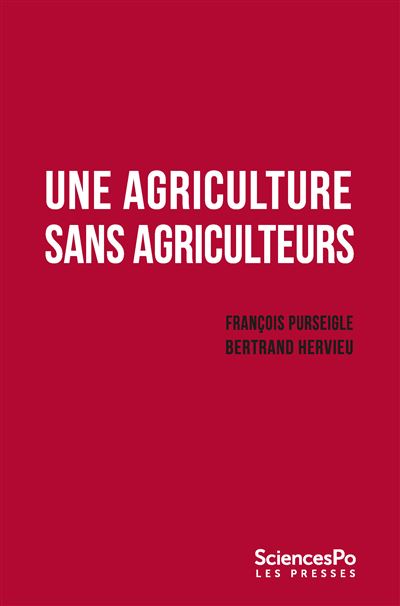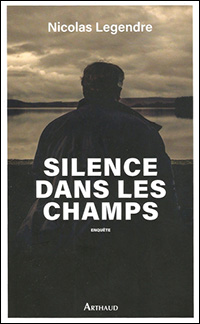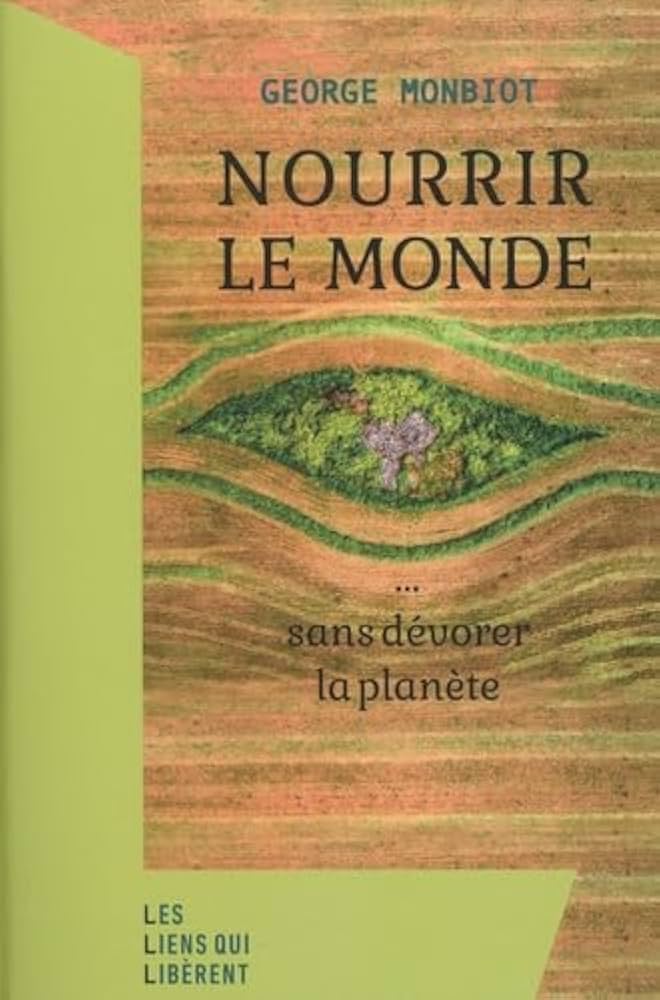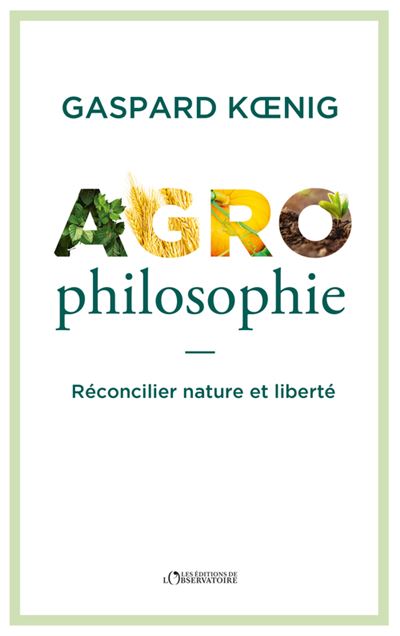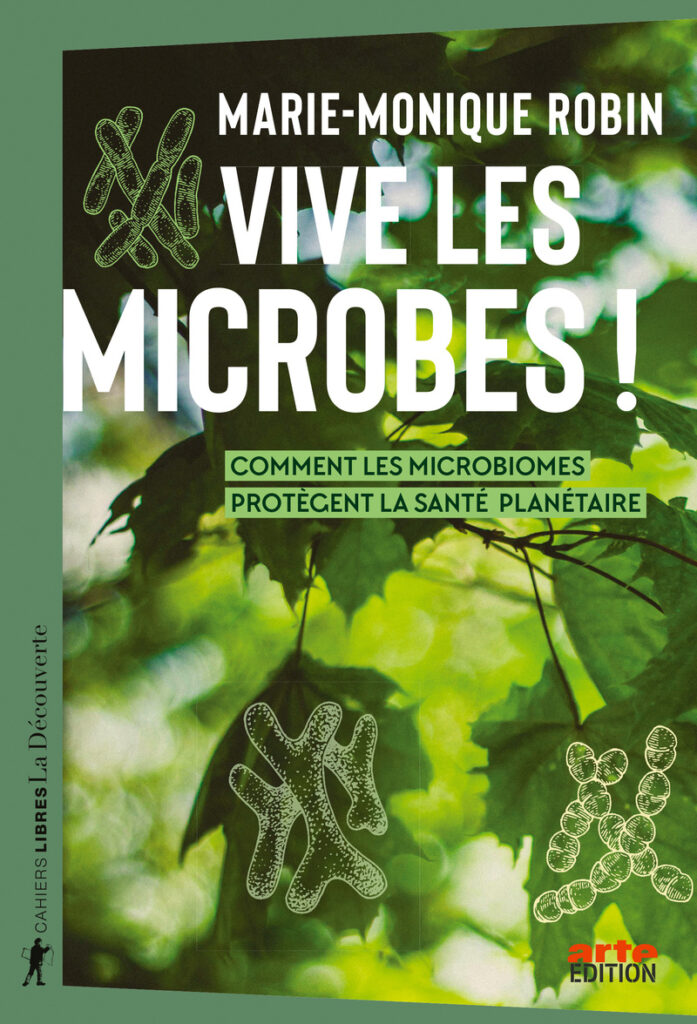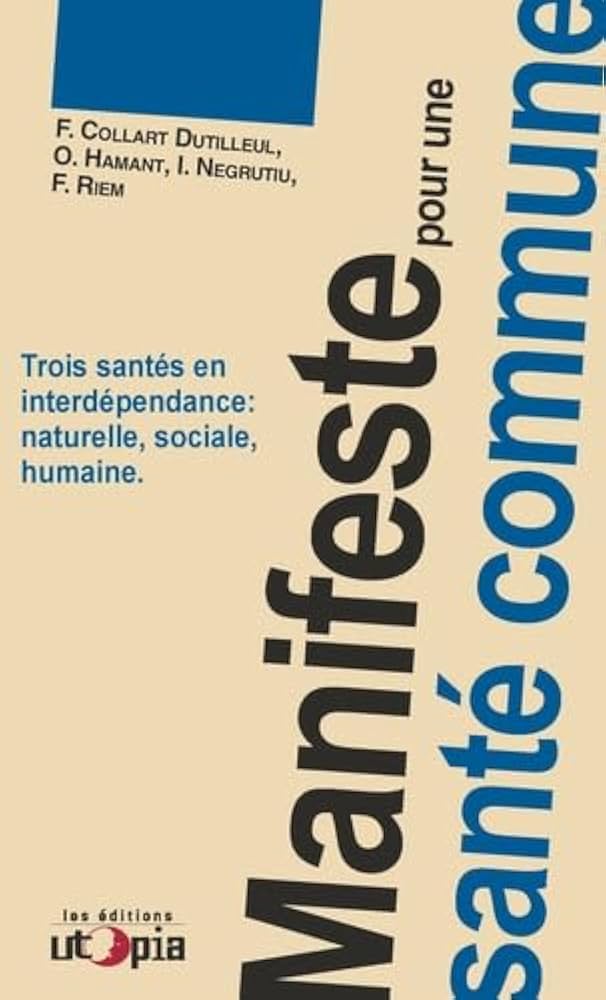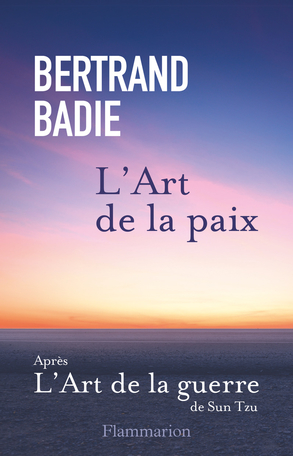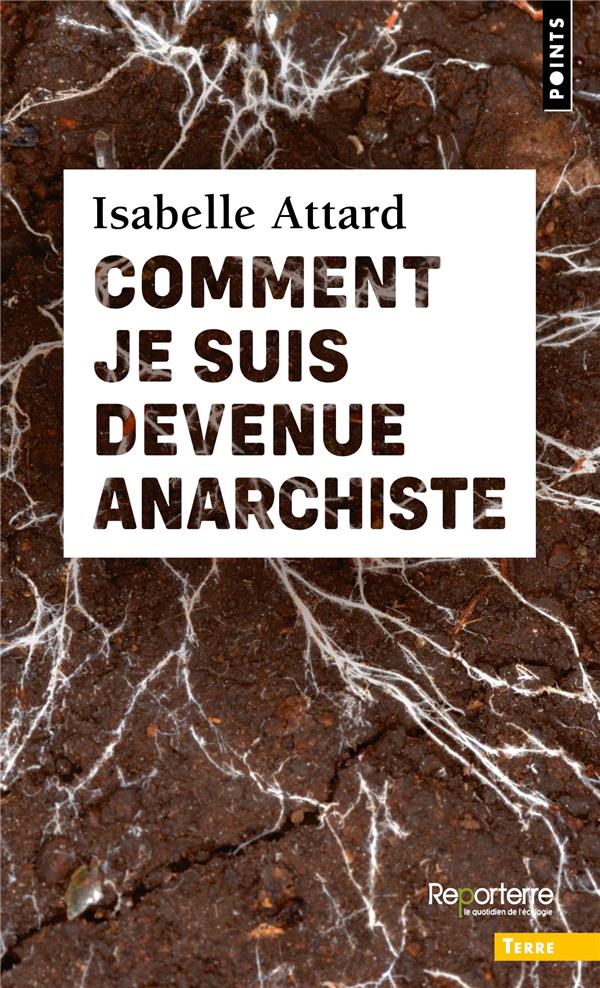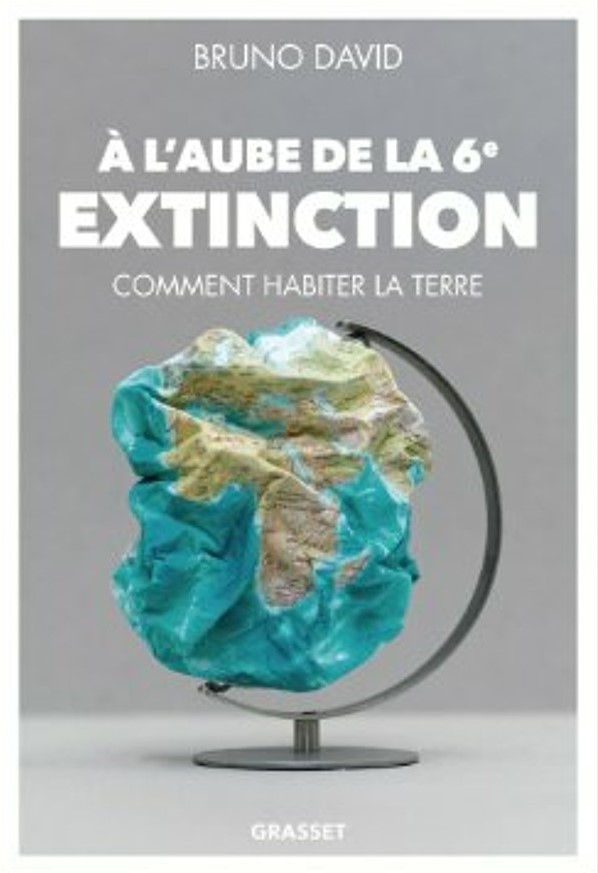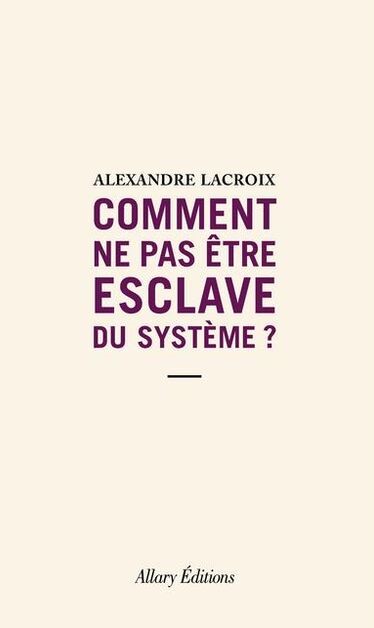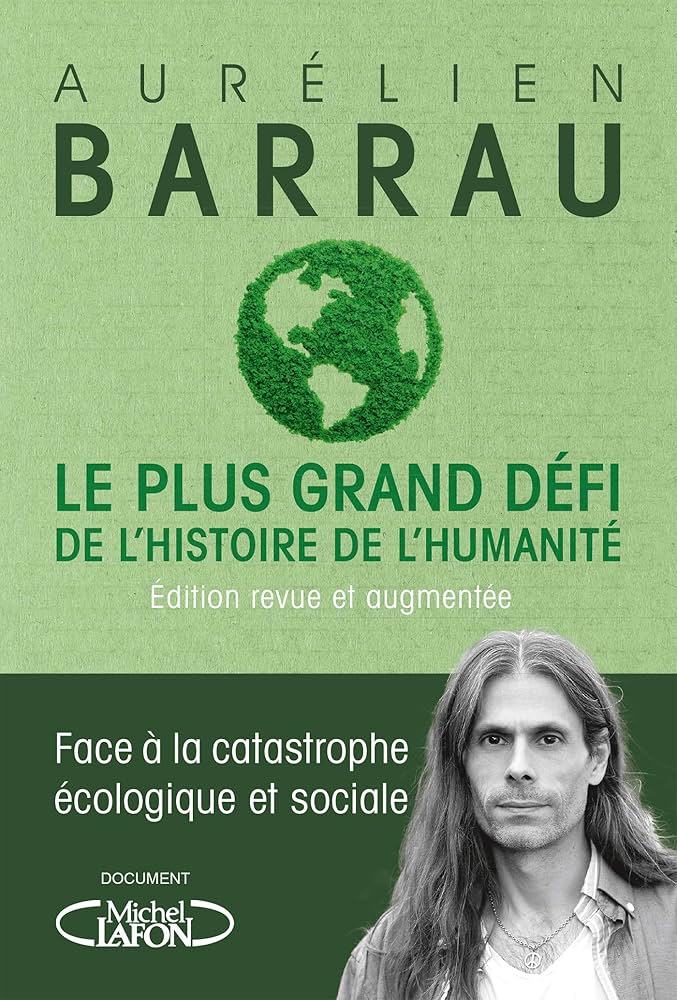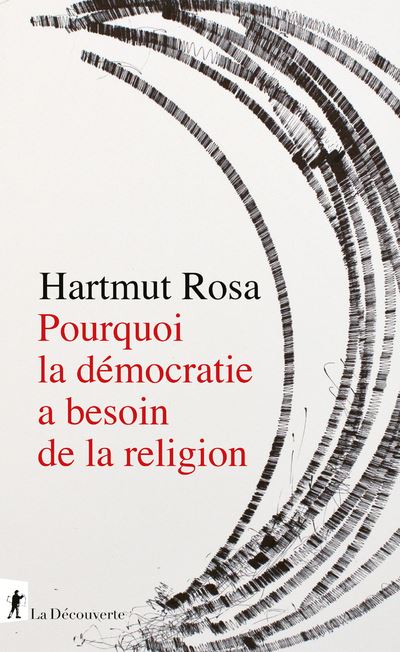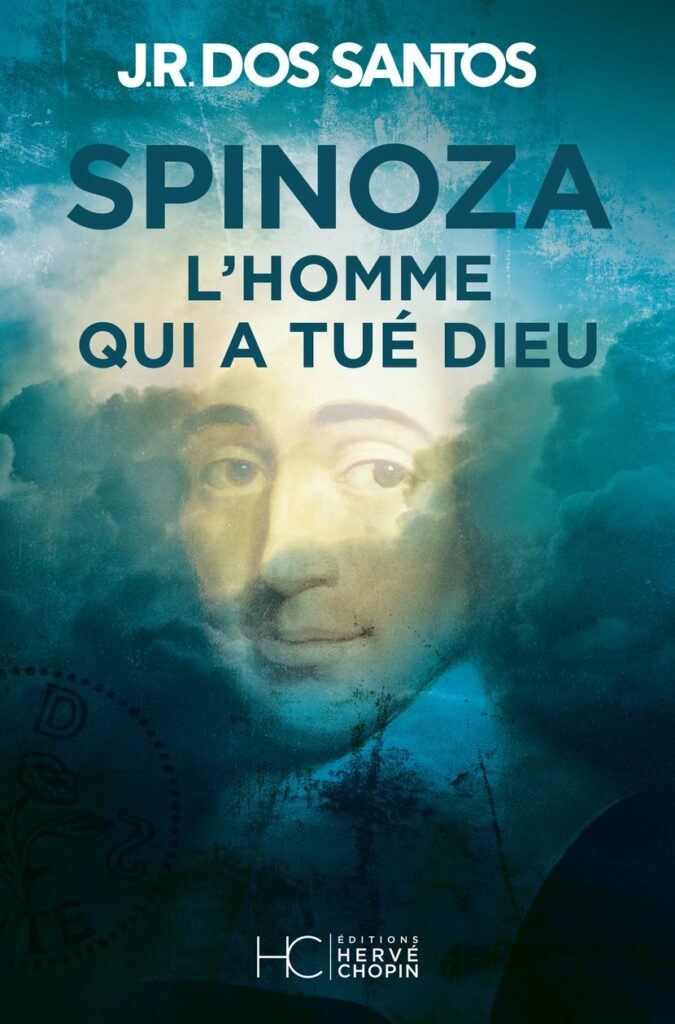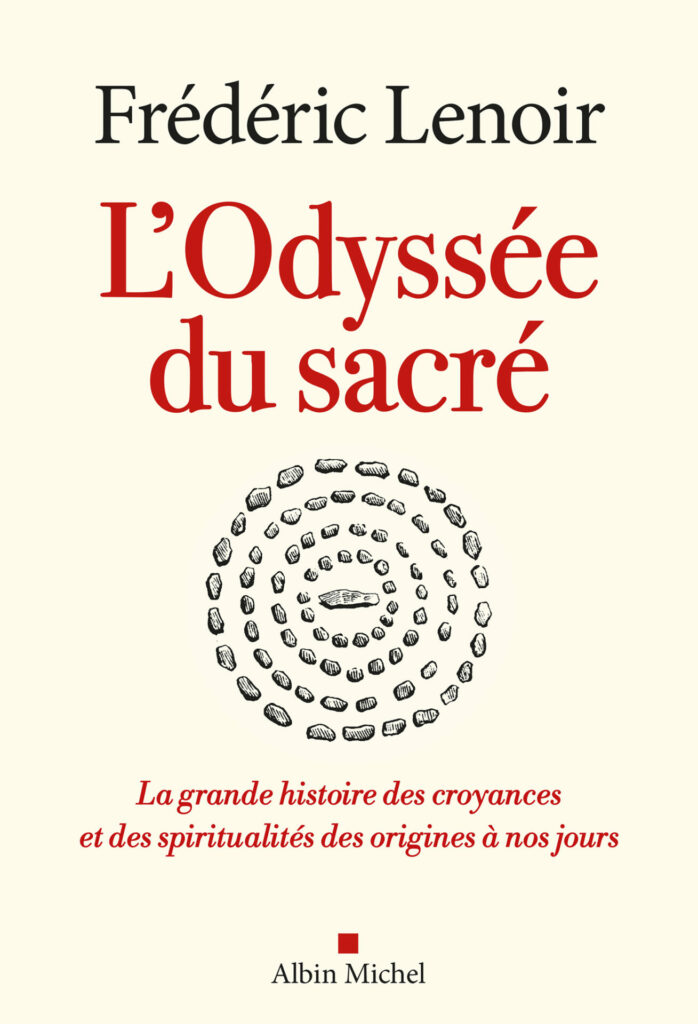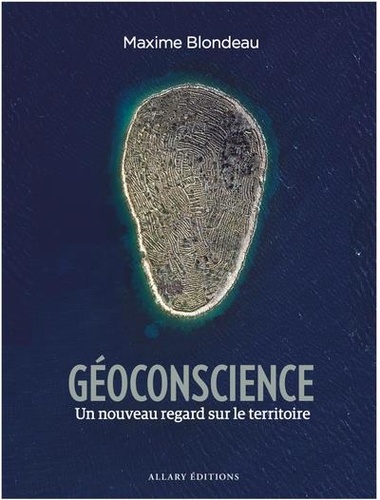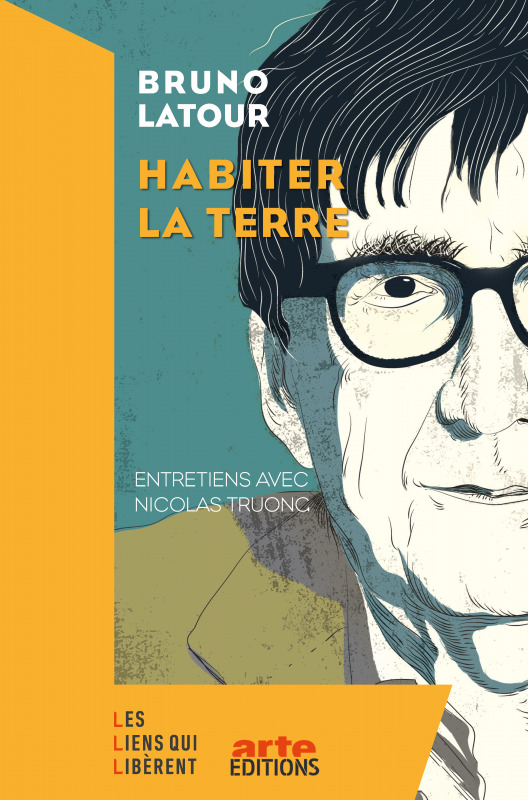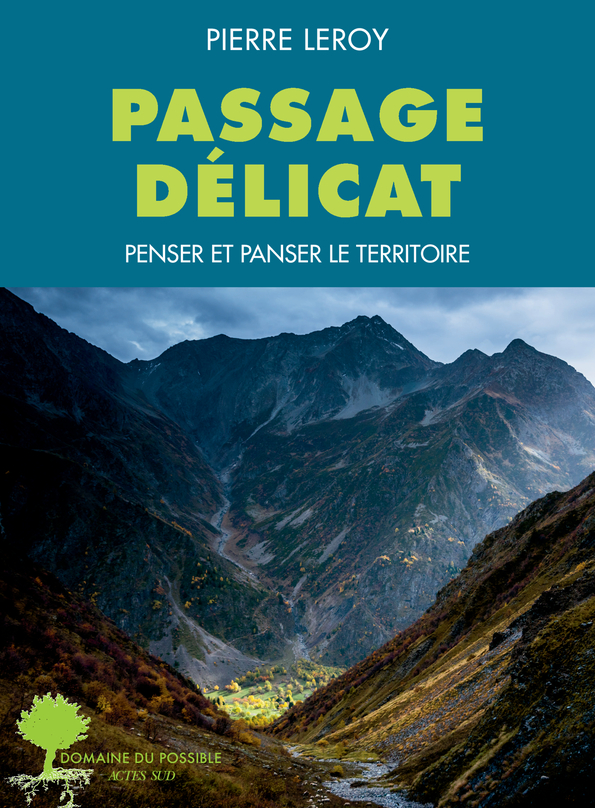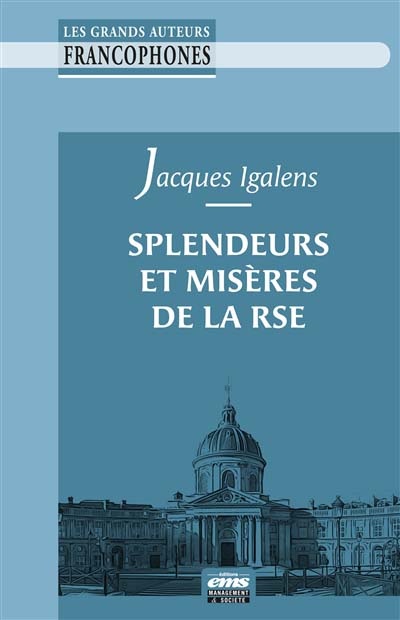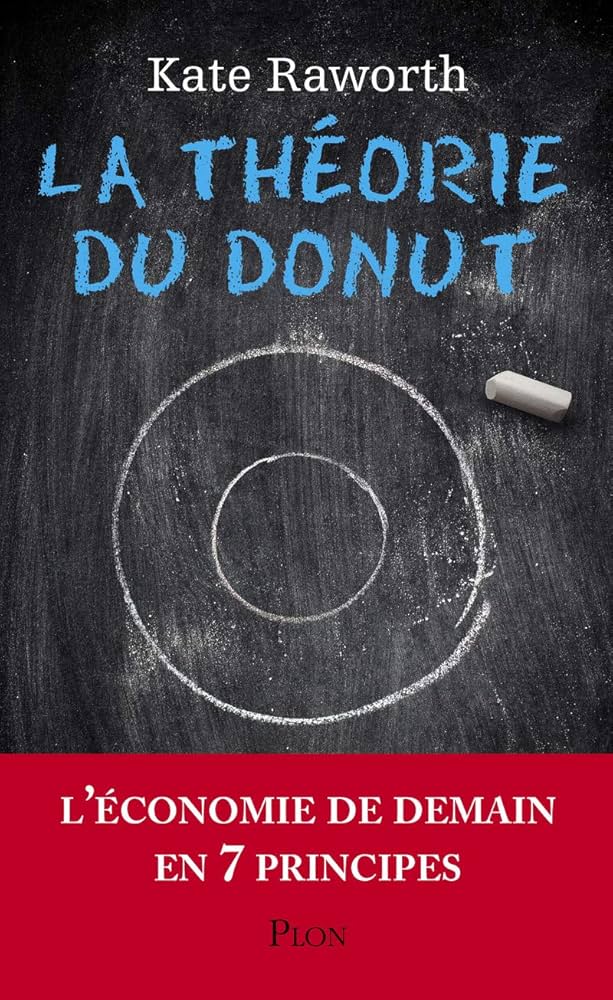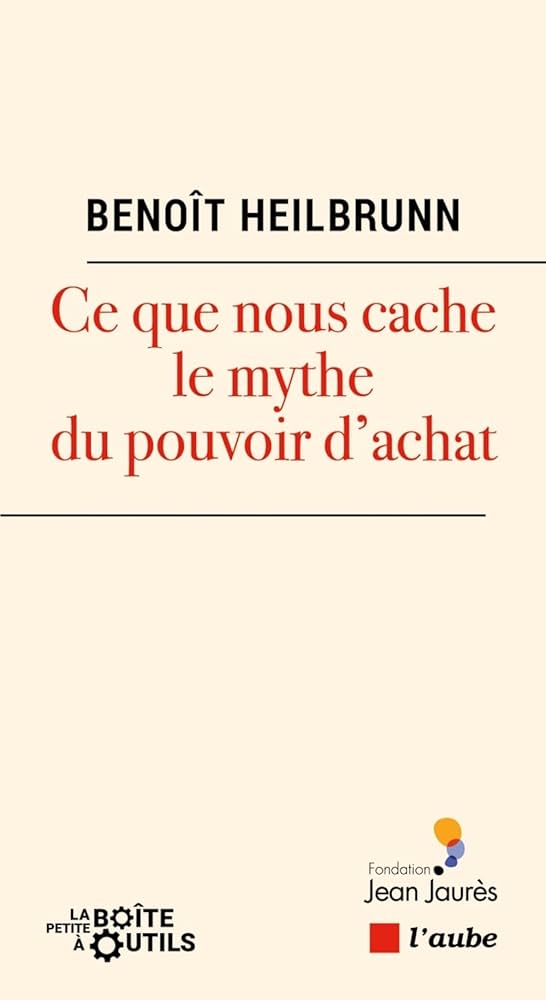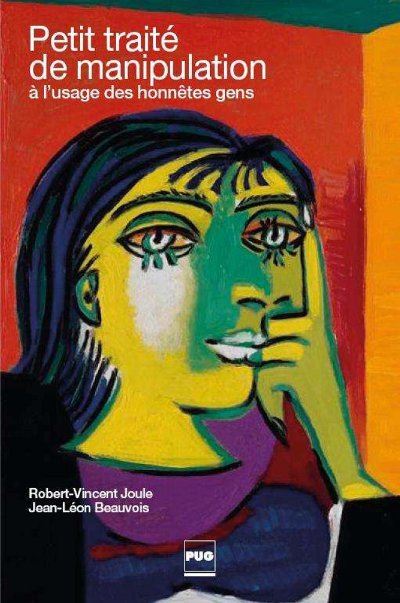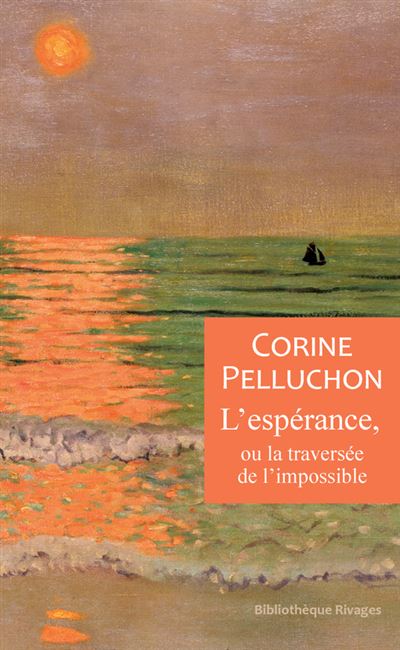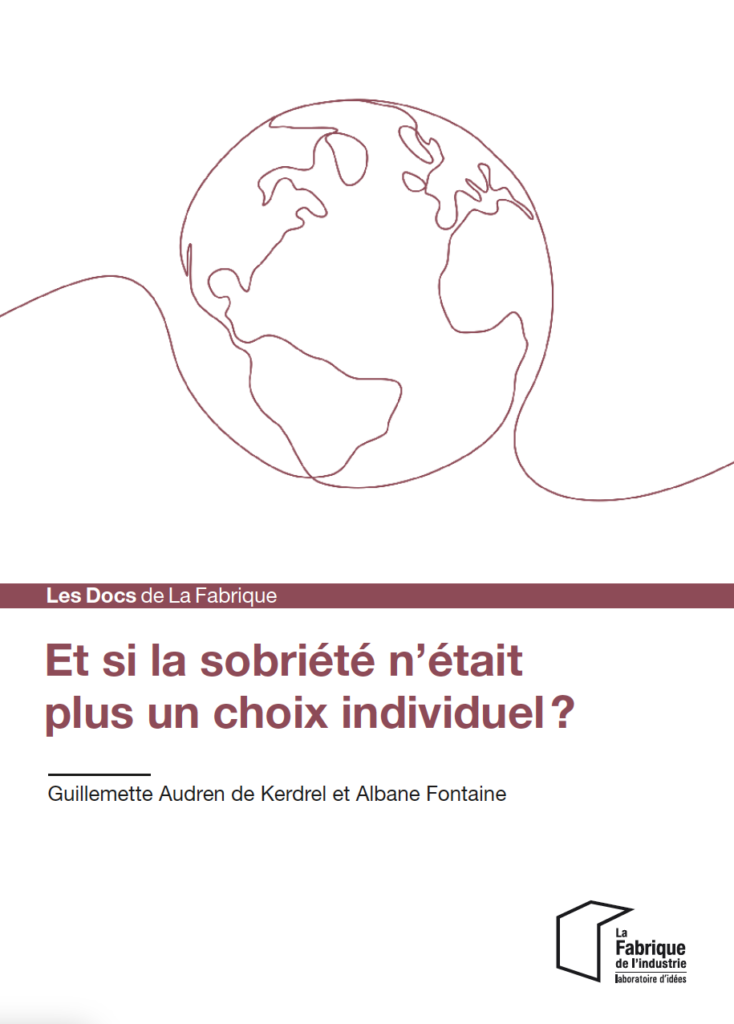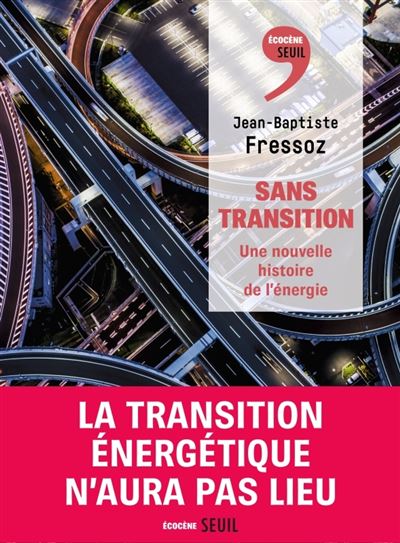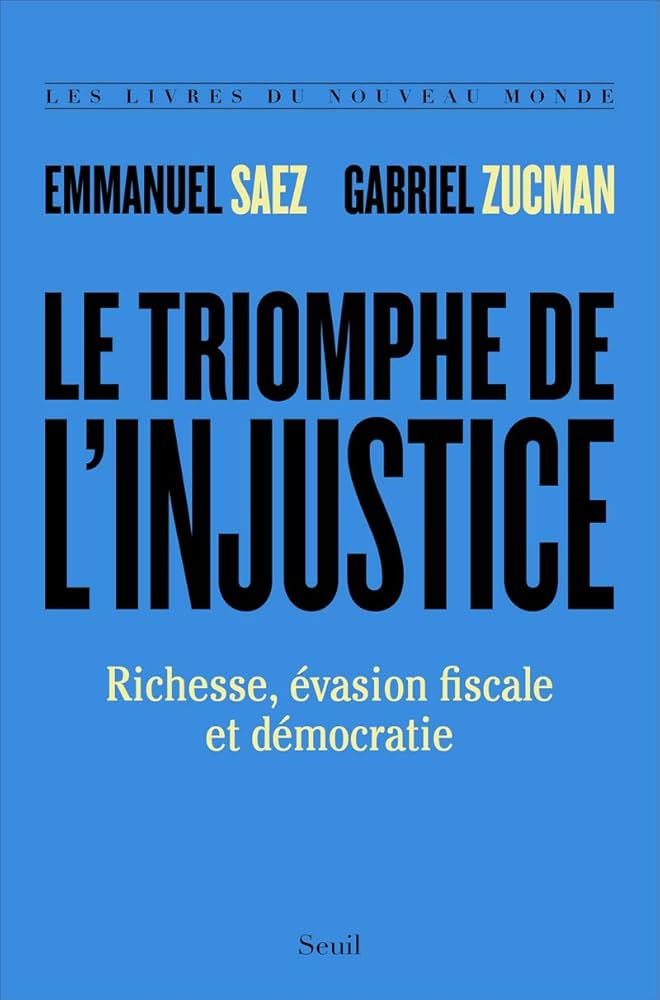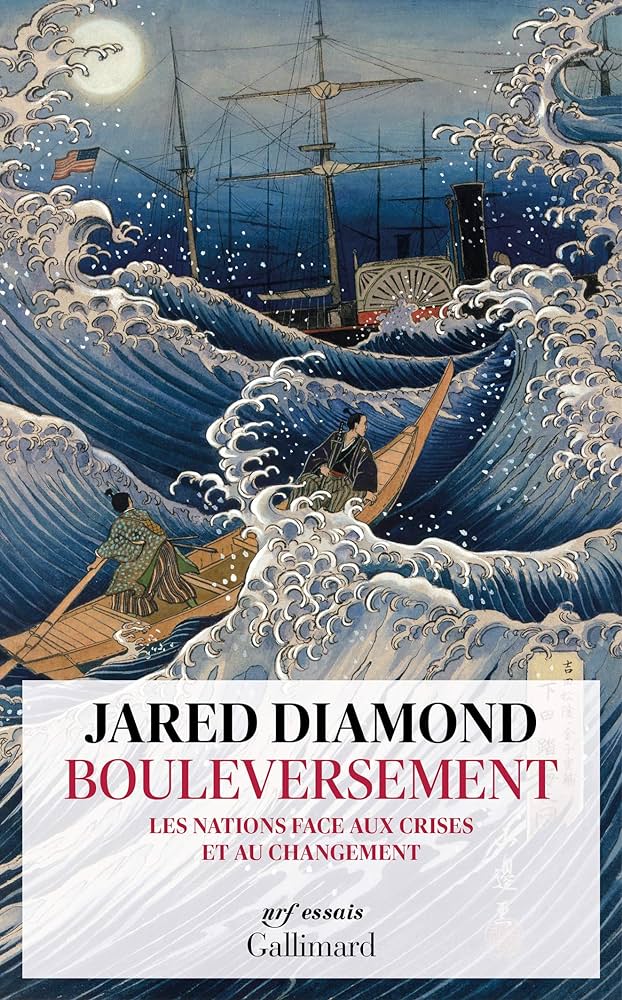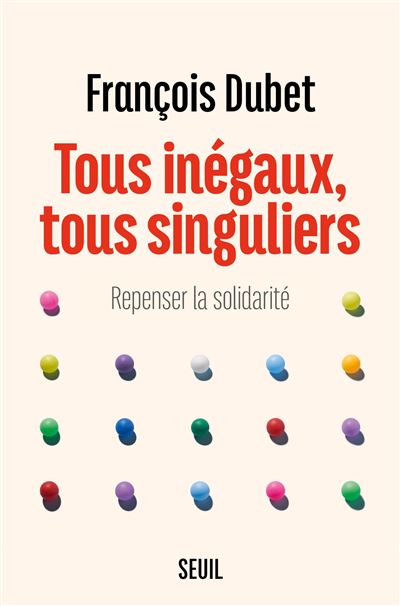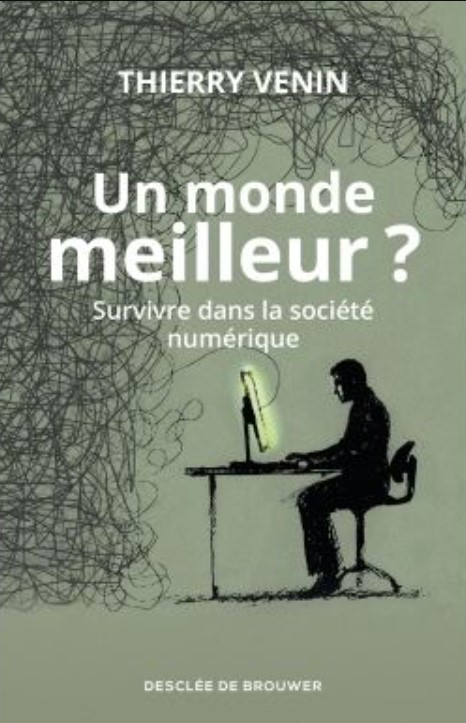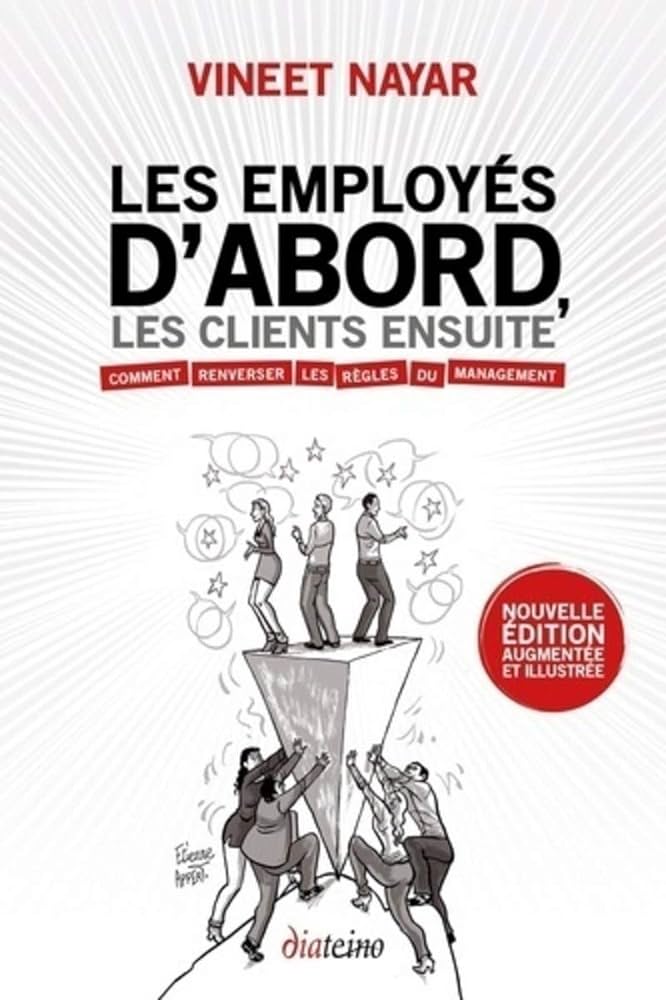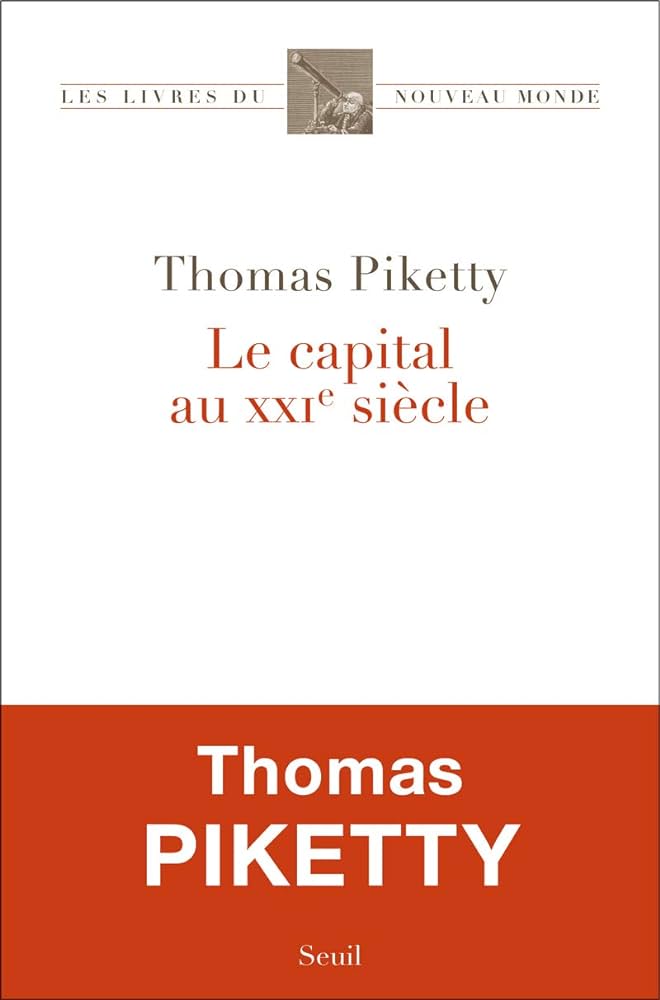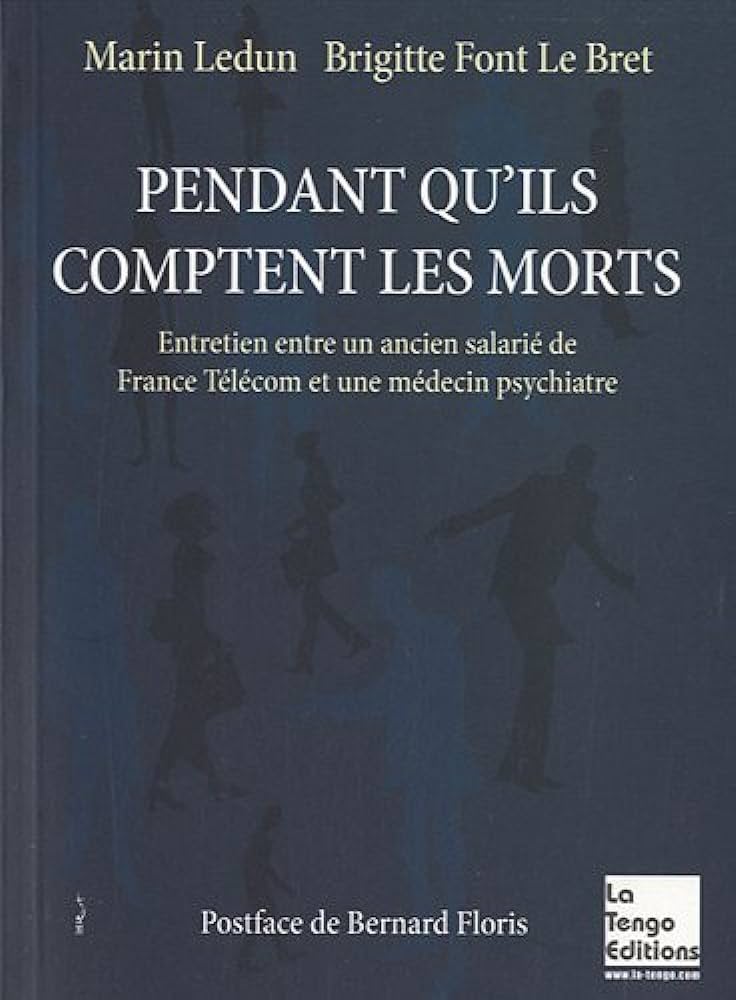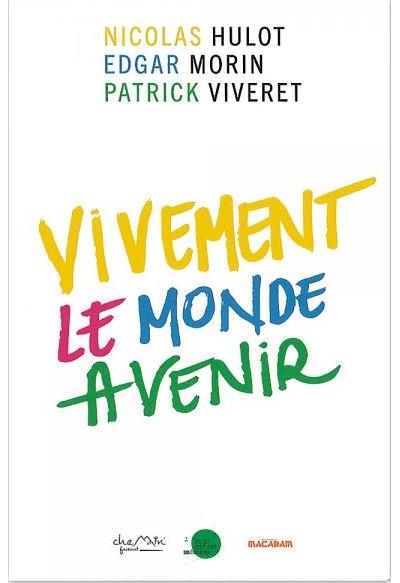Celia Izoard,
Éditions du Seuil, 2024.
Celia Izoard est philosophe et journaliste. Contrairement à l’ouvrage « Métaux le nouvel or noir » paru quasiment en même temps (voir chronique) , qui s’efforce de garder une tonalité positive malgré la réalité des éléments présentés, le ton de Celia Izoard est beaucoup plus direct « Continuer à faire croire , comme le fait l’Agence International de l’Energie , qu’il est possible de supprimer les émissions de carbone en électrifiant le système énergétique mondial est un mensonge criminel ». En effet, « pour sauver la planète, un coup d’accélérateur historique a été donné à l’une des industries les plus énergivores et toxiques que l’on connaisse ».
Dans une première partie de l’ouvrage, l’auteur prend sa caquette de journaliste et nous emmène en Espagne, au Chili, au Maroc et en France pour tenter de répondre à la question « les méga-mines de l’âge industriel sont-elles prédatrices par accident ou par nature ». Autrement dit peut-on sérieusement envisager des « mines responsables ». La réponse est clairement non : avec la baisse des teneurs des gisements, il faut nécessairement plus d’eau, plus d’énergie, plus de produits chimiques. La quantité de résidus toxiques augmente et donc la taille des parcs à résidus, vastes lacs de boues toxiques fermés par des barrages.
« Les plus grands parcs à résidus miniers comptent parmi les ouvrages les plus immenses que l’homme ait construit sur Terre …ils sont censés maintenir ces déchets en sécurité sans limitation de durée. Mais est-ce vraiment une perspective réaliste ? » (Extrait d’un rapport du PNUE cité par l’auteur). Les accidents réguliers de rupture de barrages engendrant des catastrophes écologiques sont là pour témoigner du contraire. De plus, la mine zéro carbone n’existe pas et la mine est de plus en plus assoiffée dans un monde ou l’eau devient une ressource rare. Enfin, si tout est fait pour minimiser l’intervention humaine (entre autres, pour minimiser la possibilité de rapport de force entre les mineurs et les propriétaires des mines), les travaux miniers sont toujours très dangereux, générant 8% des accidents mortels pour 1% de la main d’œuvre mondiale. Et ceci sans compter les maladies à long terme et l’exploitation minière artisanale.
Pour ce qui concerne l’idée fortement portée de relocaliser la mine dans les pays utilisateurs, l’auteure nous invite à ne pas nous leurrer en rêvant d’une mine propre : « construire une mine industrielle économiquement viable sur un territoire implique la création d’une zone de sacrifice, qu’elle soit en Europe ou ailleurs ».
Après cette première partie dont le constat est sans appel, l’auteur se penche sur les imaginaires occidentaux : « pendant plus de 30 ans, dans les pays les plus riches et les métropoles de la planète, les mines ont disparu de l’imaginaire collectif….on se figurait être entré dans une société post-industrielle » Cette vision est bien résumée par la déclaration de Ronald Reagan en 1988 : « Dans la nouvelle économie, l’invention humaine rend de plus en plus obsolètes les ressources matérielles. ». En ce début de 21e siècle, la matérialité des économies se rappelle brutalement aux pays occidentaux qui s’en croyaient affranchis. Et c’est à ce moment que se crée un nouvel imaginaire « la transition » qui justifie une ruée minière. Mais, se demande l’auteure, ne serions-nous pas face à « une nouvelle idéologie qui
présente l’extension du capitalisme comme une nécessité salutaire pour l’humanité ? Après la «civilisation», le «progrès», le «développement», la «transition» justifie l’accélération d’un même modèle extractiviste dans un contexte d’âpre concurrence mondiale ». Et derrière le discours du besoin d’une « ruée minière » pour la transition énergétique, il ne faut pas oublier que les métaux sont aussi nécessaires pour la transition numérique, pour l’industrie aéronautique et spatiale, pour l’armement…
La troisième partie de l’ouvrage explore cette cosmologie extractiviste issue du capitalisme dont « l’histoire est indissociable de celle de la mise en extraction du monde » et qui a conduit « d’un monde agricole à un monde minier, d’un monde-culture à un monde-gisement ». Cette vision du monde n’est pas du tout celle des peuples amazoniens, comme les Yanomani qui voient les Occidentaux comme des « mangeurs de terre », « des êtres miniers, des êtres qui entretiennent un rapport spécifique et maladif à l’extraction », que ce soit l’extraction de métaux, mais aussi de pétrole, de gaz, de charbon …. L’auteure nous fait un panorama des considérations philosophiques et religieuses qui ont conduit à « l’homo faber » qui doit « transformer la matière pour rendre à l’humanité sa domination perdue sur
la nature ».
La quatrième partie est consacrée à quelques pistes pour « sortir du régime minier ». La première idée qui vient, c’est le recyclage : « ce serait finalement une extension du domaine de l’extraction, peut-être moins dévastatrice que les mines elles même, mais probablement insoutenable au niveau des pollutions, des besoins en eau et en énergie ». Il faut donc aller vers une décroissance minérale : « Avant de se demander comment obtenir des métaux de manière moins destructrice, il faut se donner les moyens d’en produire et d’en consommer moins ». En parallèle, nous dit l’auteure, il faut s’organiser pour « augmenter le coût financier, moral et politique de l’extraction minière ».
Elle termine son ouvrage par un appel aux ingénieurs qui doivent « ne plus se résigner à coopérer malgré soi au techno capitalisme ». Il leur faut s’employer à « libérer la technique de sa dépendance minière, travailler avec des matériaux renouvelables et non toxiques, rendre la technologie compatible avec les mondes végétaux et animaux. La technique doit sortir de deux siècles d’envoutement extractiviste. Elle doit quitter les sous-sols et cesser de viser le ciel pour regagner la terre ». Un livre très riche qui mêle constats de type journalistiques et réflexions philosophiques pour nous faire toucher du doigt le besoin de cesser d’être des «mangeurs de terre ».