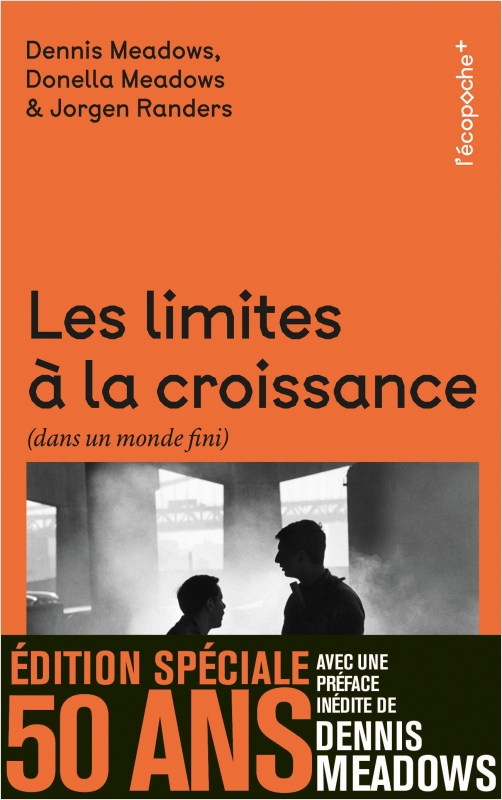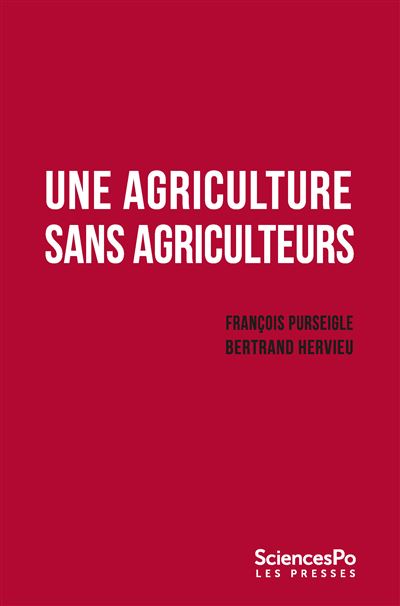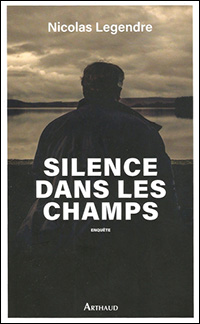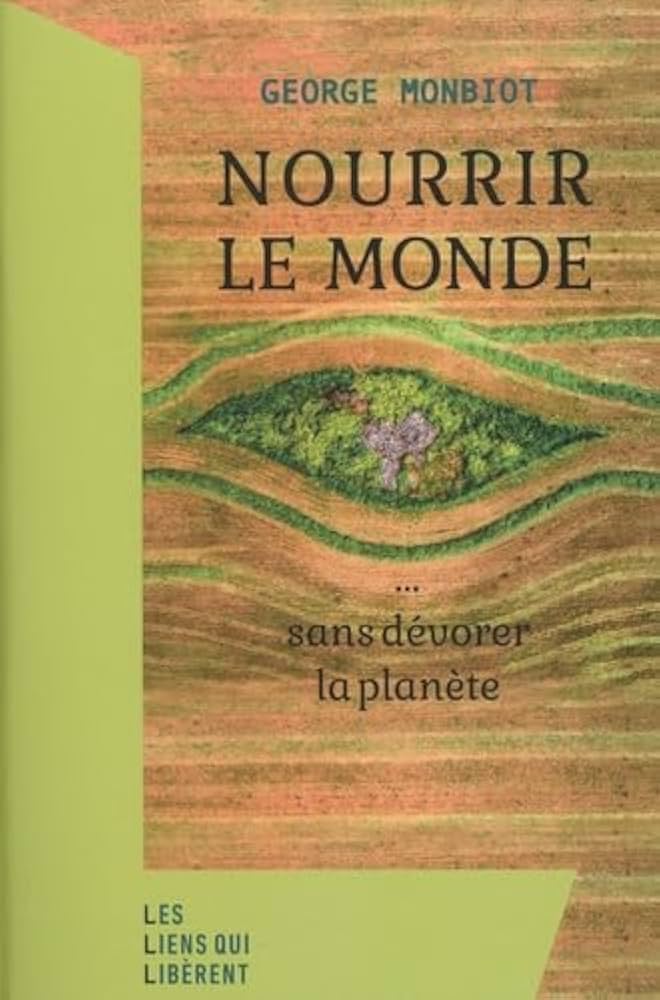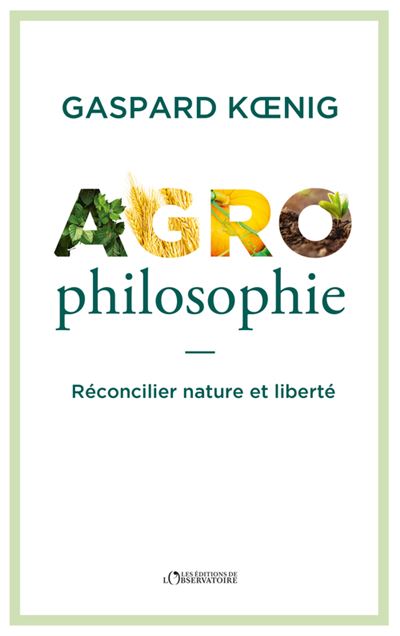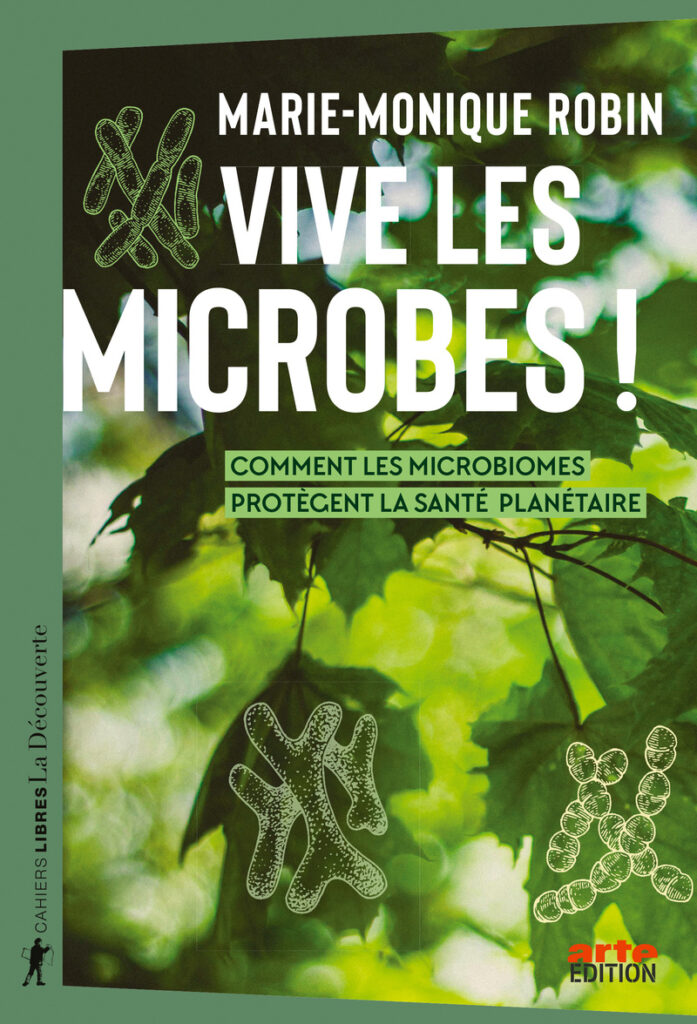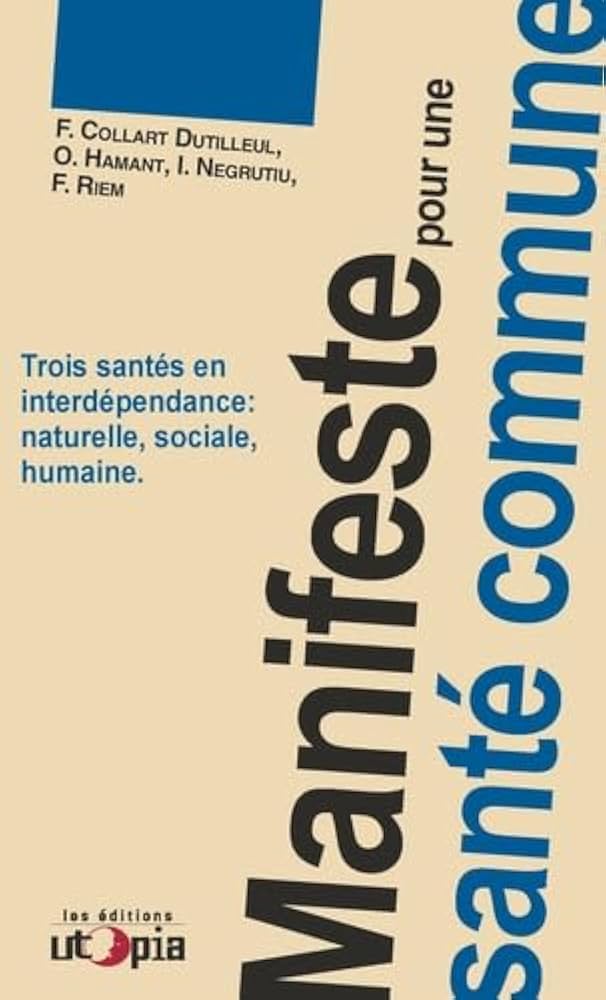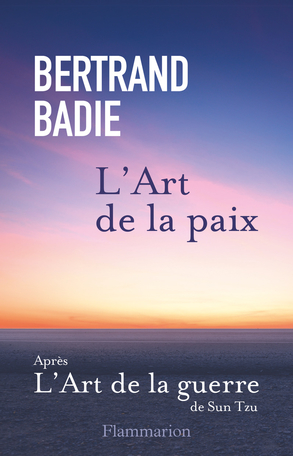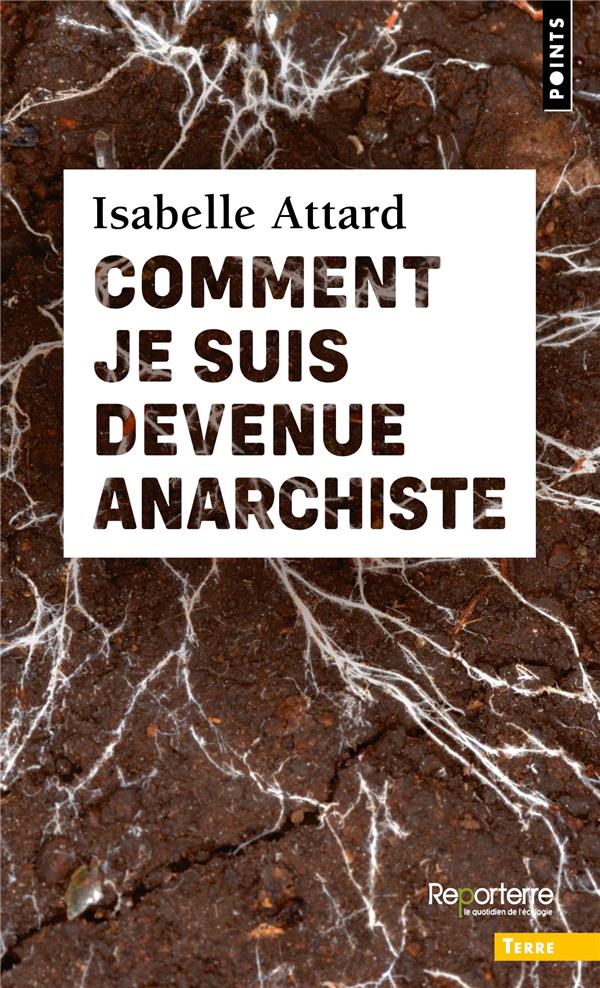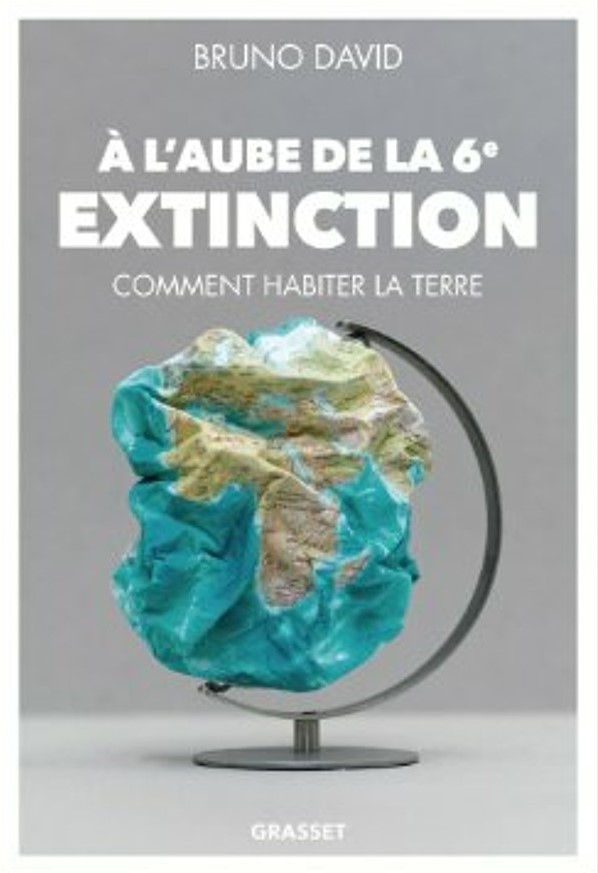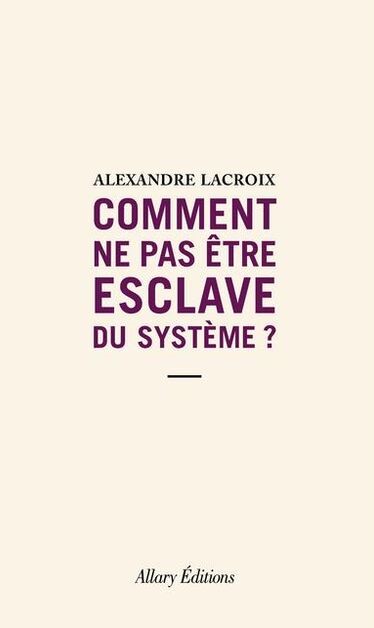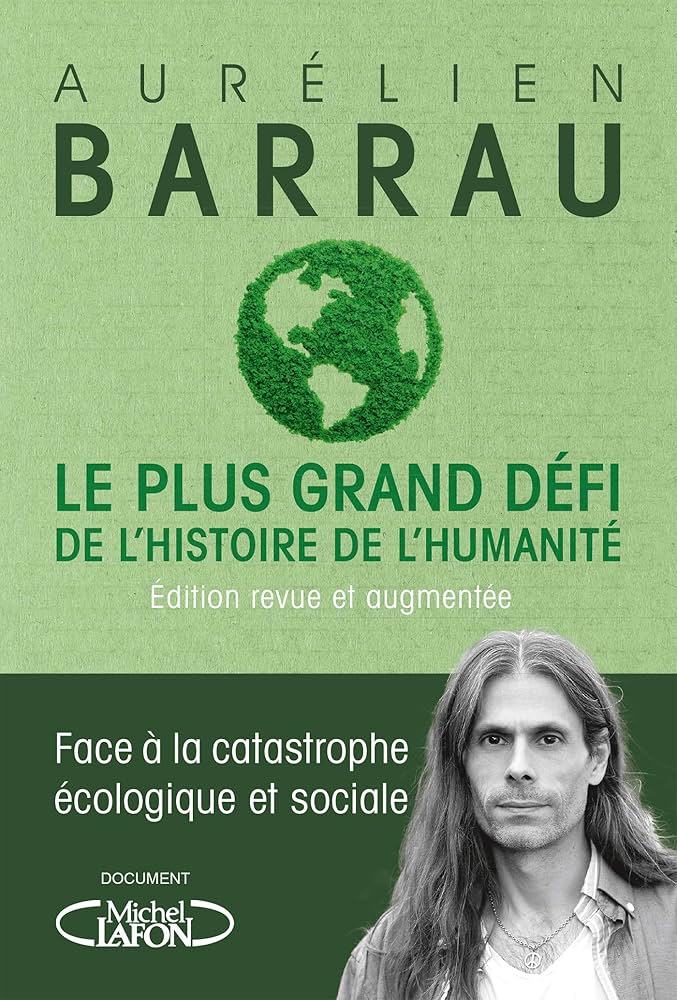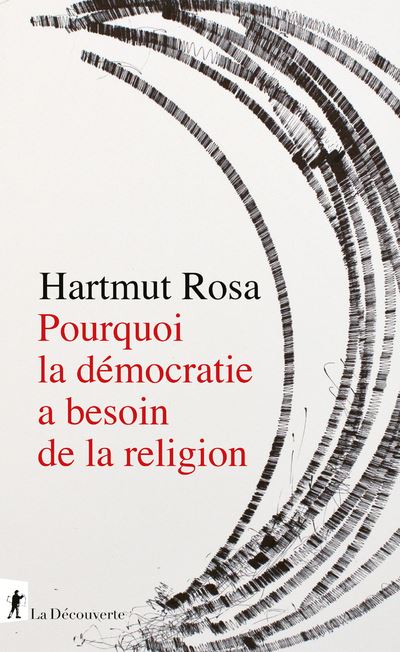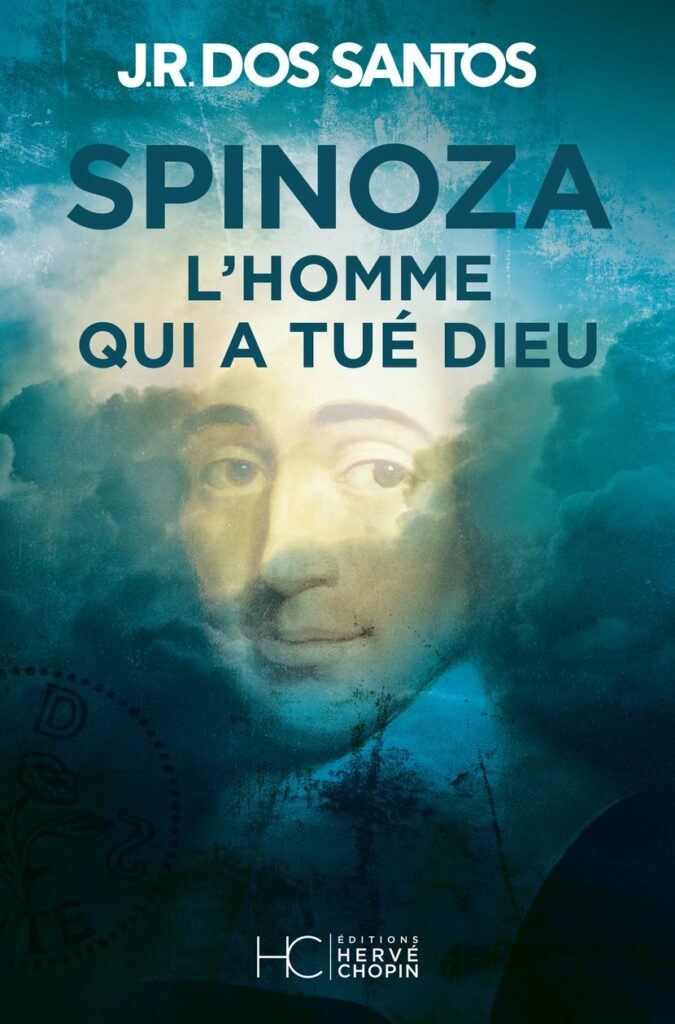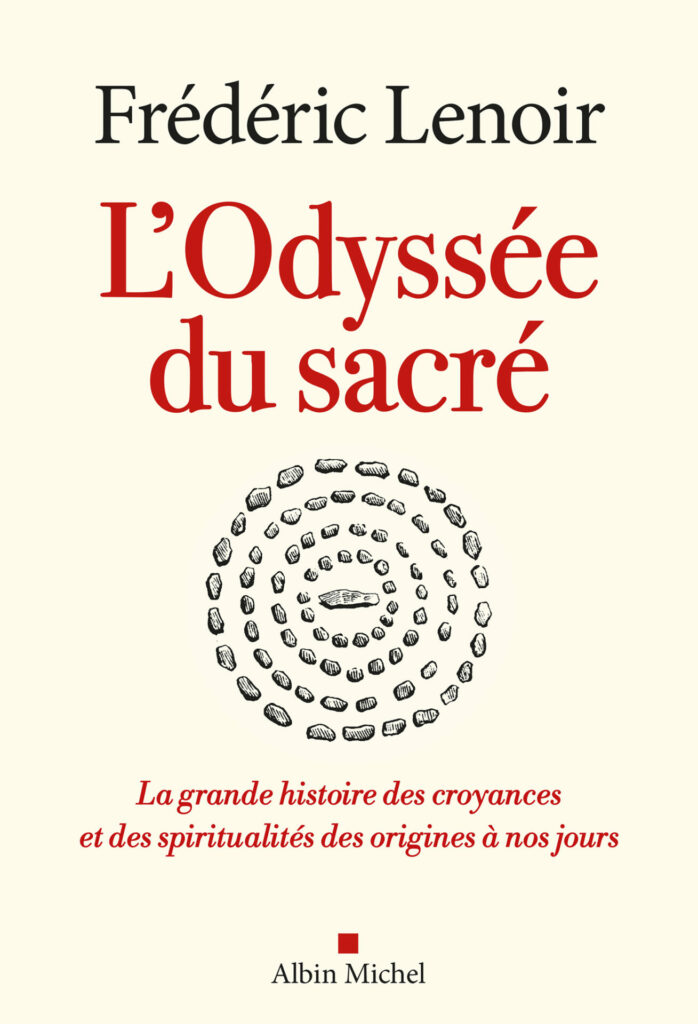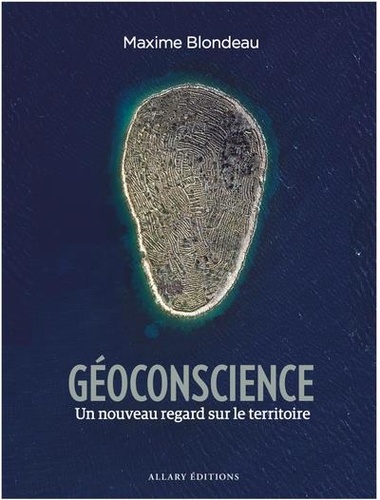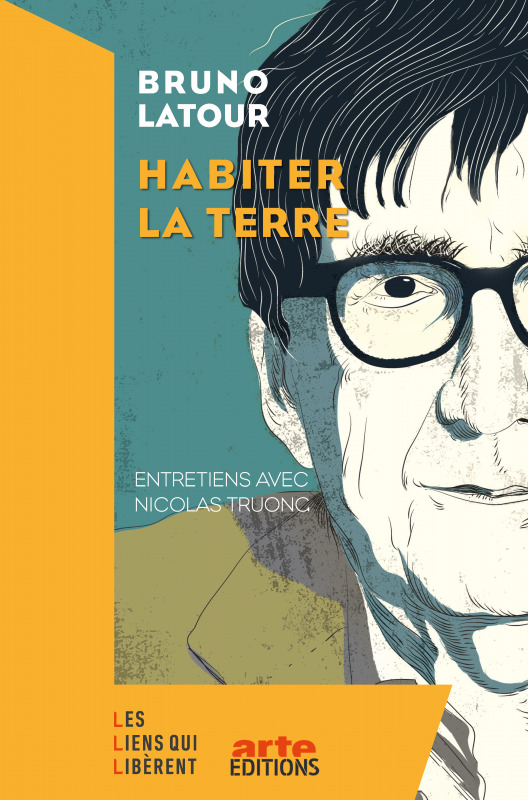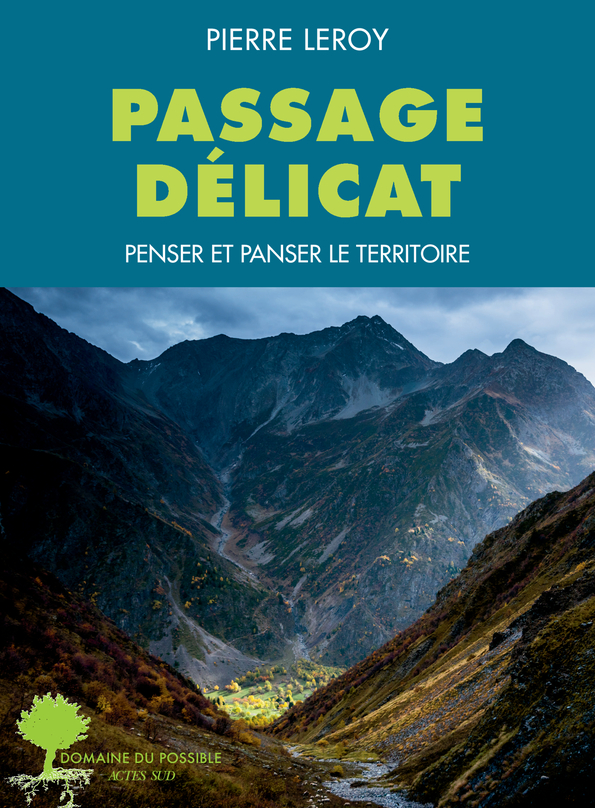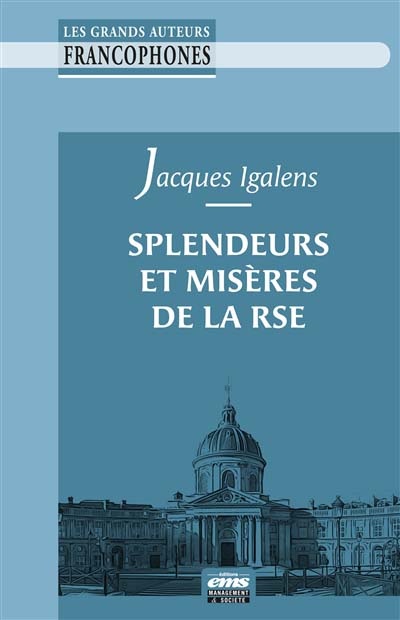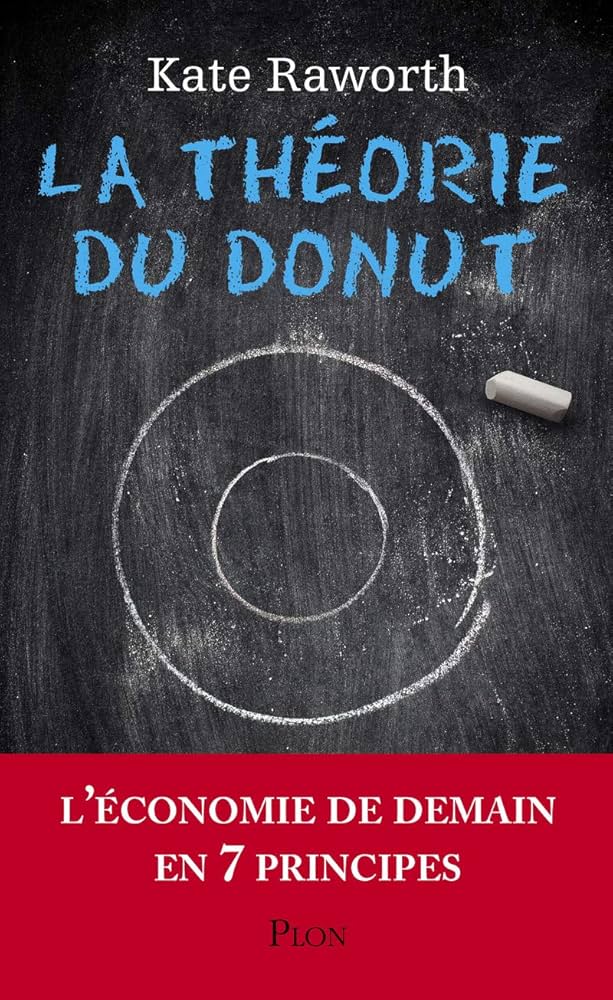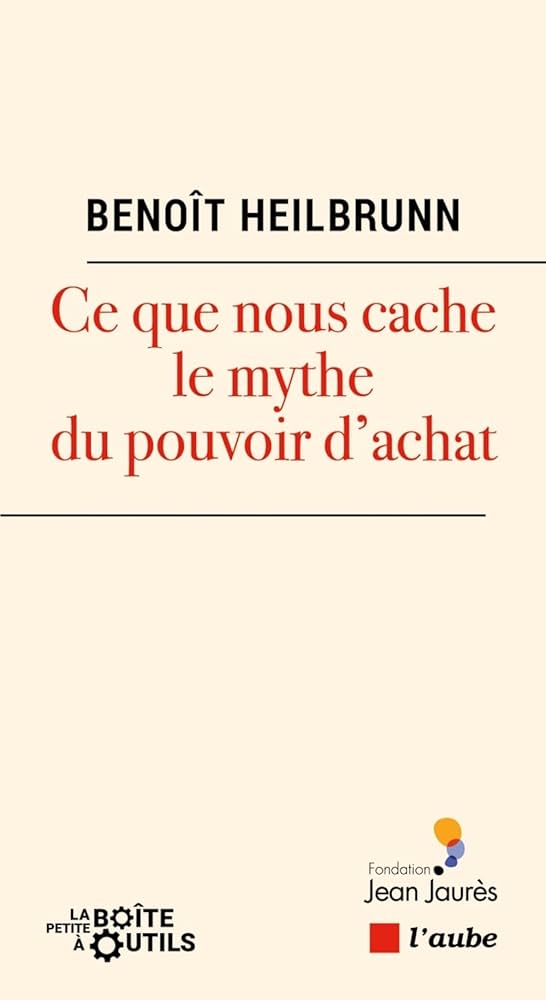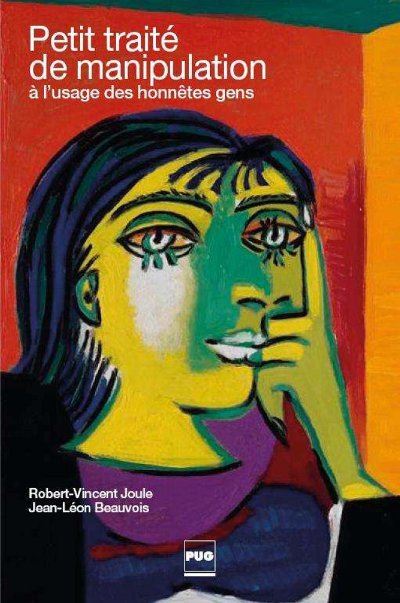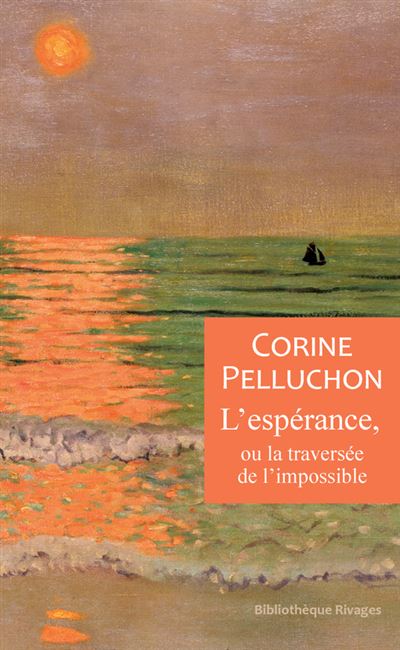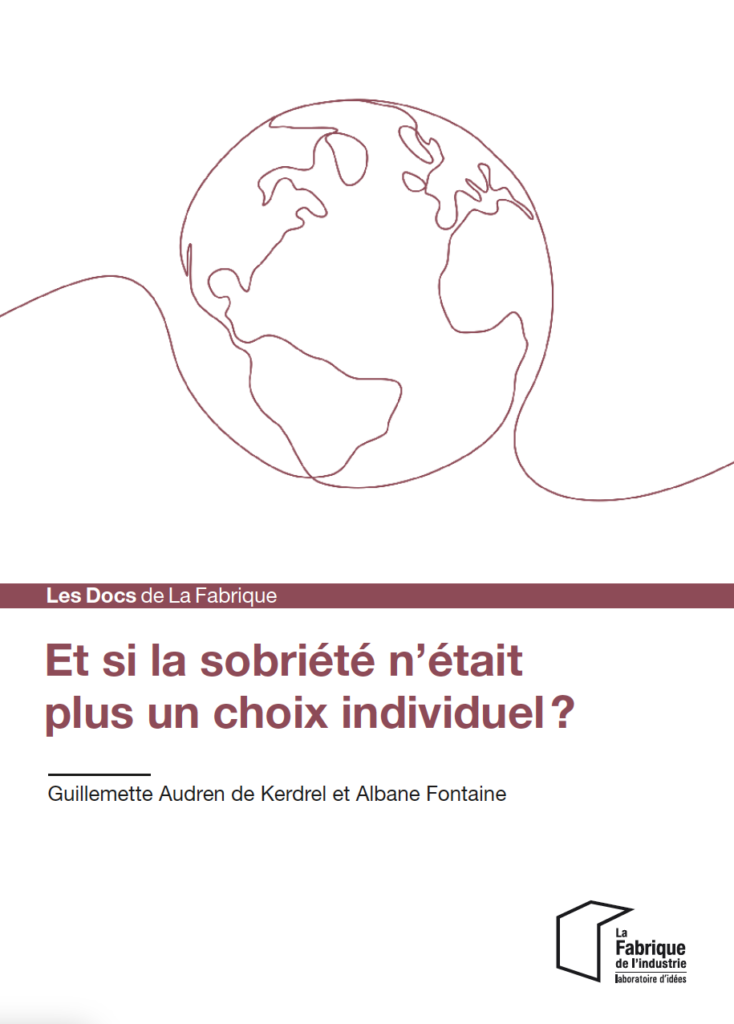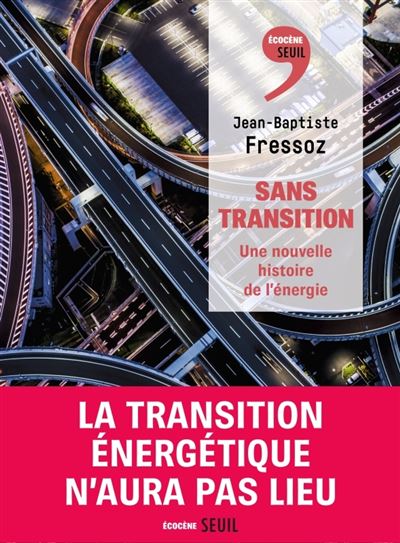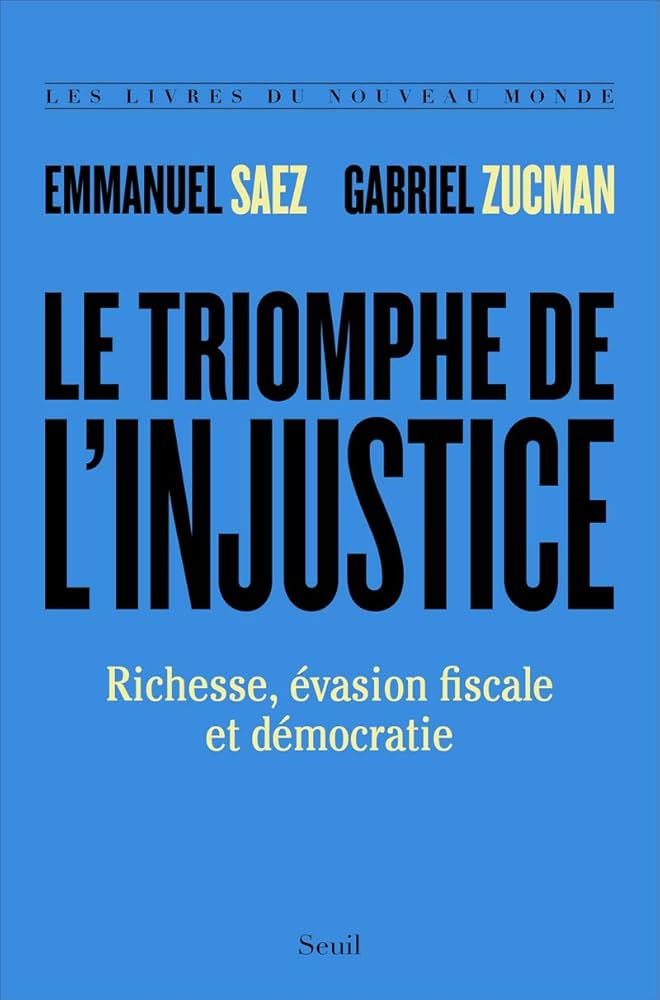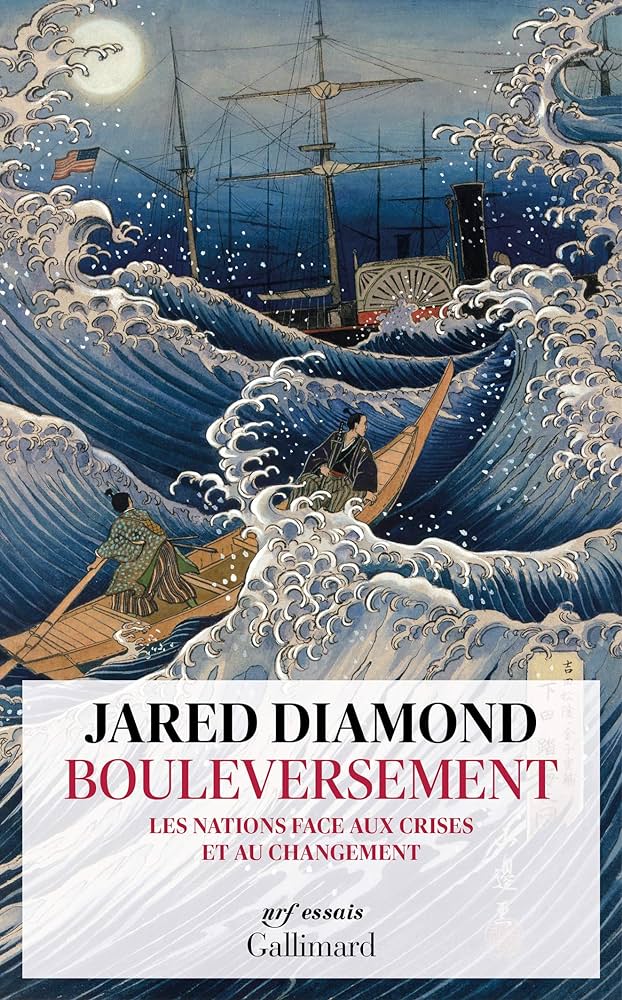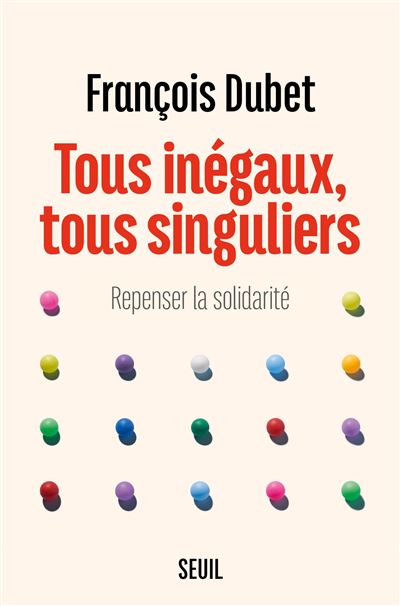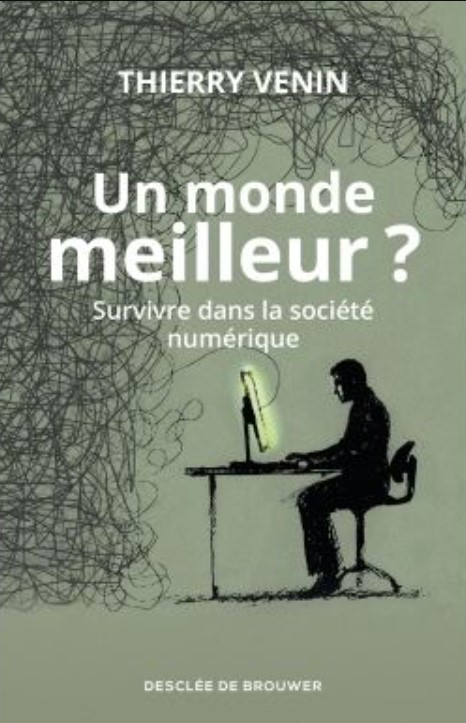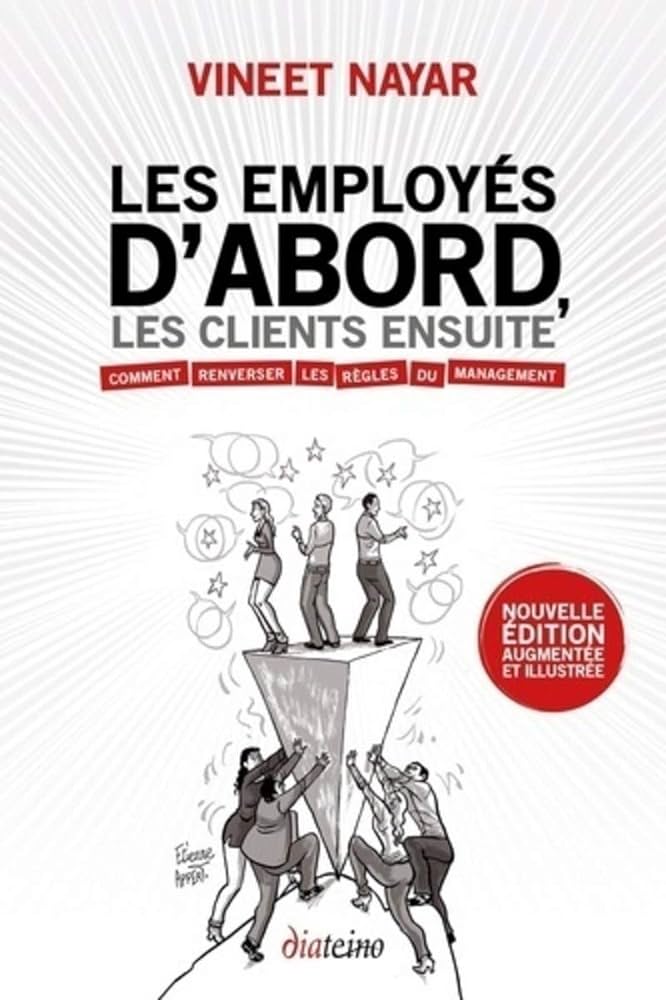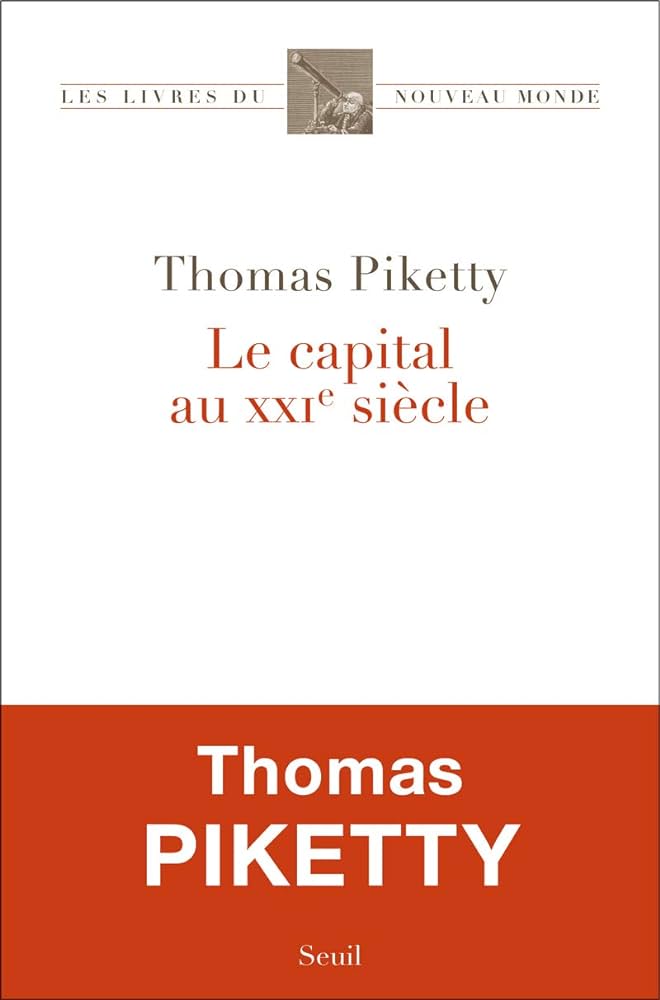Bertrand Badie, Flammarion 2024
« Au fil des siècles, on s’était habitué à considérer la paix comme étant simplement la « non-guerre », acceptant ainsi, comme un triste aveu que la belligérance fût installée à tout jamais dans les profondeurs de la nature humaine ». Présentant cette vision très occidentalo-centrée à des étudiants africains, Bertrand Badie, Professeur émérite à Sciences Po, spécialiste des relations internationales a réalisé que la paix a un sens beaucoup plus positif dans certaines des langues africaines. Cette prise de conscience l’a conduit à cet ouvrage dont l’objet est de construire une nouvelle vision de la paix : « la positiver, la placer en haut de nos agendas comme invention humaine en soi et non plus seulement comme parade à la guerre ».
En 9 chapitres, il analyse les 9 facettes de « l’art de la paix ».
Il faut d’abord remettre la paix à l’endroit, car la « non- guerre n’est pas la paix ». Le modèle dit « westphalien » (référence aux traités de Westphalie au temps de Louis XIV) qui veut que l’Etat le plus fort par les armes impose sa paix aux autres, est de plus en plus inefficace. « La quasi-totalité des interventions de stabilisation « hégémonique » ont abouti à un échec ». L’auteur cite ainsi de nombreux exemples dans lesquels la signature d’un traité n’a absolument pas été suivi d’effet pacificateur . A commencer par le traité de Versailles en 1919 qui contenait en germe la seconde guerre mondiale.
Dans le monde actuel ou les enjeux sont mondiaux (« le risque climatique tue davantage chaque année que la plus meurtrière des guerres »), la condition de la paix est de prendre en compte les souffrances sociales et réduire les insécurités (alimentaire, sanitaire, climatique, économique, culturelle…).
Si l’art de la paix doit prendre en compte l’humain et ses besoins, elle doit aussi prendre en compte sa subjectivité : il faut « savoir créer la confiance chez l’Autre, savoir gérer et guérir sa méfiance ». Et surtout éviter l’humiliation qui est source de rage et qui peut faire le jeu « d’entrepreneurs de violences », ce qui conduit au terrorisme. On voit ainsi apparaitre une paix qui n’est « plus l’affaire exclusive des princes et des stratèges. Il s’y ajoute une mystérieuse énergie sociale qui fera la différence en donnant au plus faible une capacité dont le canon ne saura plus se rendre maitre : les guerres de décolonisation l’ont montré ».
Depuis 1945, les guerres sont devenues un jeu « complexe et multiforme » qui implique de nombreux acteurs et dont les Etats n’ont pas le monopole. De plus elles sont souvent intra- étatiques, demandant des approches systémiques : il s’agit de « créer un scénario d’intégration suffisamment crédible et attirant pour l’ensemble des parties. Il faut même faire en sorte que l’acte d’intégrer paraisse plus rémunérateur que celui de combattre ».
Dans un monde globalisé, la paix ne peut être que globale : « la principale menace de déstabilisation qui pèse sur une nation ne vient pas de son semblable mais d’une globalité qui deviendrait incontrôlable ». En particulier les inégalités et l’insécurité climatique et alimentaire, ce qu’Antonio Gutteres a résumé par la formule « les ventres vides nourrissent les troubles ».
La paix devrait devenir un bien commun géré collectivement : malheureusement les « princes » des Etats préfèrent « se trouver un ennemi plutôt que désigner comme source de leurs maux le dérèglement de l’ordre planétaire ». Et la logique guerrière complétée par une transaction (un traité de paix) s’accorde mieux au court-termisme de la plupart des politiques que le travail de fond nécessaire à régler les dérèglements du monde pour créer une paix durable. La paix demande donc des institutions mondiales fortes capables de s’imposer face aux tendances souverainistes. Les résistances sont fortes, à commencer par le droit de veto des cinq membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies, ou le refus de certains de parler de climat dans l’enceinte des Nations Unies. De plus « alors que les conflits laissent de plus en plus de place aux acteurs locaux et non étatiques, la pleine reconnaissance de ceux-ci devient indispensable ».
La diplomatie doit servir à « gérer les séparations ». Il faut d’abord sortir de la posture habituelle d’accuser « l’ennemi » de tous les torts : ceux-ci sont souvent partagés. « La paix entre Etats commence avec la reconnaissance de cette stricte égalité devant la mémoire du crime ». La diplomatie doit prendre acte des différences et s’employer à construire des partenariats en appliquant une triple discipline : « ne pas exclure, éviter une gestion imprudente du régime des sanctions, savoir créer des aubaines coopératives », en n’oubliant pas qu’il faut « accepter de traiter avec une diversité d’acteurs dont l’Etat n’est qu’une variante ».
Dans la mesure où le mouvement des personnes fait de plus en plus partie des projets de vie, une des conditions de la paix, c’est l’hospitalité. Emmanuel Kant faisait de « l’hospitalité universelle l’un des articles définitifs de ce que devrait être une paix universelle ». L’auteur appelle donc à « une gouvernance globale de la migration » qui aurait pour avantage de couper court à « l’entreprise mafieuse des trafics d’êtres humains ».
Le dernier élément (dans l’ordre des chapitres du livre, mais surement pas dans les priorités), c’est l’éducation. Nous apprenons l’histoire principalement à travers les guerres. Il faudrait compléter par une « initiation robuste à l’histoire de la paix, des débats qui l’ont jalonné, des hommes et des femmes qui l’ont incarné, des institutions qui l’ont servi ».
Au terme de cette analyse, il peut paraitre utopique d’imaginer que toutes les conditions soient remplies pour une paix durable. Mais nous dit l’auteur, nous sommes arrivés à un moment où la guerre (qui ne résout rien, on le voit dans les conflits actuels) est beaucoup plus risquée et coûteuse que la paix. Il est donc pertinent de travailler cet « art de la paix », c’est-à-dire penser la guerre comme une atteinte à la paix, substituer la solidarité à la compétition, et penser global plutôt qu’individuel. Et face aux réticences des pouvoir politiques et même des individus, « il est un moment ou le cout de l’ignorance affiche un prix plus élevé que celui de la mise à jour : l’art de la paix se glisse alors dans cet étroit corridor de l’espoir ». Un essai porteur d’espoir qui alterne considérations philosophiques et exemples très concrets, ce qui le rend très accessible.