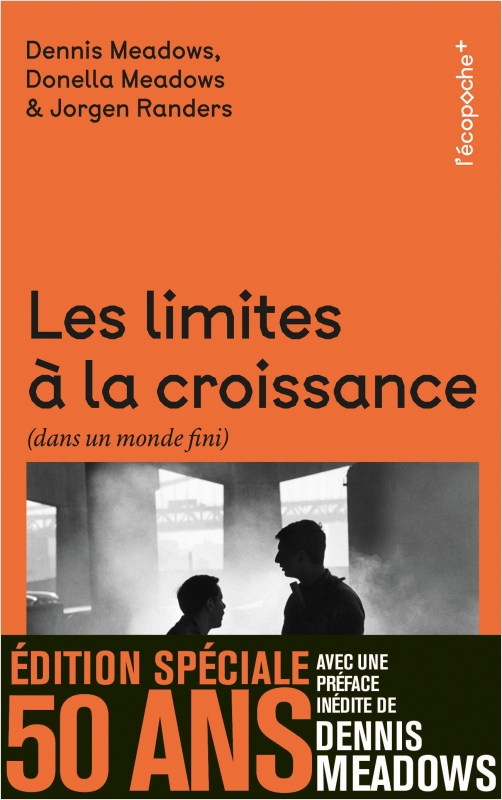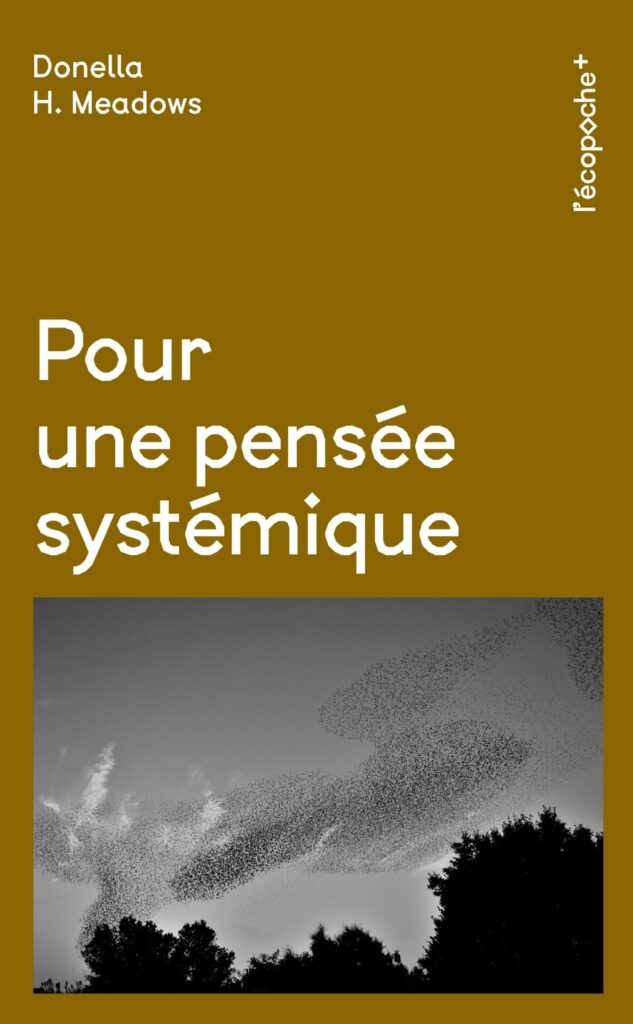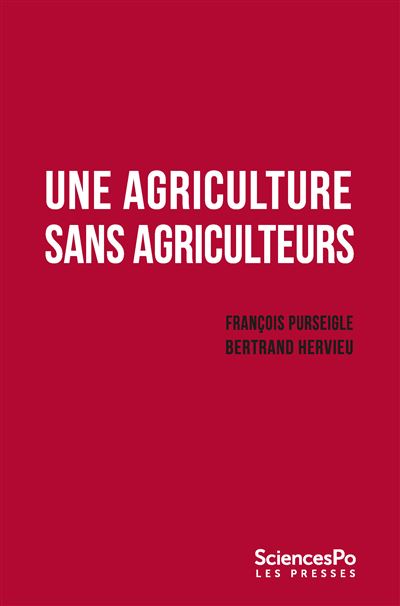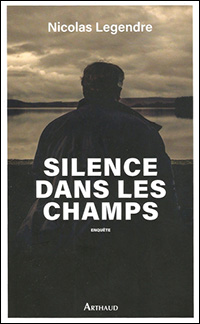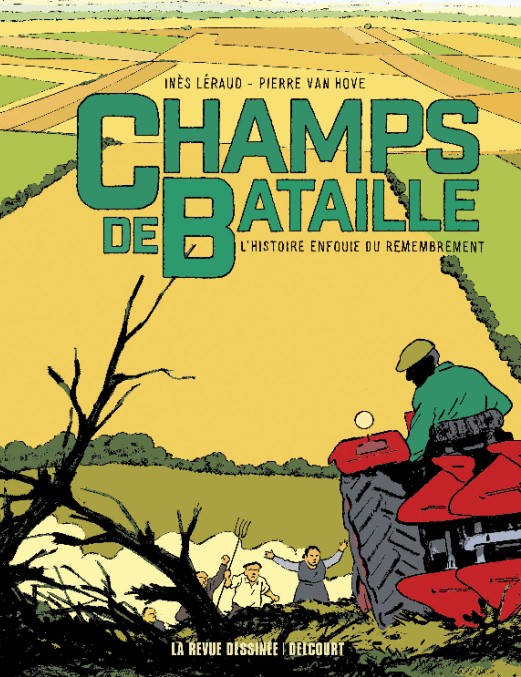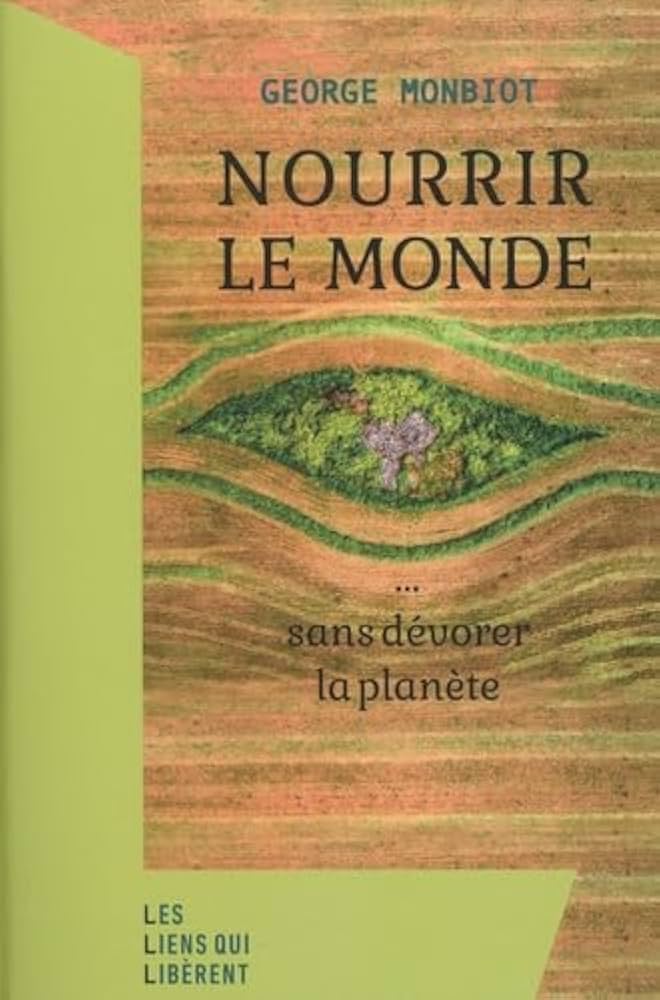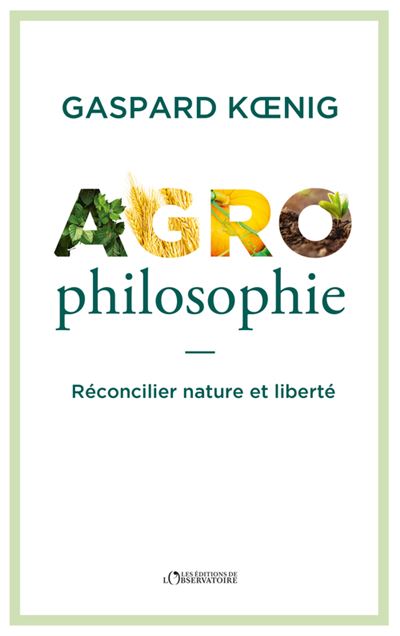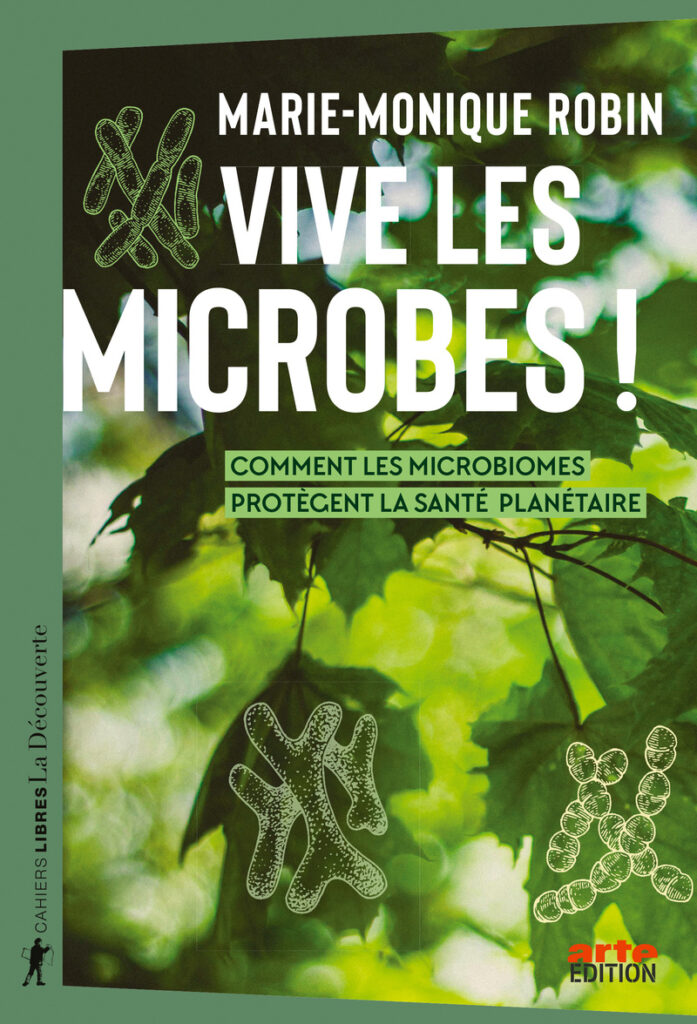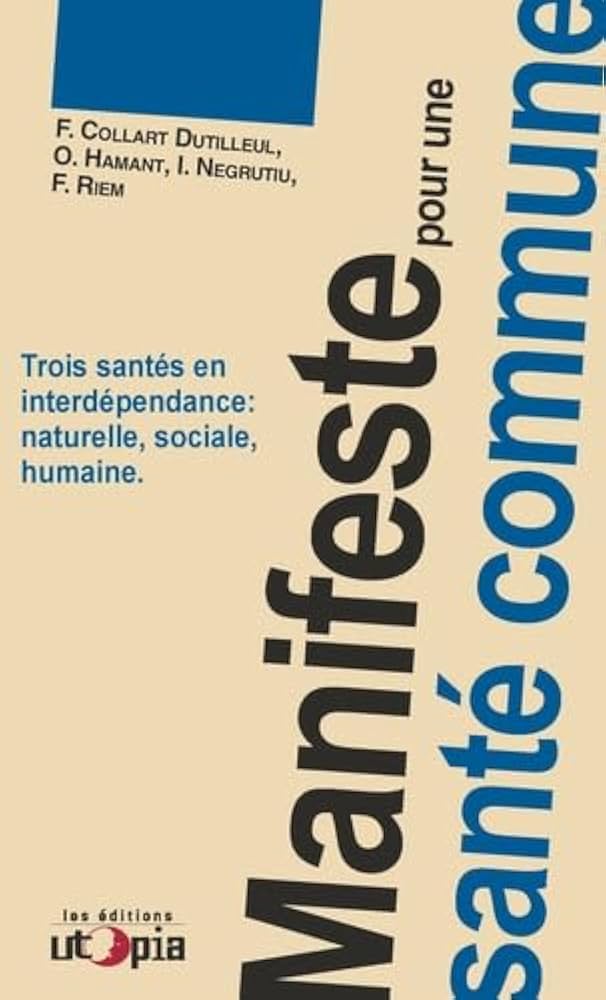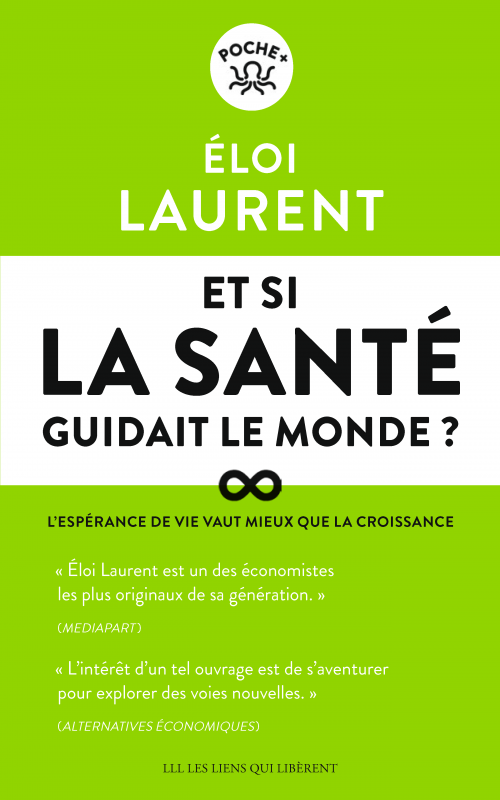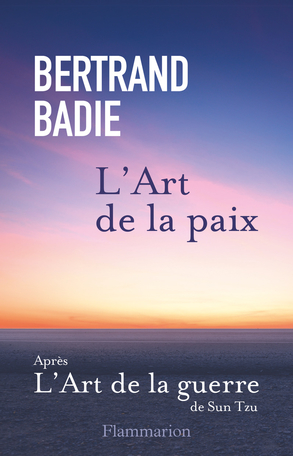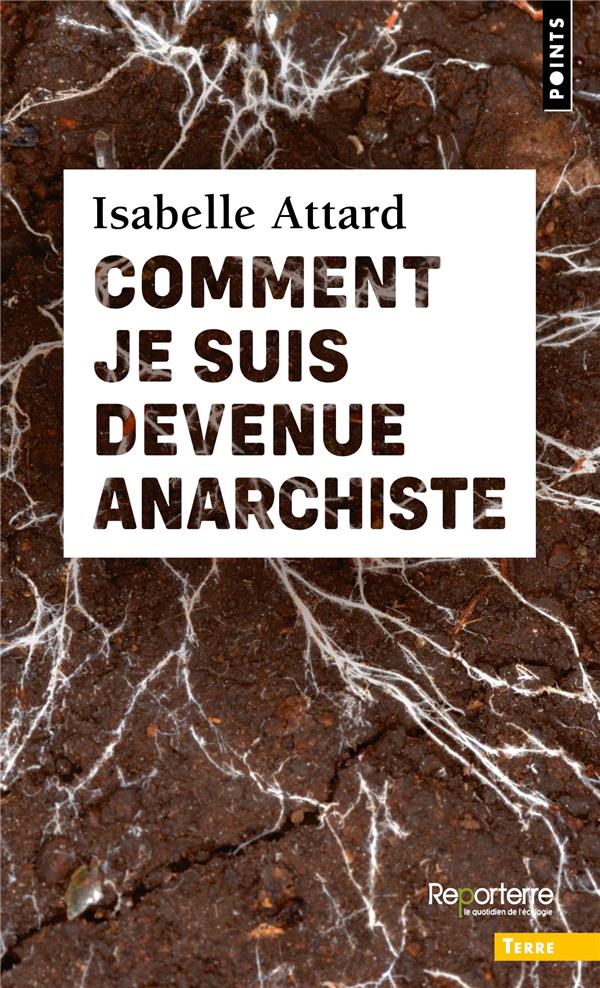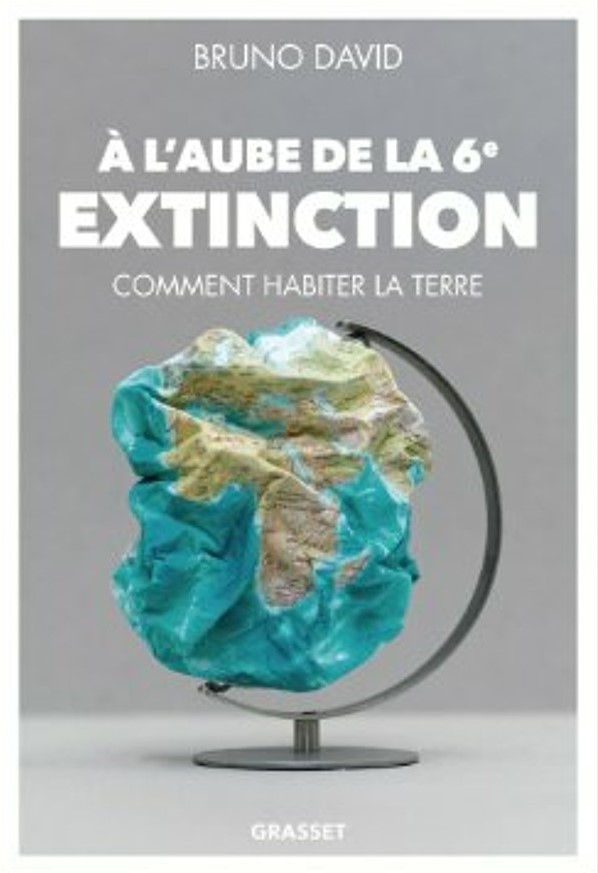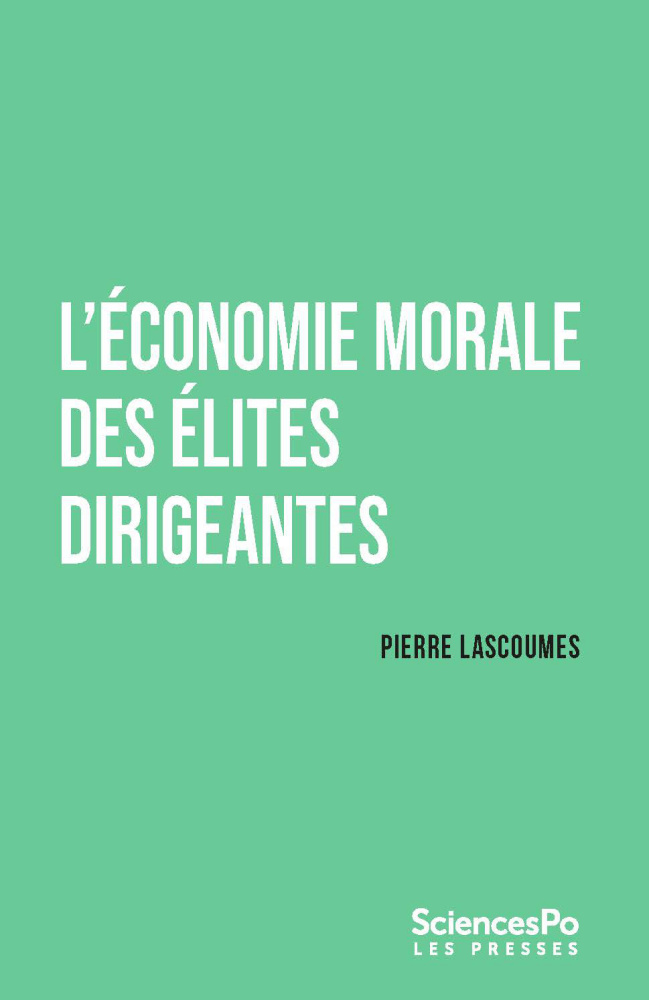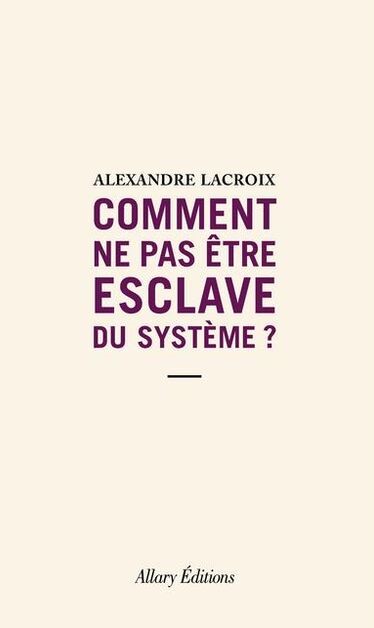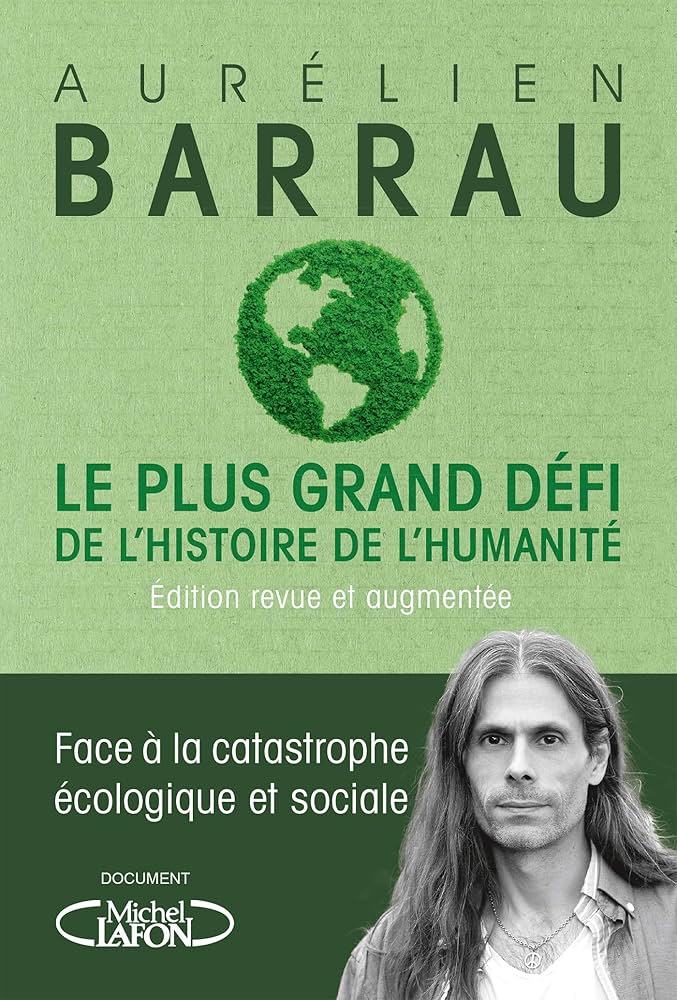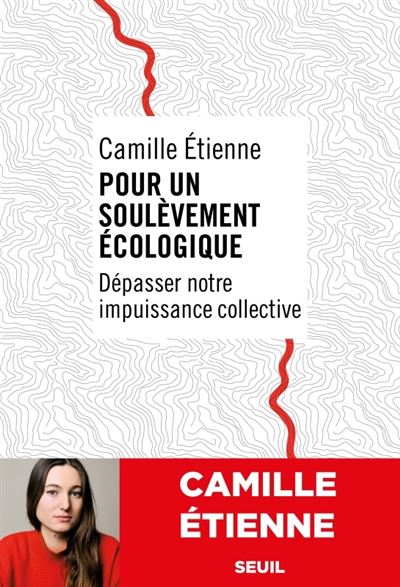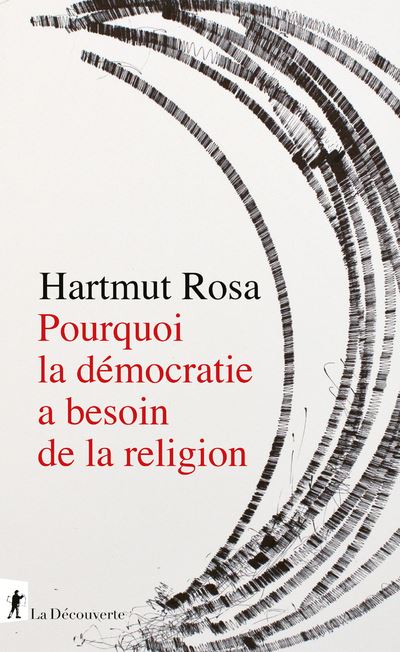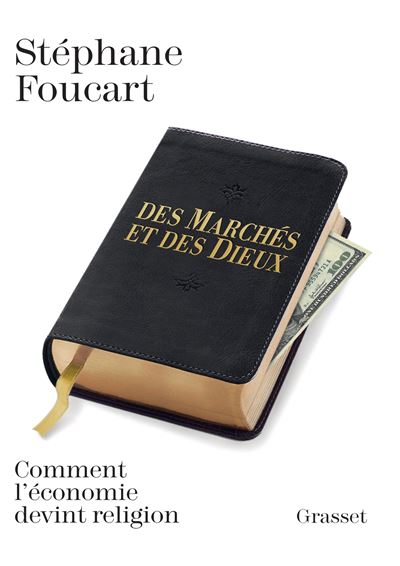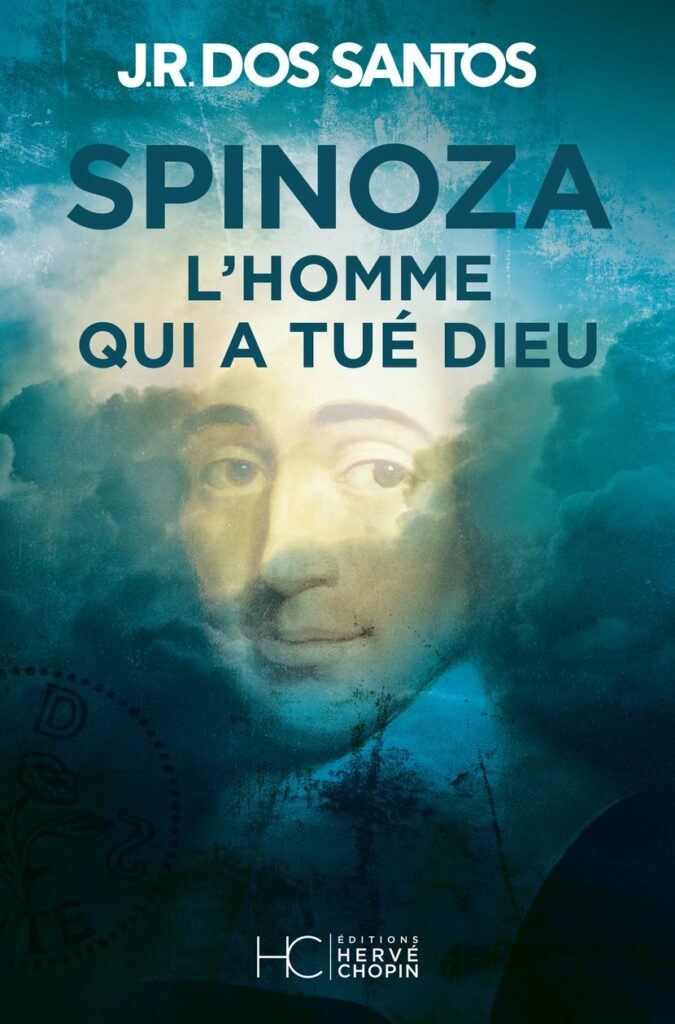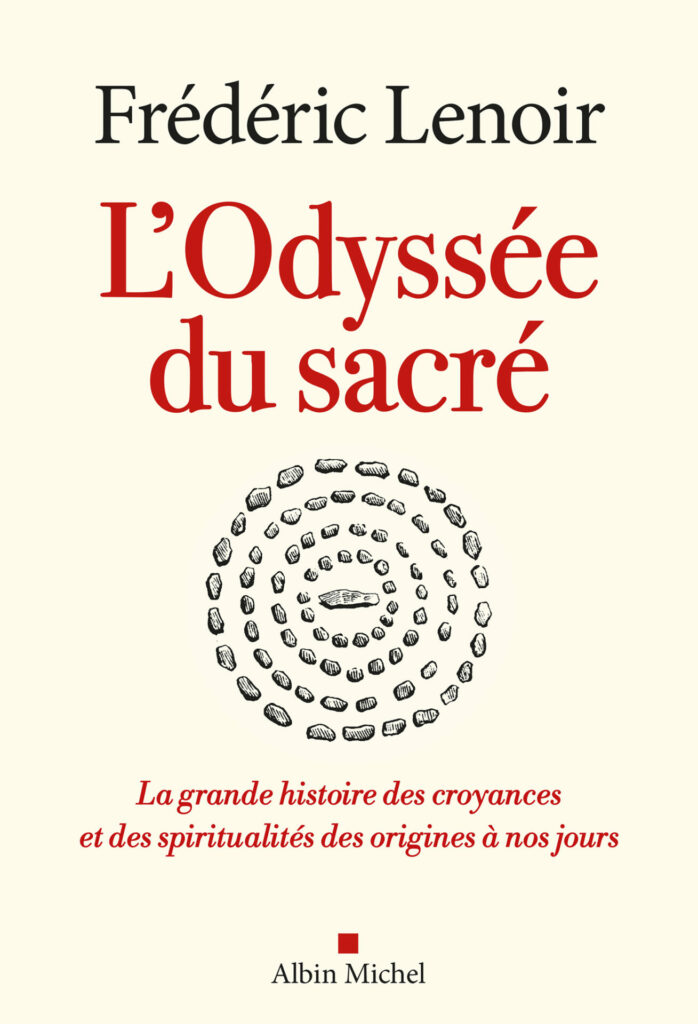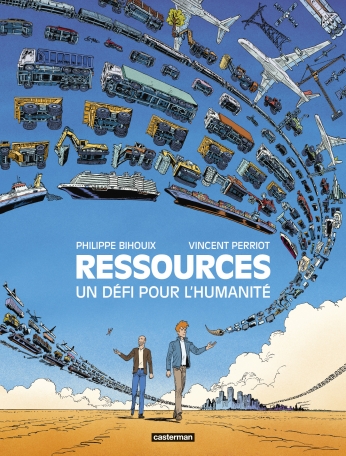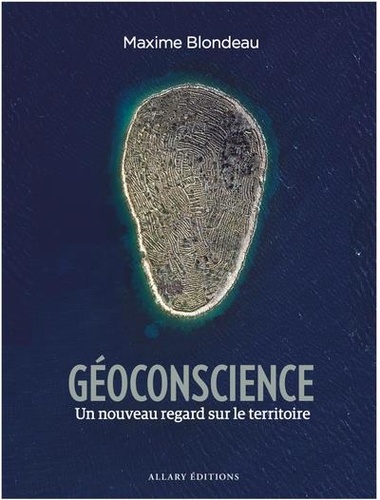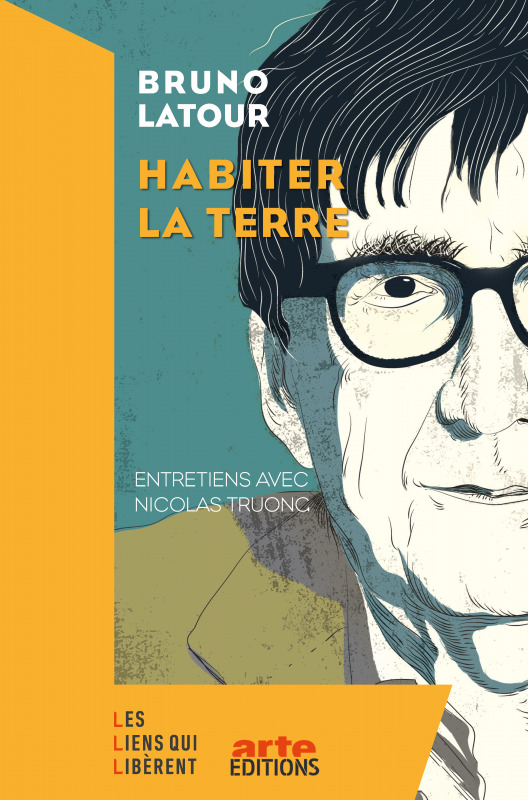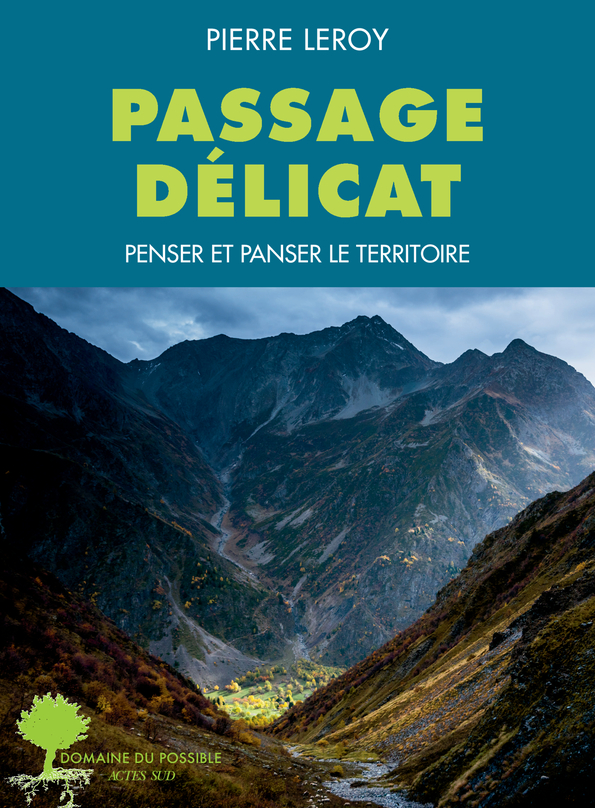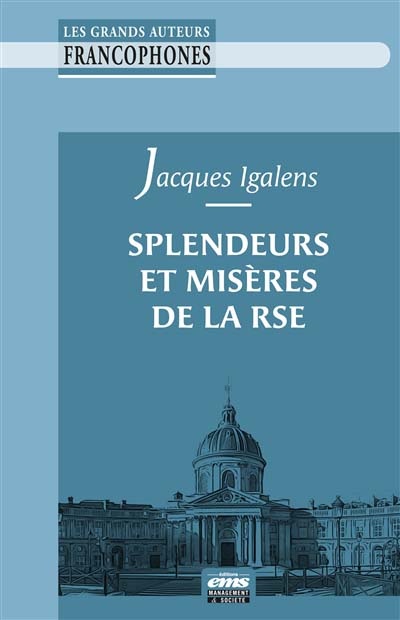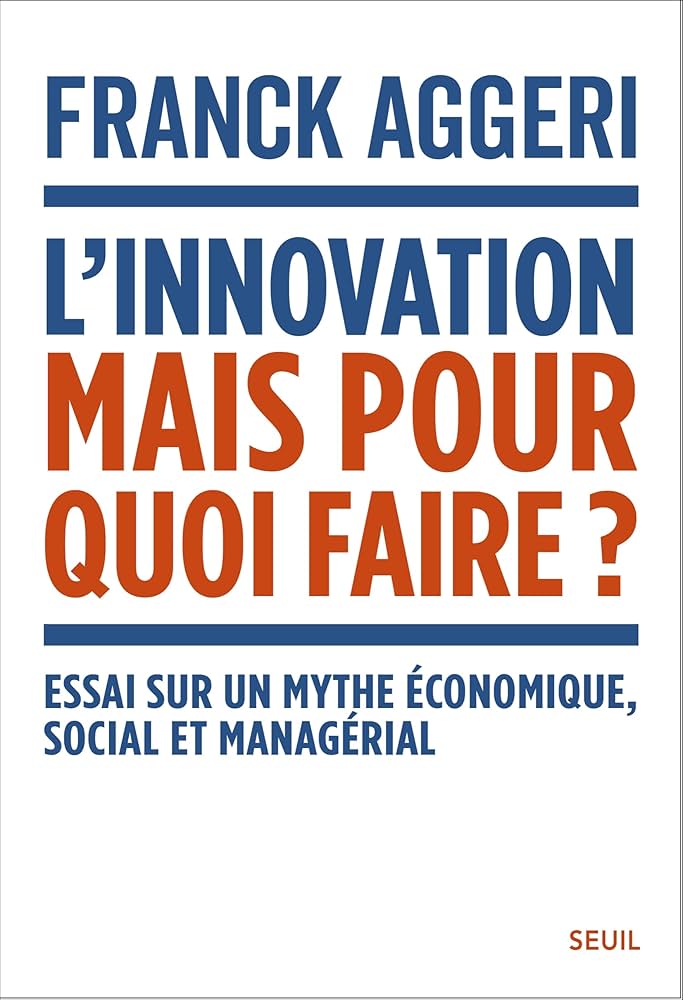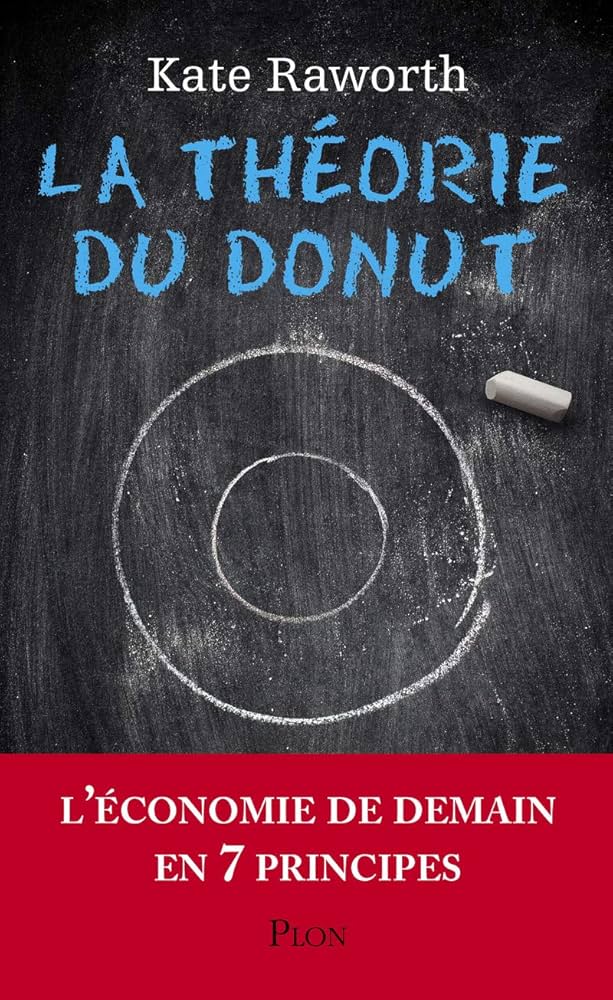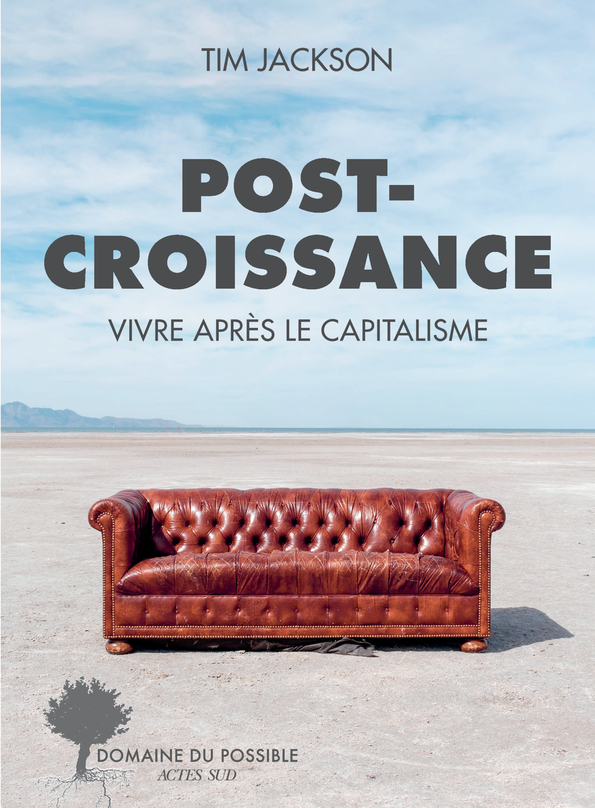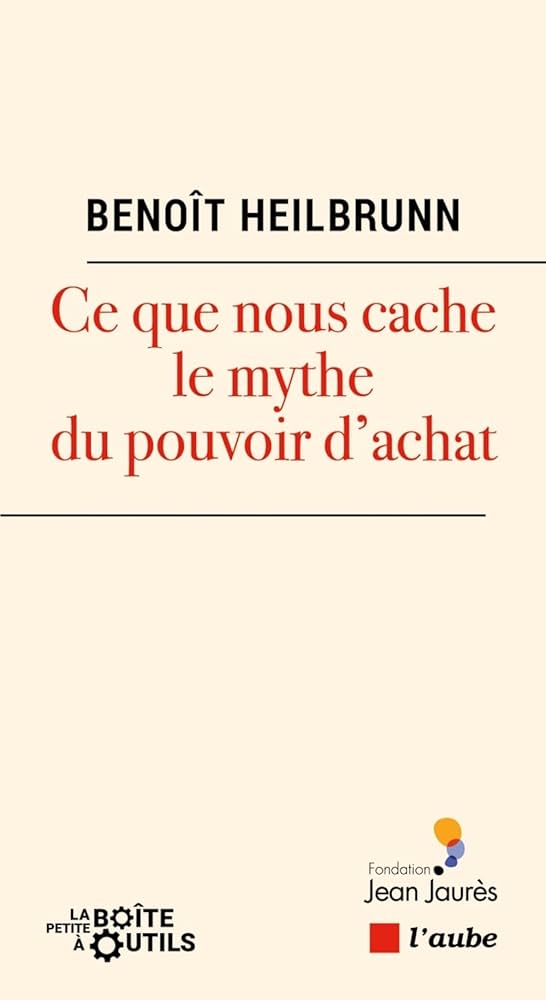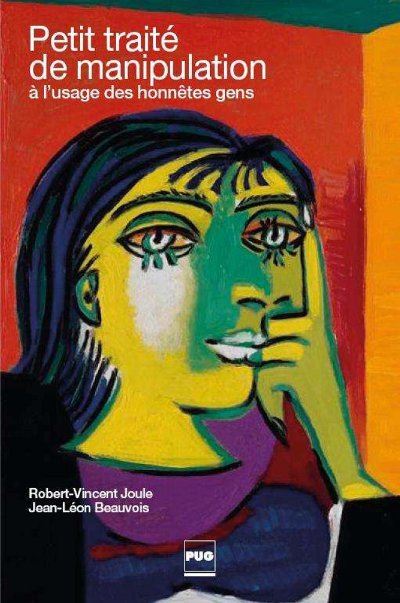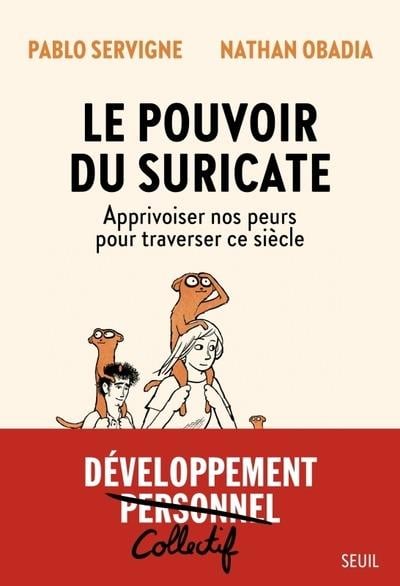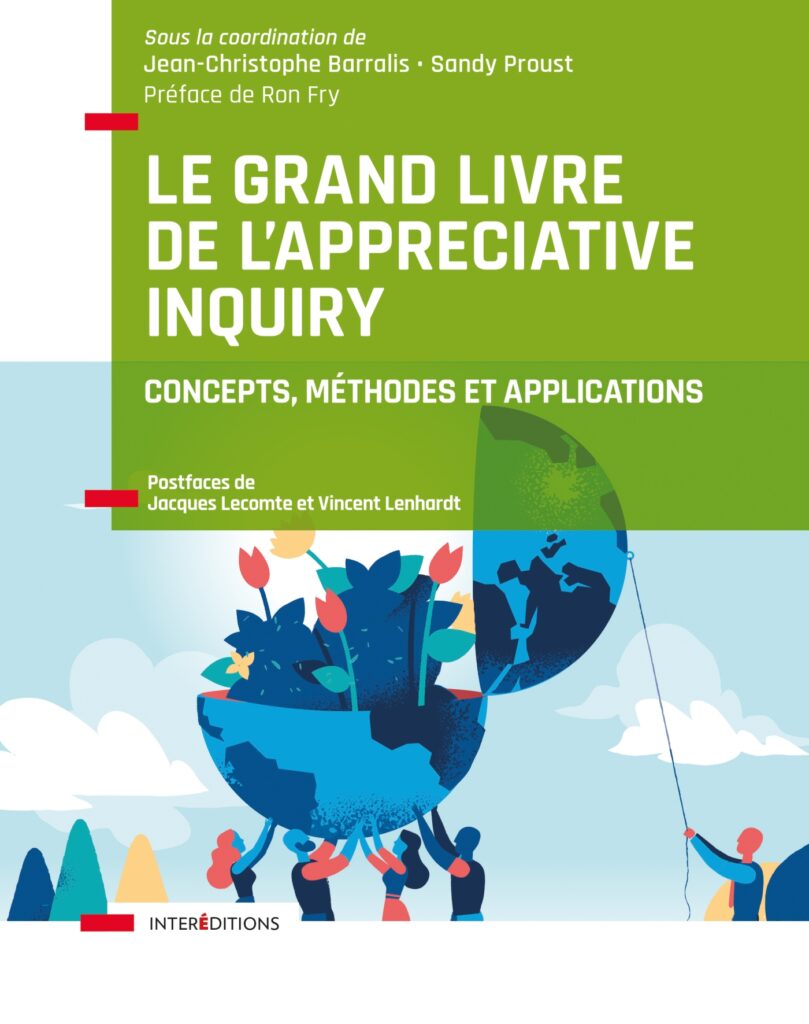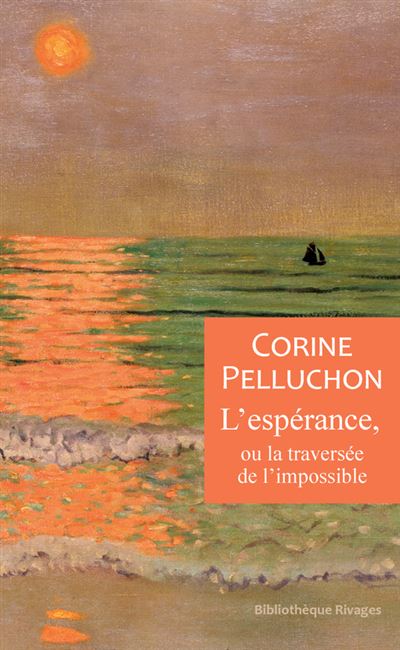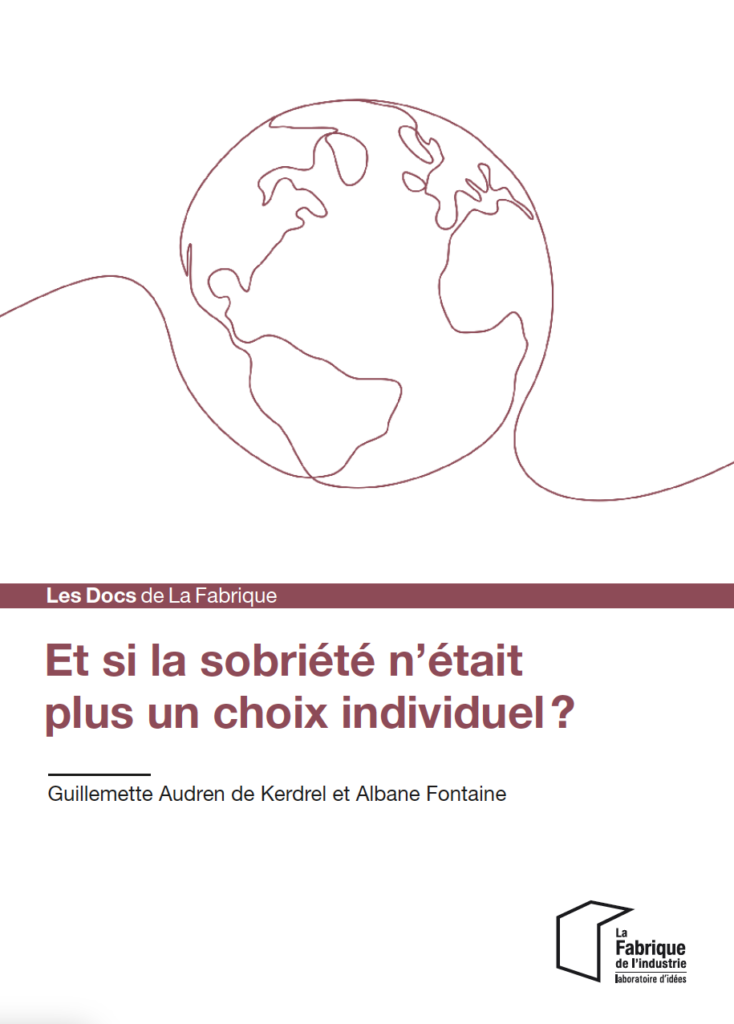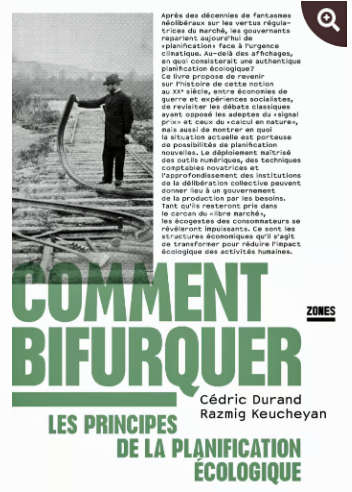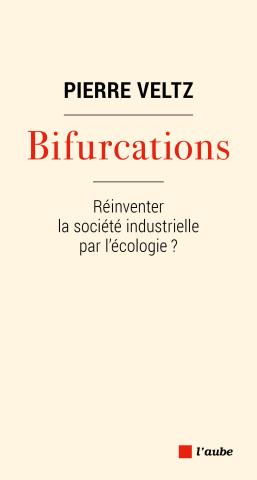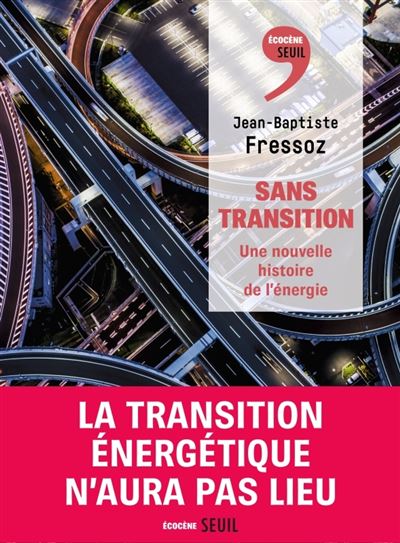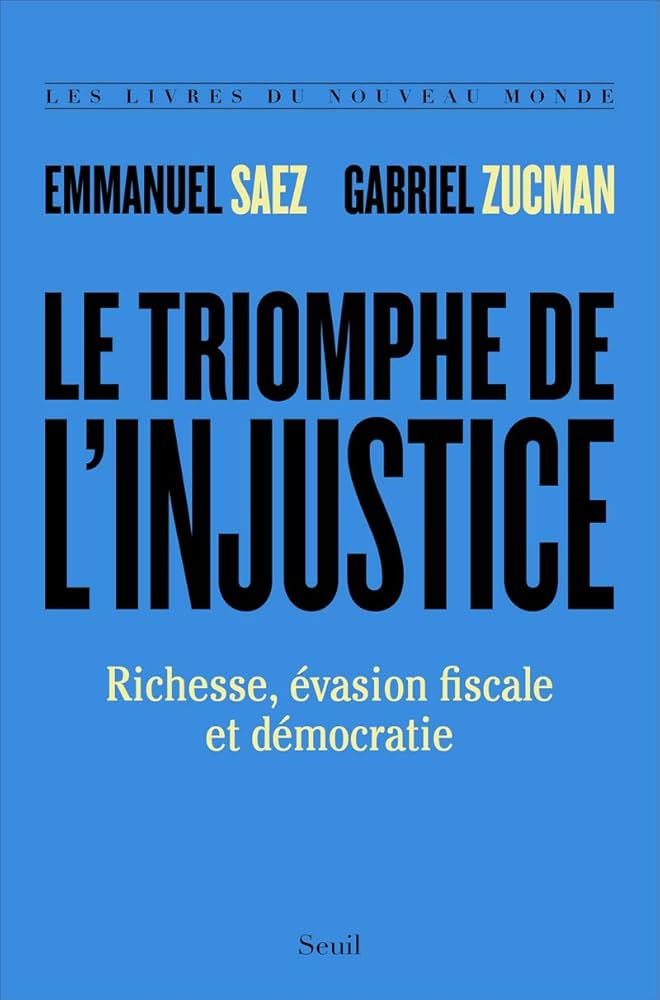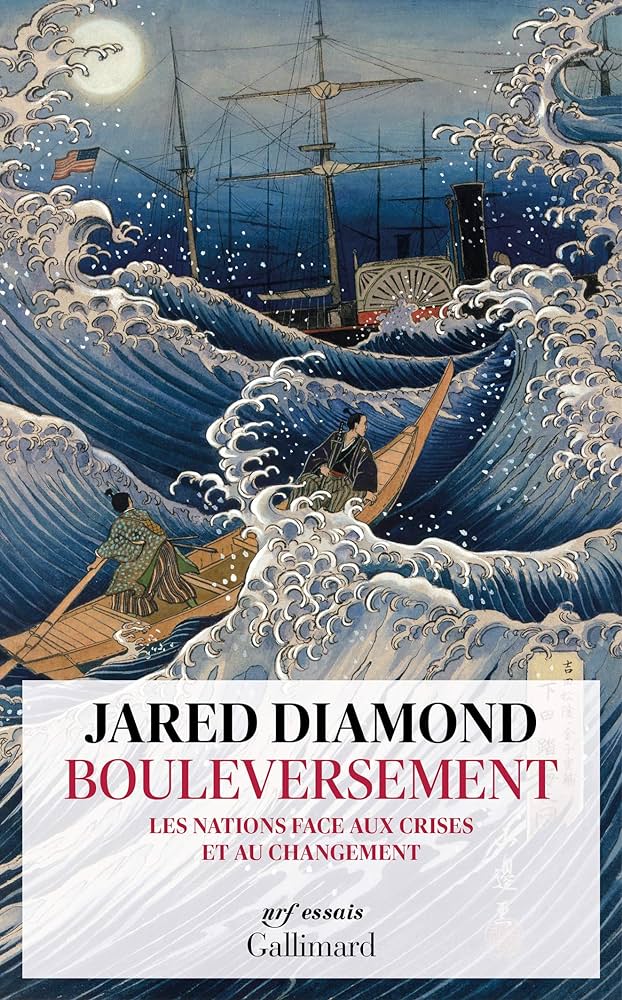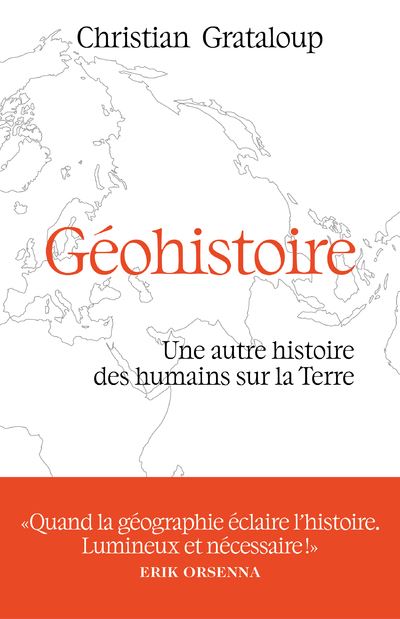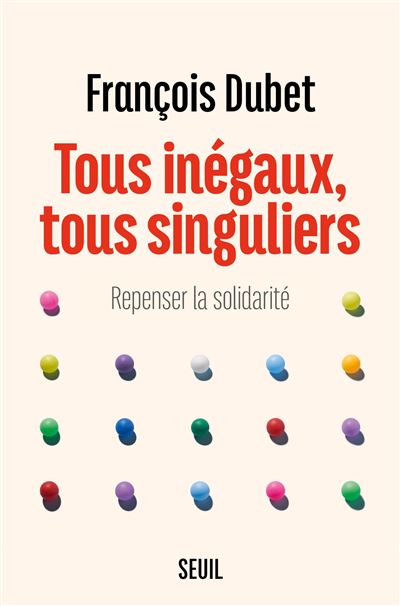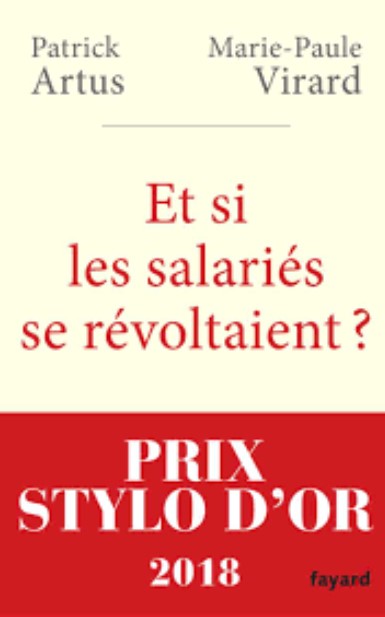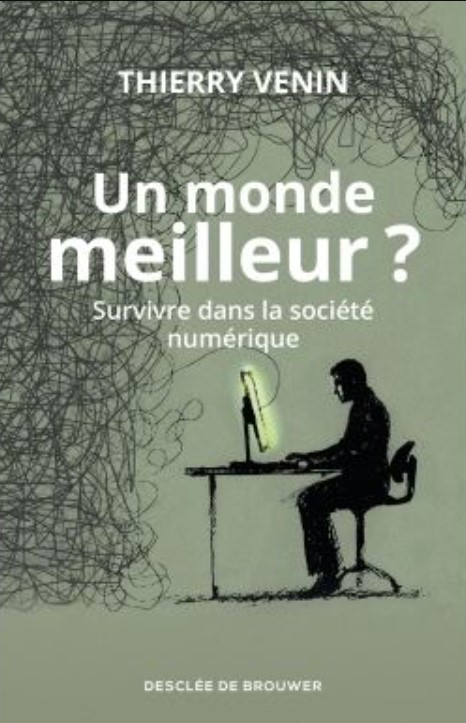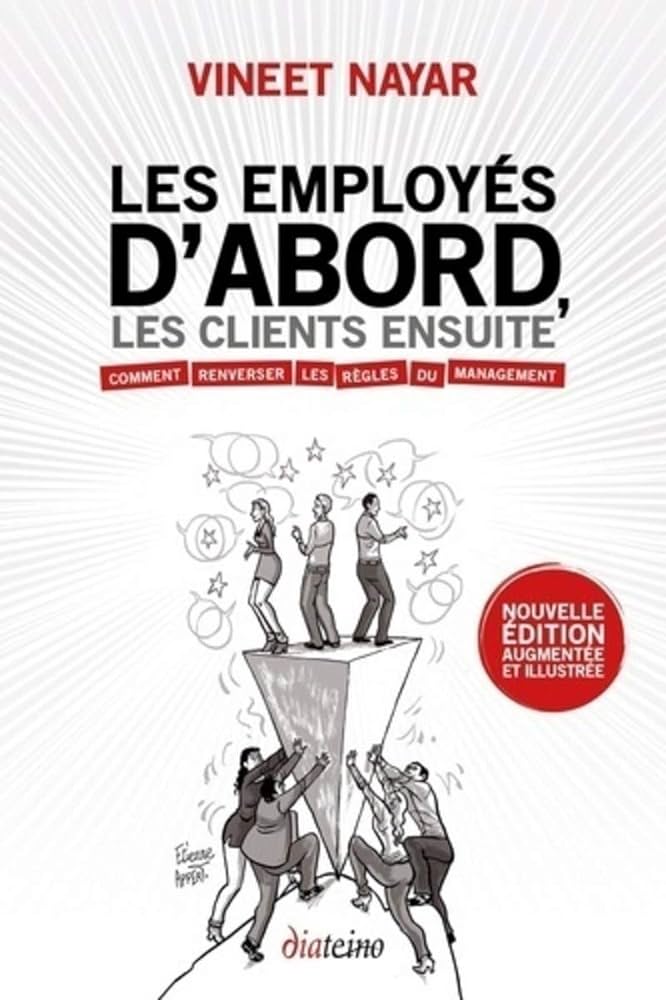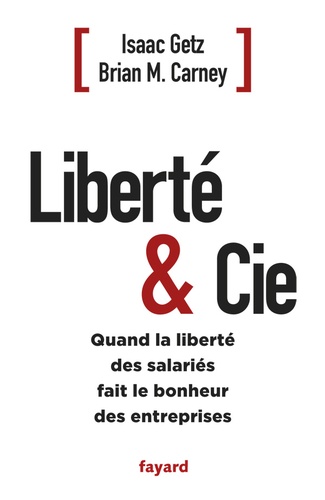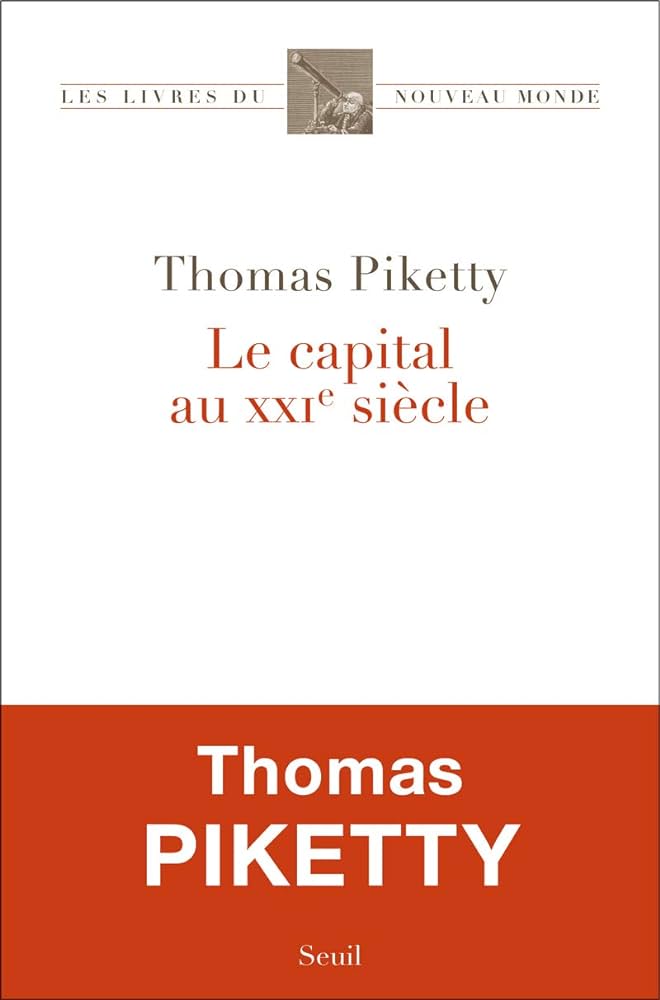Trois santés en interdépendance : naturelle, sociale, humaine
F. Collart Dutilleul, O. Hamant, I. Negrutiu, F. Riem, Les Editions Utopia 2023
En 1990, Michel Serres dans le Contrat Naturel avait plaidé pour une « reconnexion à la terre par la biologie (le lien au vivant) et le droit (le lien social) ». Les auteurs de ce « manifeste pour une santé commune », tous membres de l’Institut Michel Serres à l’ENS de Lyon, poursuivent et complètent les idées de Michel Serres. Ils proposent de positionner la santé commune au fondement de toute politique :
– la santé des milieux naturels sur le temps long,
– la santé sociale par la garantie d’un accès équitable aux ressources,
– la santé humaine comme état de complet bien-être physique, mental et social.
Le premier chapitre leur donne l’occasion de définir les contours de ce qu’est la santé commune, en ne se trompant pas d’ordre : « la santé des milieux naturels façonne la santé sociale qui, elle-même façonne la santé humaine ».
Dans le deuxième chapitre, ils explorent une valeur clé de la santé commune, à savoir la robustesse ; la capacité à se « donner un nouvel équilibre, en présence de fluctuations internes ou externes », car « notre seule certitude, c’est le maintien de l’incertitude ».
Ce concept de santé commune a déjà été exploré avec les cours d’eau pour lesquels on est passé successivement de la « classique commission internationale, puis la convention, la reconnaissance des droits, celle d’entité juridique vivante, puis de la personnalité morale ».
A travers l’exemple des cours d’eau on voit le rôle que peut jouer le droit : « il s’agit de repenser le droit international pour accompagner et mettre en œuvre la conversion de la loi de l’offre et de la demande en loi des besoins et des ressources ».
Cette réflexion sur les besoins et les ressources doit commencer au niveau des territoires : « il s’agit de faire de la santé commune une méthode de gouvernance du territoire, les décisions, seules ou groupées, devant impérativement cocher positivement les trois composantes, humaine, environnementale et sociale ».
A partir des enseignements d’expérimentations territoriales de santé commune, les auteurs proposent un « outil qui permet d’évaluer un projet à l’échelle locale vers la santé commune » et ainsi « guider les trajectoires économiques de façon opérationnelle ».
« Faut-il demander aux scientifiques des sciences de la nature de prendre les rênes, ou prier les économistes de mieux encadrer le marché en le remettant à sa place, ou attendre des juristes qu’ils imagines des principes et des règles qui parviennent à harmoniser économie et écologie… il faut sans doute penser les trois voies de santé commune en même temps » concluent les auteurs mettant en avant le besoin d’une coopération interdisciplinaire entre sciences biologiques et sciences sociales, particulièrement le droit, pour arriver à repositionner le curseur de l’économie. En effet « il ne s’agit pas de plaquer de nouvelles règles, comme la responsabilité sociale et environnementale, sur un modèle économique existant devenu obsolète, socialement et écologiquement ». Il s’agit d’inverser les priorités : « le modèle économique est non plus une donnée d’entrée dogmatique, mais un produit de sortie enraciné dans nos liens au monde.
Un manifeste qui devrait devenir le livre de chevet de nos gouvernants.